Invasion de Gaza : le point de la situation

Nous vous proposons une synthèse des événements survenus à Gaza aujourd'hui au terme de cette première journée de l'opération "Chariots de Gédéon II" menée par l'armée israélienne.
Le 16 septembre 2025 a commencé par un développement militaire majeur : le lancement d'une offensive terrestre de grande envergure à Gaza-ville. Cette opération, qualifiée de deuxième phase de "Les chariots de Gédéon", vise à prendre le contrôle de la principale ville de l'enclave, que l'armée israélienne présente comme le dernier bastion du Hamas. Le ministre de la Défense israélien a déclaré que "Gaza brûle", soulignant l'intensité de l'assaut. En prévision de cette opération de grande ampleur, l'armée israélienne a rappelé 60 000 réservistes.
L'offensive terrestre a été précédée et accompagnée d'une vague de frappes aériennes. Les responsables de la santé à Gaza ont rapporté qu'au moins 68 personnes ont été tuées par des frappes israéliennes depuis l'aube du 16 septembre, la plupart dans la ville de Gaza. Une frappe dans le quartier de Sheikh Radwan a notamment tué une famille de 10 personnes, dont une mère et ses trois enfants. L'Association palestinienne de football a annoncé qu'un de ses joueurs, Mohammed Ramez Sultan, a été tué avec 14 membres de sa famille. L'armée israélienne a également ciblé et détruit de nombreux immeubles de grande hauteur, affirmant que le Hamas les utilisait pour installer du matériel de surveillance.
L'articulation de cette offensive terrestre avec d'autres événements majeurs de la journée n'est pas fortuite. Le lancement de l'opération coïncide avec la publication d'un rapport de l'ONU qui accuse Israël de génocide. Cette simultanéité de l'action militaire et de la condamnation internationale montre que l'opération ne vise pas seulement un objectif stratégique sur le terrain, mais aussi à envoyer un signal de détermination en dépit de la surveillance internationale accrue. Le conflit se déroule sur deux fronts simultanément : la guerre militaire et la "guerre du narratif", une confrontation d'images et de récits que Laure Foucher, maîtresse de recherche sur le Moyen-Orient, estime qu'Israël est en train de perdre.
Cette stratégie militaire, perçue comme un projet de longue date du Premier ministre Benyamin Netanyahou, soulève un paradoxe significatif. Alors que l'objectif déclaré est de démanteler le Hamas, l'opération est perçue par de nombreux critiques, y compris au sein de la société israélienne, comme contre-productive pour la libération des otages restants. Les familles d'otages expriment la crainte que l'offensive ne mette directement en danger la vie de leurs proches. Il existe une tension critique entre la poursuite d'un objectif militaire maximaliste et la préoccupation pour le bien-être des citoyens israéliens toujours détenus. La poursuite d'une guerre urbaine de cette ampleur pourrait rendre une opération de sauvetage ou un accord de libération virtuellement impossible, suggérant que la "victoire" militaire est priorisée au-dessus de tout autre impératif.
La catastrophe humanitaire s'aggrave
La situation humanitaire dans la bande de Gaza a continué de se détériorer de manière dramatique le 16 septembre 2025. La famine a été confirmée dans la ville de Gaza par des organismes d'aide des Nations Unies, un état de fait qui résulte d'un "siège total" imposé à la population et du blocage de l'aide humanitaire. L'impact humain est désastreux : le ministère de la Santé de Gaza a rapporté que sept personnes, dont des enfants, sont décédées de causes liées à la malnutrition en l'espace d'une seule journée, portant le bilan total à 420 décès, dont 145 enfants, depuis le début de la guerre.
L'armée israélienne a ordonné aux résidents de Gaza-ville, soit environ un million de personnes, d'évacuer "immédiatement" et de se déplacer vers une "zone humanitaire" désignée dans le sud. Ces ordres ont été communiqués par des tracts largués depuis les airs. Cependant, cette politique de déplacement de la population se heurte à des défis de taille. Les zones désignées pour l'accueil des personnes déplacées sont déjà surpeuplées. De plus, de nombreuses familles ne peuvent se permettre le coût du transport ou sont réticentes à se déplacer une nouvelle fois, après avoir été déplacées à plusieurs reprises, ne faisant plus confiance à l'idée qu'un endroit de l'enclave puisse être sûr.

L'obstruction de l'aide renforce l'état d'urgence humanitaire. Une initiative de l'ONU visant à acheminer des abris temporaires est bloquée, avec plus de 86 000 tentes et autres fournitures en attente de dédouanement la semaine précédente. Ces actions, couplées au siège et au déplacement forcé, ont conduit à de graves accusations. Des organisations non gouvernementales et des responsables de l'ONU, comme la rapporteure spéciale des Nations Unies, Francesca Albanese, ont affirmé qu'Israël utilisait l'aide comme une "arme" et rendait Gaza "invivable". Ces allégations soulignent une préoccupation que la crise humanitaire est délibérément utilisée comme un outil pour atteindre des objectifs militaires et stratégiques, tels que le nettoyage de la zone urbaine. Le nombre élevé de décès liés à la malnutrition et le manque de refuges sécurisés suggèrent que la "zone humanitaire" est un lieu de confinement plus qu'une véritable zone de sécurité.
Les développements juridiques et diplomatiques
La journée a été marquée par une évolution juridique et diplomatique de la plus haute importance. Une nouvelle commission d'enquête internationale indépendante des Nations Unies a publié un rapport cinglant, alléguant qu'Israël est responsable d'avoir commis un génocide à Gaza.La Commission, présidée par Navi Pillay, affirme que la "Commission estime qu'Israël est responsable d'avoir commis un génocide à Gaza".Les conclusions du rapport désignent trois dirigeants israéliens comme personnellement responsables : le Premier ministre Benyamin Netanyahou, l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant et le président Isaac Herzog.
Le rapport fonde ses conclusions sur l'examen des opérations militaires israéliennes, "y compris le meurtre et les blessures graves infligées à un nombre sans précédent de Palestiniens", et sur l'imposition d'un "siège total, y compris le blocage de l'aide humanitaire entraînant la famine". La Commission d'enquête établit un parallèle troublant entre les événements à Gaza et le génocide rwandais de 1994, avec Navi Pillay déclarant que "Le génocide se produit à Gaza. Lors du génocide rwandais, le groupe était les Tutsis, et ici le groupe est les Palestiniens". Les conclusions de ce rapport pourraient être utilisées par les procureurs de la Cour pénale internationale ou de la Cour internationale de Justice.
Parallèlement, la récente frappe israélienne à Doha, qui visait les dirigeants du Hamas, a eu des répercussions diplomatiques importantes. Bien que l'attaque ait été condamnée par le Conseil de sécurité de l'ONU et le Secrétaire général, elle a également mis en péril le rôle du Qatar en tant que médiateur clé. La frappe a été un échec spectaculaire, selon Einav Zangauker, la mère d'un otage. La publication de la Déclaration de Doha, après un sommet conjoint de la Ligue arabe et de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), révèle que les pays du Golfe et d'autres nations ne souhaitent pas vivre sous la domination iranienne ou israélienne. Cette déclaration suggère un éloignement des efforts de normalisation avec Israël et une orientation vers une position plus critique, marquant une détérioration de la diplomatie régionale.
La publication du rapport de l'ONU est bien plus qu'un document juridique ; c'est un point culminant de la "guerre du narratif". Le rapport fournit une validation institutionnelle à la plus grave accusation possible en vertu du droit international, ce qui renforce considérablement la position du récit anti-israélien. Le rejet immédiat du rapport par Tel Aviv et la poursuite simultanée des opérations militaires ne font qu'accentuer la perception d'un mépris du droit international et de l'opinion mondiale. Cette dynamique isole Israël sur la scène mondiale. L'attaque sur le territoire d'un médiateur clé (Doha) et le contenu de la Déclaration de Doha indiquent un effondrement de la confiance dans les canaux diplomatiques traditionnels. Cela suggère que la résolution du conflit se fonde désormais sur l'action militaire unilatérale et sur une dépendance à un allié unique, les États-Unis, rendant la perspective d'une résolution pacifique de plus en plus lointaine.
Contexte politique intérieur et régional
La pression politique sur le gouvernement israélien, en particulier sur le Premier ministre Netanyahou, s'est intensifiée. Des proches d'otages israéliens retenus par le Hamas manifestent et exigent un accord pour la libération de leurs proches.Ils ont critiqué l'approche de Netanyahou, la qualifiant de "contre-productive" pour parvenir à une solution. La mère d'un otage, Einav Zangauker, est allée jusqu'à affirmer que Netanyahou ne cherche pas à frapper les dirigeants du Hamas, mais plutôt à "saboter la chance des familles de ramener leurs proches à la maison", citant un commentaire de l'ancien président Trump. Ces allégations jettent une lumière crue sur la profonde division interne et la méfiance envers le gouvernement.

Sur le plan régional, les alliances et les priorités sont en pleine mutation. La Déclaration de Doha, issue d'un sommet regroupant la Ligue arabe et l'OCI, est un indicateur majeur. L'accent mis sur le désir des nations arabes de ne pas être dominées par l'Iran ou Israël est un changement notable. Ce développement, qui fait suite à la frappe de Doha, suggère que les efforts de normalisation régionale avec Israël sont suspendus, voire abandonnés. L'isolement d'Israël s'accroît, même au sein de la région, ce qui pourrait le placer dans une situation défavorable si les pays du Golfe influencent la position américaine.
Le calcul politique de Netanyahou est un élément central de cette analyse. L'intense critique des familles d'otages et l'isolement international croissant constituent un défi politique considérable. La décision de lancer une offensive urbaine majeure au risque de la vie des otages indique que la "victoire" militaire est la priorité absolue, au détriment d'une solution négociée. Cette stratégie peut être interprétée comme une volonté de prolonger le conflit pour assurer la survie politique de Netanyahou et éviter un jugement post-conflit.
Une conjoncture aux conséquences lourdes
Le 16 septembre 2025 n'est pas une journée de guerre comme les autres. C'est un point de bascule où l'escalade militaire à Gaza-ville s'est dangereusement croisée avec une catastrophe humanitaire qui s'aggrave, une accusation sans précédent de génocide au niveau international et un isolement diplomatique croissant pour Israël. Ces événements se sont mutuellement alimentés, créant une spirale de conflit et de condamnation.
L'offensive terrestre promet une phase de guerre prolongée et sanglante, tandis que le rapport de l'ONU, bien que rejeté par Israël, prépare le terrain pour d'éventuelles actions en justice futures et intensifie la pression mondiale. Les dynamiques politiques intérieures et régionales indiquent qu'une résolution pacifique est de plus en plus improbable. La décision de poursuivre l'offensive malgré les risques pour les otages et les critiques internes et internationales suggère une priorité à l'action militaire sur la diplomatie. Les événements de cette journée ont cimenté la position du conflit en tant que défi majeur pour la sécurité mondiale, le droit international et la stabilité régionale.
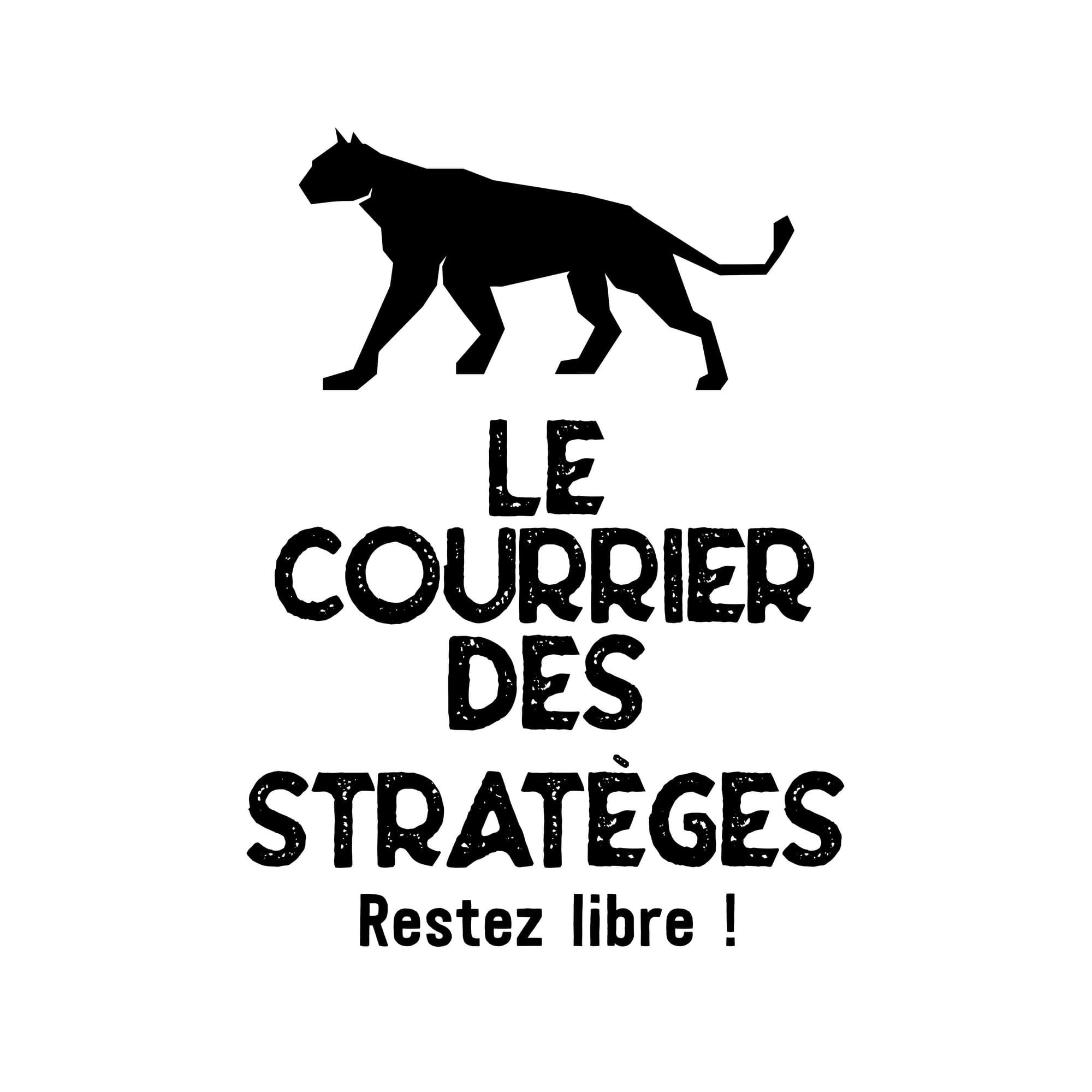



Commentaires ()