Le reste à charge zéro est, en apparence, l’une de ces mesures techniques qui n’appelle pas de discussion “politique” majeure et qui relève de la mesure d’intérêt général. Quand on y regarde de plus près, on s’aperçoit que cette décision a tout d’un “cheval de Troie” qui, en endormant la vigilance des acteurs concernés par la mesure, ou les occupant par des aspects périphériques, comporte des effets secondaires dévastateurs. En l’espèce, c’est le paritarisme lui-même, et singulièrement le paritarisme de branche, qui devrait vivre dans les mois qui viennent un véritable typhon si le monde patronal se révèle incapable d’y répondre rapidement.
Le reste à charge zéro est supposé régler la question sensible de l’accès aux soins, notamment dentaires et optiques, où les performances françaises sont moins “excellentes” que sur les autres garanties de santé. Pour s’attaquer au problème, le pouvoir exécutif a suivi la doctrine historique de l’étatisme français: il procède par tarif obligatoire et par réglementation imposée aux acteurs et aux assurés. Le mécanisme n’est pas nouveau, même si l’on sait qu’il souffre de nombreuses limites.
Dans le cas présent, les organismes complémentaires et les acteurs paritaires qui ont appelé de leurs voeux et parfois participé à la mise en place de ce mécanisme n’ont peut-être pas vu les inconvénients “secondaires” qu’il comporte, et que nous pourrions appeler ses dommages collatéraux. Ceux-là méritent pourtant une attention soutenue, car ils risquent bien de déstabiliser en profondeur un édifice fragilement construit ces dernières années.
Une dangereuse superposition de règles mal coordonnées
La mise en place du reste à charge zéro passe par la loi de financement de la sécurité sociale et par de nombreux décrets. Elle procède d’abord par cet empilement de normes touffues qu’on reproche tant au législateur français. Toute la difficulté est que cette mise en place s’emboîte dans les dispositions relatives au contrat responsable, qui elle-même ont télescopé les accords de branche imposés par la loi du 14 juin 2013.
Dans ce genre de “mikado” réglementaire, les risques apparaissent toujours, liés au conflit de normes. Et l’on peut dire que ces risques se réalisent de façon maximale dans le cas du reste à charge.
Les tarifs imposés par cette mesure seront en effet obligatoires, et l’obligation enjambe les accords de branche. Autrement dit, chaque salarié pourra, au 1er janvier 2020, exiger de son employeur le respect du reste à charge zéro même si l’accord de branche négocié après la loi de 2013 ne le prévoit pas. On mesure ici la portée du danger: les accords de branche non-conformes au reste à charge zéro auront du plomb dans l’aile, et deviendront quasiment superfétatoires par rapport aux obligations imposées directement par le législateur.
Des risques de portée très différente
Cette situation est compliquée encore par les différences de risques encourus selon les cas. Comme on le sait, la conformité aux accords de branche est un risque purement prudhommal. Pour des raisons malicieuses que les pouvoirs publics n’ont pas expliquées, le contrôle de conformité de ces contrats n’a pas été confié aux URSSAF.
En revanche, une contravention aux dispositions applicables aux contrats responsables, et donc au reste à charge zéro, relève directement du risque fiscal contrôlé par l’URSSAF.
Voilà qui ne fera pas un pli en cas de conflit de normes entre un accord de branche qui ne prévoit pas de reste à charge zéro et la loi qui l’impose: l’employeur appliquera dans la crainte et le tremblement les dispositions prévues par la loi au détriment de l’accord de branche.
Le crainte et le tremblement face aux ambiguïtés des textes
Pourquoi dans la crainte et le tremblement? Parce que la règle, une fois de plus, n’est pas claire et l’intelligibilité de la loi est ici très malmenée. Dès lors que l’employeur sommé d’apporter une complémentaire santé à ses salariés doit choisir entre un accord de branche non conforme fiscalement, et une règle fiscale qui ne s’applique que sur une partie des garanties, que faire? Doit-il, pour tout ce qui concerne les postes non couverts par le reste à charge zéro, respecter ou non l’accord de branche si celui-ci n’a pas été adapté?
Personne (au sein des pouvoirs publics) n’a évidemment pris le temps de clarifier ce point et de rassurer les chefs d’entreprise sur la sauce à laquelle ils seront mangés en cas de contrôle. C’est le problème de notre technostructure proliférante: elle adore multiplier les règles, les empiler, pour se donner bonne conscience. Mais elle se dispense de les mettre en conformité, d’harmoniser leur application, considérant que les employeurs n’ont qu’à se débrouiller, à leurs risques et périls, pour comprendre ce que la loi peut bien vouloir dire.
La marginalisation du paritarisme avance à grands pas
On voit ici le risque majeur, politique, systémique, qui se profile. Peu à peu, la loi devient la norme d’application dans la vie des entreprises, par-dessus la règle négociée entre les partenaires sociaux. Malgré les ordonnances Pénicaud qui ont prétendu faire l’inverse, à savoir inverser la hiérarchie des normes et accorder un primat à la négociation, à la soft law, en quelque sorte, la loi progresse.
Les initiés y décèleront la trace d’un conflit politique larvé dans les lieux même du pouvoir. Ce conflit oppose les tenants de la négociation (notamment autour de Pierre-André Imbert, ancien du cabinet Alixio de Raymond Soubie et rédacteur en chef des ordonnances Pénicaud, après avoir rédigé la loi El-Khomri) d’un côté, et les partisans jacobins de la loi de l’autre. Dans ce dernier groupe, on trouve la direction de la sécurité sociale et son ancien directeur, Thomas Fatome, devenu directeur de cabinet adjoint d’Édouard Philippe.
L’ensemble des concessions imposées par les premiers est méthodiquement repris par les seconds, qui rêvent d’une étatisation complète de la santé et de la protection sociale, comme Pierre Laroque l’avait rêvé dès les années 30 lorsqu’il inventa la CNAV.
La passivité des partenaires sociaux, première responsable?
Dans ce grand mouvement qui vise sans cesse à affaiblir la place de la négociation dans le domaine de la protection sociale complémentaire, les partenaires sociaux portent une responsabilité qui ne peut être niée. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, qui programme la mise en place du reste à charge zéro, leur donne une année pour négocier, branche par branche, l’adaptation de leur accord fixant les garanties minimales à apporter aux salariés.
Dans la pratique, l’année ne compte que dix mois, puisque les délais de résiliation des contrats souscrits par les entreprises pour 2020 s’éteignent au 31 octobre. Tout accord négocié au-delà de cette date n’est donc plus applicable. Encore, pour qu’il soit de portée obligatoire, doit-il être déposé à l’extension dans des délais compatibles avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2020.
Manifestement, cette urgence à adapter les accords de branche pour leur éviter la marginalisation, voire la désuétude du fait d’un conflit de normes, n’a pas atteint les partenaires sociaux, et rares sont ceux, notamment au CTIP, qui semblent avoir promu l’intérêt d’agir vite. Cette passivité est à leur charge. Car, si l’on peut reprocher au pouvoir exécutif (au sens large, c’est-à-dire en incluant la technostructure) la manie de vouloir tout régenter, on peut aussi reprocher aux partenaires sociaux la nonchalance avec laquelle ils y répondent.
Progressivement, tout se passe comme si les acteurs de la négociation collective consentaient à disparaître. Comment, dans ce cas, pourront-ils durablement crédibiliser leur prétention à incarner des corps intermédiaires indispensables à une bonne gouvernance? Le mystère reste entier.
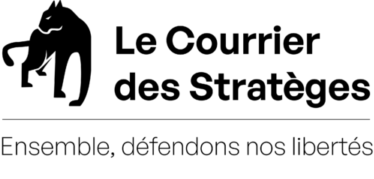



Commentaires 1