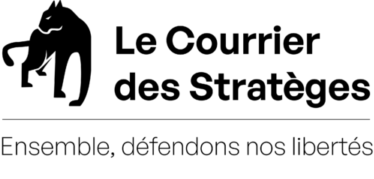UN LIEN, de plus en plus, ÉMOTIONNEL ou L’ÉTHIQUE DE L’ESTHÉTIQUE
Cesser de haïr le présent. Voilà quelque chose de difficile pour nous qui sommes toujours à l’affût de ces divers « arrières mondes » faisant les délices des constructions intellectuelles. Et pourtant s’esquisse sous nos jeux un monde réenchanté, accepté pour ce qu’il est. Tel est le défi auquel l’on est confronté en ce début du XXIe siècle. C’est pourquoi l’évidence de l’objet, la certitude du sens commun, la profondeur des apparences, l’expérience de la proxémie, seront les idées forces qui doivent guider toute réflexion authentique .
Il faut donc d’une part dresser un constat, d’autre part en dégager l’intelligence.
En effet régulièrement les grandes certitudes s’effondrent. Les événements, les mutations et les innovations en appellent à de nouvelles manières de penser la société. La connaissance, toujours et à nouveau renaissante, est en liaison avec l’état du monde, et c’est lorsque l’on oublie cela, que le décalage inévitable entre la réflexion et la réalité empirique devient un fossé, qu’il est dès lors impossible de franchir. D’où la morosité, le cynisme ou autres formes de désabusement qui semblent prévaloir de nos jours.
En fait, même s’il n’est qu’un point de passage évanescent entre le passé et l’avenir, seul le présent est la source fécondante de la pensée. Seul en effet il nous fournit les éléments, les faits d’expérience, qui nous permettent de comprendre, au-delà de tous les a-priori, ce qui est à l’état naissant. Il s’agit là d’une banalité que l’on admet sans peine. Mais, car il y a toujours un « mais », une fois admis le constat, il faut Théoriser C’est à dire très souvent déterminer, d’une manière normative ou judicative, ce que doit être la vie sociale que l’on s’emploie à observer. Pour ceux qui s’astreignent à la dure discipline phénoménographique, il est fréquent de s’entendre dire, par le philosophe gardien du concept, le sociologue soucieux d’être utile, ou le journaliste juge de ce qui doit être diffusé, tout cela est « bien beau », c’est peut-être vrai, mais après… Comme si ce qui se donnait à voir, et le fait de le voir n’était pas suffisant. Comme s’il fallait faire système ou, ce qui à certains moments revient au même, s’il fallait rentrer dans les pensées connues et convenues, pour que soit reconnue, canonisée, l’évidence têtue d’une réalité qui, elle, n’a que faire de la légitimation théorique. On se souvient de l’apostrophe de Bossuet à Malebranche : « Pulchra, nova, falsa ». Vieille histoire qui toujours se rejoue des clercs de service croyant possible de dénier ce qui est, afin de sauvegarder l’admirable perfection de leurs dogmatiques !
Faire voir. Donner à penser. Cela peut en choquer plus d’un. De celui qui se cantonne à une érudition sans horizon, à cet autre qui fait une théorie abstraite, sans oublier le manipulateur de données statistiques, plus ou moins datées, nombreux sont ceux qui ricanent lorsque l’on se contente de montrer. Et pourtant il faut continuer, ne serait-ce que pour prendre date, et donner du matériel réflexif à ceux qui, désillusionnés de leurs prétentions et guéris de leur « gueule de bois », seront à même d’utiliser, même si c’est en catimini, cela même qu’ils considéraient il y a peu comme infra-théorique. Cela nécessite un regard lucide sur des faits bruts. Un regard généreux aussi qui respecte les choses pour ce qu’elles sont, et qui tente de saisir quelle peut être leur logique interne. Dès lors il convient d’être attentif à une esthétisation de la vie quotidienne, discréte mais têtue . Esthétisation faisant ressortir, mette en valeur, ou, selon un terme que j’affectionne, « épiphanise » le réel. Une telle démarche s’inscrit dans ce que l’on peut appeler le « jugement d’existence », bien différent du « jugement de valeur ». Certes il y a encore du jugement, mais il est tempéré, nuancé, relatif, fragile, à l’image des phénomènes qu’il décrit.
Ce retour de l’esthétique s’applique à réduire la dichotomie, par trop abrupte, que la modernité a établie entre la raison et l’imaginaire, ou entre la raison et le sensible. J’ai parlé à ce propos « d’hyperrationalité », c’est à dire d’un mode de connaissance qui sache intégrer tous ces paramètres que l’on considère habituellement comme secondaires : le frivole, l’émotion, l’apparence… toutes choses que l’on peut résumer par le mot esthétique. On pourrait parler de « sensibilité de la raison », à savoir ce qui, dans tous les domaines : politiques, professionnels, moraux, fait frémir la raison grâce à ces forces sensibles qui sont celles de la vie privée ou publique.
Observer qu’il y a une synergie de plus en plus prononcée entre la pensée et la sensibilité. En bref cela revient à rendre attentif à ce qui d’une manière étonnante, compte tenu des diverses impositions sociales, sait dire « oui tout de même » à la vie. Et cela non pas en fonction d’un quelconque optimisme de privilégié, mais bien en considérant le solide vitalisme social qui, même au travers des plus dures conditions de vie, ne manque pas de s’affirmer, fut-ce sous la forme de la duplicité.
Donc voilà l’hypothèse : il y a un hédonisme du quotidien irrépressible et puissant qui sous-tend et soutient toute vie en société. Une structure anthropologique en quelque sorte. C’est cela, de tout temps, le cœur battant de l’esthétique . A certaines époques, cet hédonisme sera marginalisé et occupera un rôle subalterne, il en est d’autres où, au contraire, il sera le pivot à partir duquel va s’ordonner, de manière affichée, discrète ou secrète, toute la vie sociale. En ces moments là ce que l’on appelle les rapports sociaux, ceux de la vie courante, des institutions, du travail, des loisirs, ne sont plus uniquement régis par des instances surplombantes, a priori et mécaniques, de même ils ne sont plus orientés vers un but à atteindre, toujours lointain, en bref tout ce qui est délimité par une logique économico-politique, ou déterminé en fonction d’une vision morale. Au contraire, ces rapports deviennent des relations animées par et à partir de ce qui est intrinsèque, vécu au jour le jour, d’une manière organique, de plus ils se recentrent sur ce qui est de l’ordre de la proximité. En bref le lien social devient émotionnel. Ainsi s’élabore une manière d’être (éthos) où ce qui est éprouvé avec d’autres sera primordial. C’est cela même que je désignerai par l’expression : « éthique de l’esthétique ».
Mais pour faire ressortir cela , il est en effet souvent nécessaire de grossir le trait afin de faire voir les divers indices sur lesquels on s’appuie. En la matière il s’agit de donner au terme esthétique son sens plénier, et ne pas le restreindre à ce qui à trait aux oeuvres de la culture ou à leurs interprétations. Il faut comprendre que l’esthétique s’est diffractée dans l’ensemble de l’existence. Plus rien n’en est indemne. Elle a contaminé le politique, la vie de l’entreprise, la communication, la publicité, la consommation, et bien sûr la vie quotidienne. Peut-être, pour parler d’une telle esthétisation galopante, de l’ambiance spécifique qu’elle sécrète, faudrait-il reprendre l’expression allemande de « Gesamtkunstwerk », oeuvre d’art total. Un art qui va s’observer dans le dépassement du fonctionnalisme architectural ou dans celui de l’objet usuel. Du cadre de vie, au « design » ménager tout entend devenir oeuvre de création, tout peut se comprendre comme l’expression d’une expérience esthétique première. Dès lors l’art ne saurait être réduit uniquement à la production artistique, j’entends celle des artistes, mais devient un fait existentiel. « Faire de sa vie une oeuvre d’art », n’est-ce pas devenu une injonction de masse ?
Il n’est certes pas question de juger s’il s’agit là d’une réalité, d’un fantasme, ou encore d’une simple exigence commerciale. Il suffit de voir que les sons, les couleurs, les odeurs, les formes sont agencés de telle manière qu’ils favorisent un sensualisme collectif. Peut-être est-ce là le triomphe de Marcel Duchamp, l’art s’est trivialisé, il structure la banalité, c’est à dire il « fait société ». Certes les termes esthétique ou art ne sont pas communément employés en ce sens, de même il ne sont pas utilisés pour caractériser le sensualisme quotidien dont il vient d’être question, mais ils me paraissent les plus adaptés pour décrire l’ambiance générale d’une époque où plus rien n’est véritablement important ce qui fait que tout a de l’importance. En particulier tous les détails, les fragments, les petites choses, les divers événements qui constituent une mosaïque colorée, un kaléidoscope aux figures changeantes et bigarrées redonnant au présent une valeur centrale dans la vie sociale.
Ce « présentéisme » peut être comparé à la sensibilité baroque, mais un baroque se capillarisant dans la vie de tous les jours. Ce sera la présence obsédante de l’objet, servant de totem emblématique auquel on s’agrège, ce sera le clinquant de la luminosité, l’effervescence aussi des grandes mégapoles contemporaines, ce pourra être l’excitation du plaisir musical ou sportif, sans oublier le jeu de l’apparence, où le corps s’exhibe en une théâtralité continue et omniprésente. De bout en bout, tout cela délimite une « aura » spécifique, dans laquelle on baigne et qui conditionne, volens nolens, les manières d’être, les modes de penser, les styles de comportement à autrui. Décidément l’esthétique (aisthésis), le sentir commun semble être le meilleur moyen de nommer le « consensus » qui s’élabore sous nos yeux, celui des sentiments partagés ou des sensations exacerbées : Cum-sensualis.
Il semble en effet qu’une esthétique décloisonnée permette de comprendre cet être-ensemble désordonné, versatile et tout à fait insaisissable sans cela : la « socialité ». En un temps où il n’était pas coutume de l’employer (La Conquête du Présent, 1979), j’avais proposé ce terme pour faire ressortir qu’il pouvait y avoir une logique à l’oeuvre dans ce qui, par bien des aspects, paraissait non-logique. Autre manière de dire le plaisir des sens, le jeu des formes, le retour en force de la nature, l’intrusion du futile, tout cela complexifie la société, mais plus qu’à une abdication de l’esprit cela en appelle à une connaissance plus ouverte, ce que je viens de nommer une « raison sensible »,
Connaissance qui n’est forcement pas aisée, . Elle demande un effort qui est à la mesure du défi que lance l’hétérogénéisation galopante de nos sociétés. En effet, le propre de la socialité esthétique est d’être structurellement ambiguë. La réflexion qui entend en rendre compte est du même ordre. Elle sera souvent « monstrative », parfois démonstrative, ou encore digressive. Démarche qui n’emprunte pas forcément un tracé linéaire, une progression assurée, mais qui plutôt suivra les méandres, les discontinuités d’une réalité à la fois bien vivante et en pleine croissance. A l’image de tous les « discours » du social, communication verbale, langage du corps, explosion des affects, révoltes ponctuelles, le discours (« dis-currere ») propre à une pensée authentique ne manque pas de courir de plusieurs côtés. Ce qui n’empêche que dans l’un et dans l’autre cas, la vie sociale et la réflexion que l’on peut avoir à partir d’elle, il puisse y avoir une continuité du sens, même si celui-ci est pluraliste.
C’est pour décrire la continuité dans la complexité qu’il faut revenir à l’idée d’organicité . À savoir ce qui maintient ensemble des éléments contraires, voire opposés. D’où la référence aux notions de post-moderne ou post-modernité. J’ai bien dit notion, avec ce que cela peut avoir de provisoire, ou tout simplement de pratique, pour décrire ce qui est en train de succéder à l’échelle de valeur ayant constitué les « temps moderne » : la Modernité . Ainsi, sans rentrer dans un débat stérile sur la notion même, la post-modernité serait ce mélange organique d’éléments traditionnels et d’autres on ne peut plus contemporains. En d’autres termes : synergie de l’archaïque et du développement technologique.
Ainsi, penser l’esthétisation de la vie contemporaine, c’est revenir, inlassablement, sur la synergie, ou parfois la simple conjonction, observables entre d’un côté la recherche de petites communautés, ou tribalisme, le souci du territoire, l’attention à la nature, la religiosité, le plaisir des sens, et de la cyberculture et son utilisation . C’est ce que l’on observe dans le polyculturalisme, l’activité communicationnelle, ou les divers syncrétismes religieux et idéologiques, toutes choses faisant la spécificité des mégapoles postmodernes . Pour reprendre un néologisme proposé par le physicien S. Lupasco et développé par mon maître et ami Gilbert Durand, ce mélange obéit à une logique « contradictorielle » qui n’entend pas dépasser les contradictions en une synthèse parfaite, mais au contraire les maintient en tant que telles. La post-modernité est bien une harmonie des contraires, ou hamonie conflictuelle.
Cette « coïncidentia oppositorum » d’antique mémoire, où le conflit, le désordre, le dysfonctionnement viennent conforter, en fin de compte, leurs opposés. En bref une organisation sociale qui ne reposerait pas sur la recherche de grandes solutions, sur la résolution des problèmes inhérents à toute vie en société, mais qui, au contraire apprendrait à s’en accommoder, qui chercherait à les utiliser pour un surcroît de vitalité.
C’est en cela que la socialité organique post-moderne inaugure une forme de solidarité sociétale qui n’est plus rationnellement définie, en un mot « contractuelle », mais qui au contraire s’élabore à partir d’un processus complexe fait d’attractions, de répulsions, d’émotions et de passions. Toutes choses qui ont une forte charge esthétique. C’est la subtile alchimie des « Affinités électives », bien décrite par Goethe que l’on transpose ici dans l’ordre du social. Ou encore la sympathie universelle de l’homme avec son environnement naturel, qui conforme son empathie particulière avec l’environnement communautaire.
Cela peut paraître quelque peu abstrait, et pourtant nombre d’attitudes caritatives, d’aides associatives, de partage du travail, de petites sociabilités de voisinages ou de « prises en charge » dans le cadre de la proximité sont sans cela incompréhensibles. Il en est de même de la constitution de groupes de vie, des petites communautés électives, des tribus urbaines, ainsi que des cultures d’entreprise ou autres formes d’esprit maison qui, dans tous les domaines, se développent d’une manière plus ou moins éphémère. Et que dire enfin de ces grandes manifestations religieuses, quelques unes fanatiques et, on le sait, guerrières, qui ne sont pas sans effet dans l’ordre de la politique nationale ou internationale. Tout cela baigne dans une ambiance affectuelle, émotionnelle qui rend bien difficile l’analyse ou l’action simplement rationnelle. Tout cela est de l’ordre d’une éthique de l’esthétique !
Tel un patchwork, la post-modernité est faite d’un ensemble d’éléments totalement disparates qui établissent entre eux des interactions constantes faites d’agressivité ou d’amabilité, d’amour ou de haine, mais qui n’en constituent pas moins une solidarité spécifique qu’il faut bien prendre en compte. Tant il est vrai, et je suivrai ici une analyse très souvent formulée par M. Weber, qu’avant de devenir méthodiques et rationnels, les grands types de vie sont caractérisés par des « présuppositions irrationnelles » qui sont vécues telles quelles et progressivement incorporées dans les modes de vie. Je pense qu’il vaut mieux dire présuppositions « non-rationnelles », car elles ont leurs raisons propres. Mais ce qui est certain quand on observe le devenir de la civilisation chrétienne, les grands évènements politiques qui ont fondé la modernité, tels la Révolution française, ou encore les évolutions des grandes idéologies qui ont marqué l’histoire des idées, on ne peut qu’être frappé par la charge affective qui, pour le meilleur et pour le pire, préside à leur développement.
C’est en ce sens que la dimension esthétique peut être un bon angle d’attaque pour apprécier le grouillement vitaliste, qui d’une manière polymorphe, s’esquisse contemporainement. Le désengagement politique, la saturation des grands idéaux lointains, la faiblesse d’une morale universelle, peuvent signifier la fin d’une certaine conception de la vie fondée sur la maîtrise de l’individu et de la nature, mais cela peut également indiquer qu’une nouvelle culture est en train de naître. En tout cas tous les éléments sont rassemblés pour nous le laisser croire.
Il faut admettre l’idée qu’en tout moment culturel fort, quand il y a renouveau civilisationnel, l’esthétique se change en éthique.
Il convient de le rappeler, la morale est universelle, applicable en tous lieux et en tous temps, l’éthique au contraire est particulière, parfois momentanée, elle fonde une communauté, et s’élabore à partir d’un territoire donné, que celui-ci soit réel ou symbolique. Ce qui fait que peuvent exister des « immoralismes éthiques », qui ne manquent pas de choquer les belles âmes, toujours prêtes à se comporter en censeurs, mais qui n’en constituent pas moins une solide « reliance ». Il s’agit là d’une nouvelle forme du lien social qui mérite attention, car s’il est bien évident que les éthiques particulières qui, ici et là voient le jour, ne sont immorales que dans des cas paroxystiques, elles sont la plupart du temps amorales ou, à tout le moins relatives. La constatation de Pascal : « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au delà », s’est de nos jours généralisée. Les plus sûres des convictions voisinent sans trop de heurts avec leurs opposées, et les prescriptions les plus rigides doivent s’accommoder d’une multiplicité de transgressions, qui ne sont même plus ressenties comme telles par ceux qui les pratiquent.
Cela tient, insistons là-dessus, à ce que prévaut le sentiment ou le sensualisme en leur expression commune. Sentiment ou sensualisme qui conforte tel ou tel groupe donné. La référence à quelques situations historiques, et précisément à la pensée hellénique primitive, montrera que la séparation entre éthique et esthétique est, somme toute, récente et jamais constante. Même dans le christianisme qui, généralement, oeuvra pour qu’une telle distinction s’impose, on trouve, d’une manière récurrente, des poches de résistance qui s’emploient à les maintenir unies. Comme le montre, avec érudition, Gilbert Durand, le franciscanisme, en son moment naissant en Italie, est du nombre. Mais également la sensibilité baroque qui peut aider à comprendre comment l’existence en son entier tend à devenir une oeuvre d’art. Ainsi en parlant de baroquisation des sociétés contemporaines, j’entends montrer que la jouissance peut être vécue comme une manière de s’approprier le monde, et ce à l’opposé des doctrines ascétiques, pour lesquelles celui-ci ne peut qu’être maîtrisé par la production.
Ce qui revient à dépasser la trop stricte distinction établie entre la jouissance et l’action, ou l’esthétique et la morale ; distinction qui engendra les divers impératifs moraux que l’on sait. Pour ne prendre qu’un exemple qui paraît bien éloigné d’une telle perspective, il semblerait que même dans le grand domaine de la vie productive s’esquisse une conjonction entre le plaisir et le travail. Les cadres de haut niveau à qui on apprend à vivre ensemble une vie d’aventure, ce que l’on appelle la priorité de la « communication » dans l’entreprise, les week-end organisés par ces mêmes entreprises, ou tout simplement les groupes affinitaires qui se forment au bureau ou à l’usine, et dont on va se servir pour conforter l’esprit d’équipe tout cela plaide en faveur d’une telle conjonction. Et que dire des micro-entreprises qui se créent sur une base essentiellement affectuelle ! Etant bien entendu qu’il s’agit là d’une tendance qui prend une autre ampleur dans les autres domaines de la société.
Tant en ce qui concerne la politique, la vie universitaire, le monde journalistique, et l’on pourrait à loisir poursuivre la liste, on peut observer la prégnance de ce que Freud appelait les « liens libidinaux », et qui favorisent les multiples attractions-répulsions dont sont pétries toutes les agrégations qui composent la vie sociale. Cela a toujours existé, pourra-t-on rétorquer. Certes, mais leur intensité s’accroît, jusqu’à devenir un paramètre essentiel sans lequel il n’est plus possible de gérer quelqu’organisation ou institution que ce soit. Les clans, les cliques, groupes de pression, et diverses « tribus » qui les constituent sont certainement les expressions les plus achevées de ce que j’appelle ici l’éthique de l’esthétique.
En d’autres termes, on est confronté à un « primum relationis », c’est à dire qu’au delà ou en deçà de l’idéal, de l’idéologie, de la science, du service public, de la démocratie, sans parler d’autres valeurs plus particulières comme le socialisme, le libéralisme, le marché, le social, ou tant d’autres entités que l’on mettra en avant pour légitimer une pratique, ce qui va prévaloir c’est l’implacable loi tribale qui façonnera la pensée et l’action en fonction de l’appartenance groupale autour d’un héros éponyme. La personnalisation à outrance de la politique, du journalisme, de la science, est à cet égard éclairante.
C’est ce qui m’amène à proposer une « logique de l’indentification » qui remplacerait la logique de l’identité qui a prévalu durant toute la modernité. Alors que cette dernière reposait sur l’existence d’individus autonomes et maîtres de leurs actions, la logique de l’identification met en scène des « personnes » (persona) aux masques variables, qui sont tributaires du ou des totems emblématiques auxquels ils s’identifient. Celui-ci pourra être un héros, une star, un saint, un journal, un gourou, un fantasme ou un territoire, l’objet importe peu, ce qui est essentiel c’est l’ambiance magique qu’il sécrète, l’adhésion qu’il suscite. Il y a de la viscosité dans l’air, ou pour le dire d’une manière plus jargonnante, à l’autonomie succède l’hétéronomie.
Je le répète, il n’est pas question de juger un tel processus, cela n’est pas le lot de la pensée, mais bien plutôt d’une part de le décrire, et d’autre part d’en cerner, au mieux, la logique. D’autant que celle-ci peut avoir des qualités propres.
Une d’entre elles pourrait être la forme ludique. En effet, et nous sommes bien là dans l’ambiance esthétique, l’identification et le groupe qu’elle impulse, favorisent le jeu. Dès le moment où il y a multiplicité de petits clans, il y a compétition, concurrence et tournois de divers ordres. Ainsi le jeu est bien sûr au centre de l’activité sportive, dont la montée en puissance est un indice intéressant, il est également omniprésent dans l’efflorescence et la diversification des jeux de société mais, par une ruse assez compréhensible, cela aboutit à ce que la société elle-même devienne jeu. Jeux de simulation, jeux électroniques, jeux de bourses, jeux politiques. Quels sont les domaines qui échappent à ce Monopoly généralisé ? Cela est co-structurel au processus d’identification. Dès le moment où le but, l’objectif n’est qu’un vain mot, et que la distinction entre groupes tient surtout au totem auquel ils s’agrègent, l’enjeu est le gain immédiat. Le gain du pouvoir, de la reconnaissance, de la notoriété etc… est avant tout « présentéiste ».
C’est ainsi que dans un mouvement circulaire sans fin, l’éthique, ce qui agrège au groupe, devient esthétique, l’émotion commune, et vice versa. Il y a une symétrie entre ces deux pôles, et c’est le courant qui passe entre eux qui détermine la plus ou moins grande intensité de l’existence. D’où, quand le jeu semble se calmer, la nécessaire relance, fût-ce à partir d’une situation ou d’un fait anodin, afin que la partie reprenne. Le spectacle se généralise, et le spectateur en redemande, voilà définie l’orbe du ludique. Il n’y a pas forcément lieu de s’en lamenter; comme cela s’est vu à d’autres époques, il est possible que cela induise une culture, c’est à dire une manière d’être spécifique. En tout cas, du règne de l’apparence à la logique de l’identification, en passant par la revalorisation de la nature et des sens, mon chemin de pensée s’emploie à dégager les grandes caractéristiques d’un « Homo Esthéticus » en train de (re)naître. Etant entendu qu’au delà des attitudes individuelles, par lesquelles s’exprime cette esthétique, ce qui est en jeu est bien une nouvelle donne sociale en son ensemble, un nouvel esprit du temps.
Afin d’éviter une dernière équivoque, je voudrais préciser que l’esthétique généralisée dont il est ici question, ainsi que l’éthique que cela induit, ne sauraient être considérées comme des problèmes sans conséquences, comme des « danseuses » que la société peut se payer en des temps d’opulence. Au contraire, elles suscitent des questions urgentes, auxquelles on ne pourra impunément se soustraire longtemps. Mais il est évident que cela nécessite de savoir poser autrement les questions suscitées. D’où la critique qu’il faut toujours faire du « moralisme intellectuel ». Tant il est vrai qu’il s’agit là d’un penchant naturel, toutes tendances confondues, pour ceux qui font profession de penser.
Il s’agit, en quelque sorte de retrouver un rapport à la vérité qui selon le dernier message de Michel Foucault ouvre sur « une esthétique de l’existence », ce qui permet d’intégrer « l’usage des plaisirs » dans la compréhension de la vie sociale. Cela a pu être fait pour certaines périodes de l’histoire, ainsi pour la civilisation hellénique, ou encore pour « l’homo ludens » médiéval (Huizinga). Pourquoi ne pourrions-nous pas l’appliquer aux sociétés qui sont les notres ? Certains, comme G. Simmel s’y sont employé au début du XXe siècle. Ce qui a fait accuser ce dernier d’élaborer une « sociologie d’esthète ». Or son oeuvre, sortie du purgatoire, est des plus pertinente, des plus prospective aussi pour comprendre l’évolution de la culture. C’est sous son égide que je me situe, en montrant qu’une éthique peut jaillir d’une esthétique.
Cela amène à prendre le risque d’une pensée inutile. Sachant bien que le fait de ne vouloir point servir directement, est souvent la garantie d’une fécondité à plus longue échéance. Cela permet, à tout le moins, de relativiser certaines urgences illusoires, et de mieux prendre la mesure de ce à quoi il convient d’être attentif, en particulier toutes ces choses anodines qui, par sédimentation, constituent la trame de la socialité banale.
Cela s’inscrit dans la recherche d’une « vita contemplativa » qui est une part non négligeable de la démarche intellectuelle de tous temps, . Et que l’on voit parfois ressurgir, avec plus de force, lorsque l’on a mesuré les limites des divers engagements politiques obnubilés par un « économicisme » à courte vue . Il s’agit là d’un détour qui, curieusement, ne manque pas d’être prospectif, tant il est vrai que le recul permet de mieux visualiser le but, et par conséquent d’être plus assuré de tenir le cap. Ainsi ce n’est pas après-coup, selon la fameuse métaphore de l’oiseau de Minerve, mais bien « in actu », dans le présent même, que l’on peut signaler que ce qui se prétend d’une solidité à toutes épreuves est déjà une ruine, et ne présente aucun intérêt, sinon historique. Le fait de dire le présent, au moment où il se fait, n’a peut-être pas grande importance, sinon que s’adressant aux esprits lucides et exigeants, il les rend attentifs à ces nouvelles créations qui, au delà des formes et des pensées convenues, s’affirment avec force dans la vie sociale.
Voilà qui permet de comprendre l’infaillible art de vivre et l’inépuisable fécondité de toute socialité esthétique.
Michel Maffesoli
Professeur Émérite à la Sorbonne