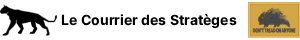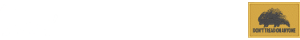La destitution de Macron ou le déféré de Philippe devant la CJR (Cour de Justice de la République) agitent beaucoup d'esprits en ce moment. Ces affaires sont à la fois sulfureuses, émotionnelles et... complexes juridiquement. Face à l'afflux de démarches "à ciel ouvert", un petit point de situation ne me paraissait pas inutile. Je le fais en marchant sur des oeufs et en demandant au lecteur de prendre le temps de bien rentrer dans les raisonnements. Et surtout en vous donnant rendez-vous sur le groupe Facebook "Rendez-vous au Procès".
La destitution de Macron ou le déféré d’Édouard Philippe devant la CJR (Cour de Justice de la République) agitent les esprits. À ce stade, plusieurs plaintes ont été déposées contre des membres du gouvernement et, selon mes informations, plusieurs centaines de procédures sont en instance sous une forme ou sous une autre, notamment par le référé-liberté proposé par Régis de Castelnau dont je parlerai plus loin. Que faut-il ou que peut-on en penser ?
Je me permets d’y répondre puisque j’ai moi-même commis une vidéo sur le sujet qui a dû, en moins d’une semaine, être vue environ 500.000 fois sur les réseaux sociaux et a fait l’objet de 14.000 partages sur le seul Facebook (et je vous propose de vous retrouver sur le groupe Facebook Rendez-vous au Procès).
Destitution de Macron ? Exprimer sa colère, c’est bien…
Beaucoup de Français rêvent d’une destitution de Macron tant ils sont en colère devant un pouvoir politique, et spécialement devant un monarque républicain qui a une fâcheuse tendance à traiter toute opposition ou toute divergence d’opinion avec des coups de menton et des tirs de gaz lacrymogène ou de LBD, de préférence dans le visage et à bout portant…
Cette colère est grande, et certains rêvent de l’exprimer par un grand procès qui commencerait par la destitution du président. Cette idée qui aurait paru loufoque il y a encore six mois, revient dans les conversations informelles sur les réseaux sociaux avec une insistance qui devrait inquiéter l’Élysée. Sur le seul Twitter, le hashtag #MacronDestitution occupe régulièrement, à titre d’exemple, le haut des tendances.
La chute du régime ne résultera pas d’un acte organisé
Ma position personnelle sur ce point est que, depuis plusieurs années, les présidents flirtent avec la rupture insurrectionnelle. Depuis Nicolas Sarkozy, les clivages et les antagonismes entre le peuple français et son président élu prennent rapidement des tours violents. Emmanuel Macron échappe encore moins à ce destin, et j’ai la conviction intime qu’il ne pourra finir son mandat dans des conditions normales.
L’engouement soudain pour ces procédures contentieuses menées collectivement est la voie que le désir de révolution qui existe en France a trouvée pour s’exprimer. Cette expression concourt à un nouvel affaiblissement du régime dont je me félicite. Mais il comporte des risques et des limites, voire des impostures.
À titre toujours personnel, je souhaite que ce régime, maintenu sous respirateur artificiel depuis 2002 et privé chaque jour un peu plus de légitimité populaire, tombe sans coup férir. Je souhaite un renouvellement profond des élites de ce pays, pour que la France retrouve sa grandeur.
En bon lecteur de Tocqueville, je ne crois en revanche pas un seul instant que cette chute se fera de façon légale, rationnelle, organisée, voulue. Elle sera un accident de l’histoire, qui interviendra au moment où le peuple français sera mûr pour faire tomber le fruit pourri qui se décompose sur sa branche. Ce moment est peut-être proche, mais personne ne le sait. De mon point de vue, il n’a que trop tardé.
Les procédures contentieuses dans ce contexte
C’est à cette aune-là que j’examine les différentes voies contentieuses qui s’offrent aux citoyens et la mise au point est essentielle, même si, pour les gens peu accoutumés aux questions judiciaires ou juridiques, le sujet est à la fois ardu et complexe. Dans la pratique, la judiciarisation de la politique à laquelle beaucoup poussent aujourd’hui est un sujet explosif, et ceux qui maîtrisent les arcanes de cette question ont la responsabilité de disséquer calmement le sujet pour éviter les entourloupes.
Pour ma part, je les examine avec la conviction que l’engouement soudain pour ces procédures menées collectivement est la voie que le désir de révolution qui existe en France a trouvée pour s’exprimer. Cette expression concourt à un nouvel affaiblissement du régime dont je me félicite. Mais il comporte des risques et des limites, voire des impostures, sur lesquels il faut éclairer chacun.
Je vais essayer de m’y employer un peu longuement.
L’invraisemblable destitution de Macron
Peut-on destituer Macron par un grand procès public ? Réglons immédiatement cette question par le rappel de ce que dit l’article 68 de la Constitution. Dans la pratique, le Président peut être destitué « en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ». La destitution est prononcée par une Haute Cour dont la composition et le fonctionnement sont définis par une loi organique promulguée sous Manuel Valls plutôt floue.
Dans la pratique, la destitution du Président est une procédure purement parlementaire, qui suppose l’aval de l’Assemblée Nationale et du Sénat, avec une majorité renforcée des deux tiers et un rôle moteur du président de l’Assemblée. La Haute Cour est composée de parlementaires et non de juges professionnels.
Inutile de dire que, en l’état des forces politiques, la destitution de Macron n’a aucune chance d’aboutir. Dans tous les cas, elle ne peut s’appuyer sur une procédure judiciaire lancée par des citoyens. Elle suppose, quoi qu’il arrive, un manquement du Président « manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ». Le caractère manifeste du manquement sera difficile à établir, même s’il existe dans l’esprit de beaucoup de Français.
Déférer Philippe devant la CJR ? Le rêve et la réalité…
Dans la foulée des aveux maladroits (et toxiques) d’Agnès Buzyn sur le fait que le gouvernement avait été prévenu, en janvier, de la gravité de l’épidémie qui s’annonçait mais n’avait pas réagi de façon satisfaisante, plusieurs plaintes sont déposées contre le Premier Ministre pour un déféré devant la Cour de Justice de la République. Une pétition lancée sur Change.org a déjà recueilli plus de 300.000 signatures pour soutenir la démarche d’un collectif rassemblant 600 médecins exposés à la contamination du fait de la pénurie de masques FFP2.

On touche ici du doigt la saine colère du peuple français contre les manquements de l’État, et singulièrement du gouvernement, dans la gestion des affaires publiques. Signer cette pétition, c’est soutenir le collectif des soignants, et politiquement ça fait du bien à ceux qui partagent une indignation compréhensible. On comprend par ailleurs que les soignants qui sont envoyés « au front » avec des protections insuffisantes alors que la crise était anticipable demandent des sanctions.
Juridiquement, en revanche, cette procédure est peu réaliste, et la soutenir ne lui apporte aucun avantage technique. Il est, en l’état du droit, à peu près impossible que la Cour soit réunie à la demande d’un collectif qui dénonce un manquement sans établir de préjudice précis. La procédure suppose, dans tous les cas, qu’une commission des requêtes statue sur la recevabilité des plaintes avant de poursuivre. Si, ce qui est peu probable, les plaintes étaient jugées recevables en l’état, une instruction aurait lieu. Elle durerait plusieurs années.
Émotionnellement et politiquement, cette voie contentieuse est importante et sert de défouloir aux passions. On l’approuvera donc, mais en se demandant si l’enjeu consiste aujourd’hui à se défouler ou à agir. Chacun aura sa doctrine sur ce point.
J’ai pour ma part de l’empathie et de la sympathie pour ce mouvement, mais je ne vois pas l’utilité de dépenser de l’énergie dans une mécanique qui sera, au mieux longue et se dénouera bien après la bataille à mener, et qui, au pire, sera déboutée parce que, juridiquement, elle ne tient pas la route.
La voie du référé-liberté…
Une autre voie est celle annoncée notamment par Régis de Castelnau, qui consiste à saisir le Conseil d’État pour qu’il enjoigne au gouvernement d’agir.
Régis a publié sur son blog un mémoire-type à déposer au Conseil d’État, que vous pouvez reproduire librement et déposer vous-même, au besoin devant le tribunal administratif dont vous dépendez. La procédure est précisée sur le site du Conseil d’État. Elle ne suppose pas de recours à un avocat.
Visiblement, la démarche de Régis de Castelnau a remporté un certain succès puisqu’elle a d’ores et déjà embolisé les services du Conseil. C’est probablement sa principale utilité : politiquement, elle constitue un puissant moyen de bloquer les institutions et de semer une forme de panique au sommet de l’État qui obligera le gouvernement à réagir.

D’un point de vue juridique, la démarche soulève toutefois quelques questions bien connues des initiés.
La première tient à la doctrine des actes de gouvernement en vigueur au Conseil d’État. Ce dernier, historiquement considère en effet que son action ne peut en rien être assimilée à un gouvernement des juges. Notre juridiction souveraine en droit administratif s’abstient donc de traiter juridiquement des décisions politiques. C’est un point important de notre démocratie.
Lorsque Régis de Castelnau demande au Conseil d’État d’enjoindre au gouvernement de nationaliser les sociétés Famar et Luxfer, il se situe à cette frontière des actes de gouvernement qui exposent son référé-liberté à être déclaré non-recevable.
Une deuxième raison bien connue des initiés est que les injonctions du Conseil d’État sont traitées avec légèreté par le gouvernement, notamment dans le domaine sanitaire. Ainsi, en son temps, le Conseil avait enjoint à Marisol Touraine de faire respecter le Code de Santé publique qui donne au ministre le pouvoir d’enjoindre aux laboratoires pharmaceutiques de fabriquer les vaccins obligatoires (que d’injonctions…). La ministre Touraine avait boudé l’injonction et changé la réglementation pour rendre les onze vaccins demandés par Sanofi obligatoires.
La voie préférable du plein contentieux en responsabilité de l’État pour son inaction
Les deux raisons que j’ai évoquées plus haut indiquent que les référés-libertés déposés en masse, individuellement ou collectivement, ont peu de chance d’aboutir (encore que… certains motifs peuvent probablement être admis par le Conseil). Mais ils présentent l’avantage de bloquer politiquement les institutions et donc de favoriser leur nécrose.
Ceux qui, toutefois, veulent une action juridique qui a du sens se pencheront plutôt sur le contentieux dit de la responsabilité de l’État du fait de son inaction, qui suppose le ministère d’un avocat et se déroule devant le tribunal administratif.
Cette procédure a, l’an dernier, abouti à Montreuil dans le cas d’un préjudice causé par l’inaction de l’État en matière de pollution de l’air. En l’espèce, une maman a plaidé que l’État était responsable des problèmes respiratoires de sa fille. Contrairement à ce qui fut dit à l’époque, cette décision n’était pas nouvelle. En 2006, le neveu de Michel Charasse avait fait condamner l’État pour le non-remplacement d’un professeur de philosophie au lycée.
Cette procédure est donc assez ancienne, et elle a, dans l’affaire du coronavirus, de bonnes chances d’aboutir. Elle est juridiquement plus prometteuse que la saisine de la Cour de Justice. En revanche, elle est forcément individuelle, évalue des préjudices personnels, suppose d’avoir un avocat, et prend du temps.
On est loin de la justice expéditive qui ferait éclater la vérité et imposerait la justice au gouvernement.
Le juge peut-il se substituer au politique ?
En ces temps de grande angoisse, je n’ignore pas que beaucoup de Français rêvent de cette justice expéditive. C’est d’ailleurs un peu une manie culturelle, déjà pratiquée sous Vichy avec le procès de Riom, où la gestion de Léon Blum fut mise en accusation.
Le précédent de Riom doit faire réfléchir, car il a illustré les dérives auxquelles un gouvernement des juges peut aboutir. Le rôle de la justice est de juger les différends et de réparer les préjudices. Il n’est pas d’arbitrer l’histoire ni de se substituer au vote des citoyens ou aux délibérations des assemblées.
Lorsque ce genre de confusion commence, les libertés publiques et la démocratie prennent des risques, car tout le monde s’expose à la possibilité de voir une opinion libre transformée en une faute punissable. C’est le début de la tyrannie.
Finalement, quelle voie préférer ? Quelle solution retenir ?
À titre personnel, ma position est donc qu’il existe deux catégories de personnes aujourd’hui en France.
La première regroupe ceux qui subissent ou subiront un préjudice personnel du fait de l’incurie patente du gouvernement. Ceux-là doivent préparer un dossier de recours contentieux engageant la responsabilité de l’État et éviter soigneusement la saisine de la Cour de Justice, qui pourra venir dans un second temps.
Pour mener à bien cette opération, il faut faire masse autant que possible des témoignages concrets et circonstanciés sur ces manquements. Pour faciliter cette opération, je vous propose d’adhérer au groupe Facebook Rendez-vous au Procès.
La deuxième catégorie regroupe ceux qui n’auront pas subi de préjudice personnel du fait du naufrage de l’État. Ceux-là peuvent, s’ils sont en colère, soutenir moralement les victimes effectives qui intentent une action juridique. La pétition qui circule est faite pour ça. Mais leur donner l’illusion que la justice serait un espace pour exprimer leur colère politique est une erreur et une façon à mon avis coupable de neutraliser l’énergie qu’ils ont envie de dépenser pour faire progresser leur cause.
Dans un monde bien ordonné, une colère politique doit déboucher sur une action politique et non juridique. En bref, si une majorité de Français ne supporte plus son gouvernement et considère que celui-ci met le pays en danger, il faut descendre dans la rue pour le déposer. Et non emplir les tribunaux.