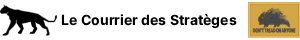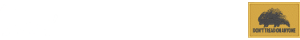C'est devenu un truisme que de débusquer du (néo-)libéralisme dans toutes les sauces du multilatéralisme ambiant. Non seulement l'Union Européenne serait le repaire de tout ce que le libéralisme compte comme suppôts en Europe, mais ce serait aussi le cas du FMI, de l'OCDE, et de nombreuses autres institutions dirigées par des technocrates amis de l'intervention publique à tout crin. L'Etat-nation serait en revanche le dernier rempart de la défense collective ou collectiviste contre la vague de libéralisme. Beaucoup de prétendus libéraux sont eux-mêmes convaincus de ce partage des eaux totalement scholastique. En relisant les grands auteurs libéraux du siècle dernier, on peut au contraire penser que l'Etat-nation est devenu le rempart fondamental de l'ordre spontané cher à Hayek, et que les institutions multilatérales sont aujourd'hui les fers de lance d'une nouvelle forme de planisme international, à rebours du libéralisme.

Le multilatéralisme est devenu la réserve de chasse privilégiée pour tout ce que l’opinion compte de gauchistes, de socialistes, de « gaullistes », de souverainistes, convaincus que l’éradication de ces animaux nuisibles appelés « les libéraux » règlera magiquement tous les problèmes et permettra aux Etats de dépenser sans compter et en toute impunité au nom du bonheur universel. Il suffit de parcourir les commentaires acérés sur les sites « alternatifs » pour comprendre que « le néo-libéralisme de l’Union Européenne » est considéré comme l’origine de tous les maux. Et nous n’épiloguerons pas ici sur les croyances confuses et naïves à propos des prêts à taux zéro des banques centrales aux Etats pour éviter toute forme de gestion sérieuse des services publics.
Le propos de cet article n’est pas de dire que ces gens ont tort de dénoncer les effets du multilatéralisme, et en particulier de l’Union Européenne. Il est de préciser surtout que l’Union Européenne est en réalité aux antipodes du projet libéral. Et de rappeler aux libéraux que la meilleure expression de l’ordre spontané cher à Hayek est aujourd’hui garantie par les Etats-nations et non par les structures multilatérales.
Pourquoi on confond multilatéralisme et néo-libéralisme
En vérité, la confusion entre multilatéralisme et néo-libéralisme n’est pas sans fondement, pour deux raisons principales.
La première raison, systémique voire philosophique, tient au fait que, tout particulièrement dans l’immédiat après-guerre, les libéraux (et pas seulement les
néo-libéraux) ont volontiers nourri une critique de fond contre l’Etat-nation en général. C’est particulièrement vrai de l’école autrichienne, où un Hayek et un Popper ont dénoncé l’Etat-nation comme le meilleur ferment du totalitarisme (qu’il soit national ou simplement socialiste).
Le 8 mai 1945, il est assez facile de comprendre que beaucoup en Europe aient vu dans la nationalisme étatique la cause du désastre qui a détruit le continent. On peut aussi comprendre qu’ils aient identifié dans le planisme ambiant (terme générique sous lequel nous regroupons la pensée sociale-démocrate étatiste) la première marche vers l’exalation d’un totalitarisme national.
Une deuxième raison à la confusion entre néo-libéralisme et multilatéralisme tient à l’objectif affiché de nombreuses institutions multilatérales, comme celles que nous avons citées, mais nous pourrions y ajouter l’OMC, la BRI, et beaucoup d’autres encore. Tous ces organismes ont pour objectif de dégager progressivement des règles supra-nationales, et de disqualifier la faculté des Etats-nations à adopter des réglementations protectionnistes.
Forcément, tout ceci n’aide pas à faire le distingo entre ce qui relève du multilatéralisme, et ce qui relève du néo-libéralisme.
Comment le multilatéralisme a créé une technocratie planiste
Si l’on peut comprendre que dans le monde de 1945, qui est un peu le monde de l’année 0 du multilatéralisme, la disqualification des Etats nations ait paru la seule solution pour éviter un nouvel épisode d’horreur, le bilan à dresser de la séquence qui s’est alors ouverte donne désormais lieu au constat absolument inverse. Il faudrait évidemment remplir des tomes entiers pour discuter ce constat.
Mais plusieurs évidences s’imposent.
Première évidence : les structures multilatérales ont toutes, à des degrés divers (le plus élevé et le plus abouti étant l’Union Européenne) créé des technocraties incontrôlables qui élaborent des normes dans leur coin, au nom de leur idéal auto-proclamé, sans se référer aux volontés populaires. Ces technocraties auto-générées sont toutes convaincues d’être porteuses d’un idéal messianique de « société ouverte ». En réalité, elles fonctionnent comme des aristocraties qui foulent au pied les idéaux démocratiques nationaux.
Deuxième évidence : le combat contre le libre-échange et contre le protectionnisme mené par ces institutions est devenu le prétexte à l’instauration de normes administratives, de réglementations étouffantes, qui n’ont rien à envier aux règles étatiques qu’elles remplacent ou qu’elles chapeautent. Les innombrables règlements européens, destinés à créer un marché unique, en sont la preuve la plus flagrante. Depuis l’harmonisation de la présentation de l’huile d’olive sur les tables de restaurant, de Dublin à Nicosie, jusqu’à l’encadrement des grandes décisions fiscales, l’Europe a vécu le Grand Remplacement des bureaucraties nationales par une bureaucratie européenne.
Mais, au final, c’est toujours la bureaucratie qui dirige et entrave la concurrence.
Troisième évidence : le multilatéralisme est devenu, au fil du temps, le symbole et le vecteur d’une domination des peuples par une caste de « cadres », de « managers », « d’experts » qui se réunissent beaucoup entre eux, dégagent volontiers des « mainstream » entre spécialistes pour concocter des réglementations parfois surréalistes. Mais quelle est la place de la démocratie et de la souveraineté populaire dans cet exercice ?
Sur le fond, le multilatéralisme a confisqué le pouvoir et se comporte comme une élite guidant des peuples priés de ne plus se poser de questions sur leur avenir. L’acrimonie des « européistes » contre les Brexiters britanniques l’a montré.
Quatrième évidence : ces adeptes du multilatéralisme ont oublié leur idéal de libre concurrence au profit d’une doctrine du « big government » de plus en plus planiste. On en veut pour preuve les délires de l’OCDE sur la suppression des avantages fiscaux de l’assurance-vie en France. On se couche un soir avec un organisme multilatéral chargé de faire des études sur le développement économique, et le lendemain matin on se réveille avec un programme de gouvernement venu d’en haut, rédigé par des fonctionnaires élus par personne.
La réalité est que le multilatéralisme est devenu le véhicule d’un gouvernement économique mondial qui ne dit pas son nom, et qui s’abrite derrière des idéaux pacifistes pour soumettre les peuples à une caste de fonctionnaires.
L’Etat-nation, organe de l’ordre spontané des peuples
Trois quarts de siècle après le début de l’ère multilatérale, le bilan est celui d’un éternel recommencement. Les Etats-nations, qui paraissaient les organes du totalitarisme, redeviennent les moteurs de l’ordre spontané vanté par Hayek. Le multilatéralisme, qui devait ouvrir les sociétés, les ferment peu à peu. Il menace directement l’autonomie des « petites nations » qu’Hayek défendait.
Or on voit bien aujourd’hui que l’Etat-nation est devenu, pour une large part, l’espace privilégié d’expression pour le « populisme », pour la « démagogie », c’est-à-dire pour l’expression spontanée des désirs populaires. On peut le mépriser pour cette raison. Mais dans le conflit historique entre les castes dominantes qui écrasent la démocratie, et les castes dominées qui la réclament, l’Etat-nation est clairement investi de la fonction tribunicienne de représentation des intérêts populaires contre l’ordre multilatéral élitaire.
Au fond, il existe un conflit aujourd’hui entre le planisme vertical et autoritaire des élites distillé par les institutions multilatéral et le désordre spontané des peuples qui se cramponnent à leurs institutions nationales pour l’exprimer.
C’est un renversement complet de la problématique de 1945 !
Etat-nation : de quoi parle-t-on ?
Les libéraux « de souche », c’est-à-dire ceux qui n’ont guère de sympathie pour le néo-libéralisme aronien, et qui lui préfèrent le bon vieux libertarisme de Bastiat ou de l’école autrichienne, mettront beaucoup de bémol sur la notion d’Etat-nation, qui appelle de nombreux commentaires et de nombreuses prudentes réserves.
Il faut bien distinguer ici la nation comme expression spontanée d’un corps réel, composée d’individus réels, partageant des goûts communs et parfois une volonté commune (ce sujet fera l’objet d’un article bien plus détaillé), et l’Etat, qui est une structure bureaucratique destinée à dominer les pulsions individuelles, à les contrarier, à les ordonner pour garantir la tranquillité publique. La volonté de la nation entendue comme un agrégat concret, immédiat, de volontés individuelles, s’exprime spontanément dans une culture collective, mais pas dans une structure étatique, qui est par nature une organisation prédatrice dont la légitimité se limite aux fonctions régaliennes.
Cette distinction emporte de nombreuses conséquences que nous détaillerons dans un autre cadre. Mais retenons aujourd’hui le bon sens qu’il y a à prêter aux nations une légitimité populaire spontanée bien plus grande qu’aux institutions multilatérales dominantes.
Au fond, le plus ennemi du libéralisme aujourd’hui, c’est bien le multilatéralisme.