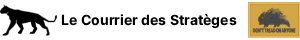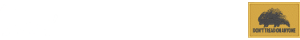Par Lionel Tourtier – Le Club des Investisseurs institutionnels de Long Terme a prévu de tenir un colloque au premier semestre 2022 sur le thème de « La grande Sécurité Sociale », avec trois tables rondes. Cet article engagé entend contribuer à alimenter la réflexion dans la perspective de cette manifestation.
Lionel Tourtier est le président de GENERATIONS E.R.I.C. (Epargne Retraite Investissement Croissance).

Ceux en France qui se présentent à l’élection présidentielle – et ils sont nombreux pour 2022 – devraient nous proposer un scénario d’évolution globale de notre société : la France à 10 ou 20 ans… En ces temps de « panne » de la démocratie représentative, nombreux sont les citoyens qui attendent une « vision politique » de l’avenir, incluant le fonctionnement démocratique et républicain du pays ainsi que son modèle économique et social. Les sujets majeurs de débat ne manquent pas : par exemple la souveraineté sous différents angles, l’ascenseur social, l’éducation, les relations internationales, la défense de l’environnement, etc., sans oublier un point essentiel qui est au cœur de la cohésion nationale : la protection sociale et notre système de santé.
Mais il n’en est pas (ou plus ?) toujours ainsi, en particulier depuis le raccourcissement du mandat présidentiel à cinq ans qui a singulièrement raccourci l’horizon du politique. Désormais, et pour des motivations plus électorales que réellement idéologiques au sens noble du terme, l’on voit des candidats se limiter à proposer aux citoyens un catalogue de mesures financières et techniques, déclinées selon des thèmes qui prennent en compte les inquiétudes immédiates de la population. Une façon de coller aux attentes du « terrain », ce qui rend difficile un consensus sur de grandes ambitions à moyen et long terme dont l’ampleur ne peut qu’exiger des sacrifices et des efforts. Depuis plusieurs décennies, le politique nous a habitué à reporter les choix difficiles… D’ailleurs, force est de constater que les programmes « en compétition » ne montrent pas toujours un ensemble cohérent de mesures. En réalité, peu des projets soumis au vote national posent la problématique du choix d’un modèle de société pour le 21ème siècle, alors que les défis à venir sont paradoxalement de nature très disruptive : révolution numérique, transhumanisme, transition énergétique, « passeport » génomique, etc.
L’évolution du rôle de l’Etat dans un cadre néolibéral
L’une des questions centrales à débattre est, selon nous, celle du rôle de l’Etat. Quelle est le choix proposé entre la poursuite d’un Etat « providence » (ou « Welfare State ») et le retour à un « Etat-gendarme » dont le rôle se limiterait strictement à des fonctions régaliennes (justice, police, défense nationale) ? Ou encore un mixte des deux : un Etat «mi-arbitre protecteur, mi-gendarme », mais dans quelle proportion entre ces deux composantes ?
Les contingences auxquelles notre pays est soumis expliquent peut-être ces difficultés : le poids de l’endettement qui obère les marges de manœuvre (on fait finalement la « politique de ses moyens »), les contraintes d’une harmonisation européenne à tout crin, dans un ensemble qui demeure hétérogène économiquement et politiquement ; ou encore les choix de politique de la BCE dans une zone euro de plus en plus fragile car ne réunissant toujours pas, depuis sa création, les conditions d’une « zone monétaire optimale ». Ces contingences ne sont pas limitatives…
En réalité, l’on ne sait pas vraiment où se situe le curseur des uns et des autres (Libéralisme ? Dirigisme ? …). Notre conviction (et bien sûr, elle peut largement faire débat avec les lecteurs), est que le néo-libéralisme a profondément modifié la façon dont l’Etat intervient depuis plusieurs décennies.
Précisons immédiatement les termes de ce postulat, car il y a une grande différence entre « libéralisme » et « néo-libéralisme ». Le courant politique « néolibéral » est apparu dans les années 30 avec Friedrich Hayek et l’« Ecole autrichienne ». Puis il a été relancé dans les années 80 avec l’« Ecole de Chicago », donnant naissance aux politiques menées par Thatcher et Reagan. A l’origine cette dernière doctrine promouvait la réduction drastique de l’État dans la vie économique et sociale, au bénéfice du secteur privé et des forces du marché, le tout sur fond d’une conception viscéralement individualiste. D’où l’expression d’« ultra-libéralisme ». Le sens du mot « néolibéralisme » a donc évolué dans le temps, ce qui peut prêter à confusion dans son utilisation. En outre, ce courant a subi des déviations selon les politiques menées dans les pays. Il n’y aurait pas un néolibéralisme mais plusieurs, ce qui entraîne une grande complexité dans l’analyse[1]. Ainsi que le souligne le professeur d’Harvard, Dani Rodrik[2], « Le fait que le néolibéralisme soit un concept insaisissable qui ne dispose pas d’un lobby explicite de défenseurs ne signifie pas qu’il soit insignifiant ou irréel ».
Ce qu’il faut retenir selon nous, c’est que ce courant de pensée a donné au rôle de l’Etat une orientation très particulière à partir de l’idée suivante : l’individu doit devenir « entrepreneur de lui-même » (d’où l’émergence du concept de « capital humain ») en faisant fructifier ses compétences et en développant sa capacité d’adaptation et d’innovation personnelle. Il est mis en compétition et devient donc un élément parmi d’autres d’un marché concurrentiel. Le néolibéralisme des années 80 a donc acté la naissance d’une nouvelle anthropologie, celle de « l’individu-entreprise. On comprend mieux ici le terme de « guerre des talents », largement utilisé de nos jours. Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres. Mais surtout, cela explique la montée en puissance de l’individualisme depuis les années 80 par rapport au collectif qui avait forgé les consciences sociales à la fin du 19ème siècle, et dont l’une des illustrations parmi d’autres pourrait être la Loi du 29 juin 1894 sur les « caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs ». Historiquement, et sans porter de jugement, ce que nous voulons ainsi montrer, c’est comment les valeurs collectives de solidarité du 19ème et de la première partie du 20ème siècle ont évolué vers des valeurs plus individualistes, voire libertaires, sans oublier des comportements plus consuméristes.
Alors que le rôle de l’Etat dans une conception strictement libérale est de se recentrer sur les fonctions régaliennes en assurant notamment l’ordre public, il prend, dans une conception néolibérale, une autre orientation, « plus globalement interventionniste », ce qui n’est pas sans soulever des contradictions : ainsi, l’action étatique viserait à promouvoir partout – y compris dans son propre fonctionnement et volontairement – une société de concurrence généralisée.
Cela soulève un premier paradoxe : pour assurer cette concurrence et surtout la fluidité du « marché » des « individus-entrepreneurs », l’Etat d’essence néolibérale doit (devrait) assurer un certain niveau de protection sociale et donc poursuivre une action de « providence ». Un second paradoxe existe : la montée en puissance d’une bureaucratisation[3] qui d’ailleurs ne se limite pas à l’Etat et à son administration mais touche aussi le monde de l’entreprise et son écosystème à travers une prolifération des normes, de procédures, etc. L’Etat néolibéral devient ainsi un « Etat-mammouth » dont le fonctionnement même se généralise aux différents acteurs économiques ! Du côté de notre chapelle, nous le voyons par le biais de la régulation excessive que la communauté des investisseurs institutionnels supporte tant bien que mal depuis plusieurs années.
La politologue Béatrice Hibou dans son ouvrage « La bureaucratisation du monde à l’ère néolibérale » explique que « la bureaucratisation néolibérale se comprend alors comme « une élaboration, un travail d’abstraction qui veut faire entrer la réalité complexe dans des catégories, normes, règles générales et formelles issues d’une pensée qui rationalise la société et le gouvernement des biens, des hommes et des territoires à partir du marché et de l’entreprise ». On retrouve également cette réalité au sein de la technocratie européenne, ce dont nous sommes sans doute nombreux à nous plaindre.
L’anthropologue et militant américain David Graeber[4] abondait en ce sens lorsqu’il écrivait en 2015 dans « Bureaucratie » : « Toute réforme de marché – toute initiative gouvernementale conçue pour réduire les pesanteurs administratives et promouvoir les forces du marché – aura pour effet d’accroître le nombre total de réglementations, le volume total de paperasse et l’effectif total des agents de l’Etat…[…]… A rebours de l’image répandue d’une vaste déréglementation et dérégulation, le capitalisme financiarisé multiplie les réglementations et régulations sociales. Les entreprises, consacrant la toute-puissance actionnariale, et les administrations, sous couvert de modernisation (le New Public Management en est un bel exemple !) baignent dans une même culture bureaucratique, ce qui implique de concevoir le marché, non pas comme un ordre spontané, mais comme une construction indissociable de son environnement administratif et juridique. En conséquence, la collusion entre le privé et le public, exemplifiée par l’ambivalence des lobbys, génère une inflation de règles scrupuleusement mises en application par une armée d’administrateurs ».
Le lecteur aura son avis sur ces considérations. Pour notre part, nous retenons cette argumentation pour la suite de notre raisonnement. Il est d’ailleurs intéressant d’observer que, dans leurs déclarations à la presse ou dans leur cadre d’exercice de leur fonction, bon nombre de responsables politiques et économiques, notamment parmi les chefs d’entreprise, font état de ce diagnostic de financiarisation de l’économie, de « sur-bureaucratisation » et d’inflation des normes.
« Débureaucratiser » notre pays ne peut être sérieusement envisagé que si l’on modifie en profondeur la financiarisation de notre économie. « Etat Néolibéral » et « capitalisme financiarisé » participent d’une même logique. Vaste ambition que de changer cette situation … Car il faut non seulement avoir une volonté d’airain face à des lobbys très bien organisés et puissants, mais disposer également de moyens politiques et financiers importants. Or, dans un Etat fortement endetté, donc avec une perte de souveraineté réelle, les marges de recadrage du capitalisme financiarisé sont très faibles. D’une certaine façon, cela nous renvoie par exemple au débat qui s’est installé très (trop ?) timidement en ce début d’année : faut-il rembourser la dette ? Hypothèse qui devrait intéresser au premier chef les investisseurs. Mais ils sont restés bien discrets, malgré la sollicitation du président de l’AF2I, Hubert Rodarie.
En résumé, retenons quatre éléments indissociables pour tenir un raisonnement pertinent quant à notre avenir : néolibéralisme et excès de bureaucratisation ; capitalisme financiarisé et excès de dettes… Tout ceci n’est pas exempt de contradictions, mais telle est la réalité. A méditer donc dans ces temps électoraux. Ceci précisé, nous pouvons aborder maintenant notre interrogation : allons-nous vers l’Etatisation totale de la protection sociale ? Le lecteur aura compris que nous faisons le lien entre « néolibéralisme » et « Grande Sécu », ce qui recouvre également feu le « Régime universel de retraite », sans oublier l’intervention de l’Etat dans la réforme de l’assurance chômage, dans la dépendance, etc. Etatisation, quant du nous tiens…
Mais au fait, à qui profite le néolibéralisme ? Patrick Artus, l’économiste bien connu de Natixis, s’est efforcé de répondre à cette question essentielle[5] et qu’il reconnait d’ailleurs comme complexe ainsi que nous l’avons nous-même souligné :
« Le capitalisme néo-libéral a organisé la déformation du partage des revenus au détriment des salariés et les délocalisations. Il en a résulté la faiblesse des hausses de salaire, la faiblesse des hausses de prix, la baisse forte des taux d’intérêt et la hausse des prix des actifs. On voit alors qu’il y a quatre gagnants du capitalisme néo-libéral : les actionnaires bien sûr, mais aussi les consommateurs, les emprunteurs et les détenteurs de patrimoine. Ces quatre gagnants constituent un bloc puissant au détriment des perdants qui sont les salariés : le capitalisme néo-libéral est encore solide ».
Un « Scénario 2 » qui fâche tout le monde …
Résumons maintenant la situation du projet « Grande Sécu ». Le Haut conseil sur l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM), créé en 2003, a lancé en 2021 un chantier sur l’articulation entre assurance maladie obligatoire (AMO) et complémentaire santé (AMC), avec quatre scénarios à l’étude. Or, le 12 novembre dernier, des éléments chiffrés ont été divulgués dans la presse, reprenant en particulier les données du scénario 2, dit de « Grande Sécu ». Ce « scénario 2 » prévoit de supprimer le ticket modérateur sur toutes les consultations ! Or, la majorité des membres du HCAAM n’avaient pas eu connaissance de ces informations dont l’examen était prévu pour les séances des 18 et 25 novembre ! Cela a provoqué l’ire de plusieurs institutions membres : la FFA, le CTIP, la FNMF, ainsi que les représentants des organisations syndicales et patronales et des syndicats de médecins (CSMF).
Lors de la tribune des présidents qui leur était consacrée à Reavie en octobre dernier, les trois fédérations professionnelles avaient déjà affiché leur unité pour critiquer les projets « d’étatisation » de la couverture santé. Le procédé de fuite dans la presse a été interprété par différentes parties prenantes comme une « manœuvre du ministre de la Santé », lequel aurait instrumentalisé sciemment le HCAAM dans le but de pousser le projet de « Grande Sécu ». Une proposition qui pourrait être au cœur du nouveau projet présidentiel d’Emmanuel Macron[6] … Face à cet épisode pour le moins contrariant pour les acteurs de la complémentaire santé, Florence Lustman, la présidente de la FFA, n’a pas manqué non seulement de soulever le problème de gouvernance du HCAAM, mais aussi de relever la partialité des chiffrages et des conclusions de cet organisme. Le CTIP et la FNMF ont également manifesté leur désapprobation. Tels sont les faits rapportés par la presse.
Le projet de « Grande Sécu » : une idée « programmatique » mais finalement relativement ancienne
L’idée de « Grande Sécu » n’est pas nouvelle ; tout comme d’ailleurs les frictions entre les gouvernements et les acteurs de la Protection sociale, en particulier ceux relevant de l’Economie sociale et solidaire. On se souvient notamment des échanges tendus, pour ne pas dire très difficiles, entre Marisol Touraine et Etienne Caniard lors du 41ème Congrès de la Mutualité en juin 2015. Certains militants mutualistes n’avaient d’ailleurs pas hésité à huer la ministre de la Santé. Un incident extrêmement rare et plutôt surprenant au sein d’un mouvement réputé proche de la gauche.
Il faut dire que, concernant un certain nombre de sujets, les arbitrages du gouvernement avaient été pour le moins défavorables aux mutuelles et à leurs adhérents : généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés, loi Le Roux sur les réseaux de soins, réforme de l’aide à la complémentaire (ACS), mise en œuvre du tiers-payant généralisé, contenu des contrats responsables… Derrière ce mouvement de colère, l’on pouvait cependant deviner les séquelles occasionnées, depuis plusieurs années, par un sentiment de défiance des pouvoirs publics envers le mouvement mutualiste. Historiquement, depuis la fin du XVIIIème siècle, l’histoire des relations entre le pouvoir politique et la mutualité n’a pas été un long fleuve tranquille. Malgré tout, cette école de la « solidarité collective » a toujours su triompher de nombreux obstacles et contraintes.
Toutefois, le facteur de tension le plus aigu nous semble désormais l’interventionnisme renforcé de l’Etat dans une tradition bien jacobine, voire aujourd’hui autocratique, alors que fondamentalement, le mutualisme est enraciné dans les territoires, donc la proximité, voire dans les branches professionnelles avec une représentation démocratique des adhérents. Ce dernier aspect explique d’ailleurs les liens « organiques » avec les IP (Institutions de prévoyance), lesquels ont souvent adopté le statut juridique du mutualisme pour développer certaines de leurs activités santé, tant au plan interprofessionnel qu’affinitaire à travers les contrats collectifs d’entreprise. Les deux types d’organisme sont régis par un statut non lucratif. Et le mutualisme a préfiguré le modèle du paritarisme à la française. Les organisations syndicales sont présentes dans les deux structures, ce qui n’exclut pas la concurrence entre ces institutions sur le marché des entreprises, mais dans le respect d’une forte préoccupation sociale. Denis Laplane, président du CTIP, soulignait récemment que les IP restaient très attachés au dialogue social et à la liberté contractuelle. Generations E.R.I.C. aussi.
Comment se manifeste cet interventionnisme de l’Etat ? Depuis la mise en place en 1996 de l’Ondam, le degré d’étatisation du système de santé français s’intensifie au nom de la maîtrise des coûts. C’est une démarche progressive mais qui peut être jalonnée par un certain nombre de mesures plaçant inexorablement l’organisation du système de santé sous contrôle public : généralisation du tiers payant, du contrat responsable, rôle accru des Agences régionales de santé, etc.
Les complémentaires santé ont été conçues à l’origine pour prendre en charge tout ou partie du ticket modérateur, c’est-à-dire la part des dépenses de soins non remboursée par la Sécurité sociale. Cela concerne également – point très important qu’il ne faut pas oublier dans l’analyse comme nous le verrons – les dépassements d’honoraires sur les actes médicaux. Mais les acteurs (assureurs, mutuelles et IP) ont vu, années après années, leur marge de liberté se restreindre au niveau des couvertures proposées et ce, malgré le caractère privé de leur organisation. L’harmonisation européenne, avec son lot de directives, orientées sur la notion de marché assurantiel concurrentiel, n’est pas non plus étrangère à cette réduction des couvertures, en fixant des règles de tarification qui s’éloignent de plus en plus du principe fondamental de solidarité propre aux assurances sociales. Dans ce prolongement, faut-il rappeler que l’impact de la régulation en solvabilité sur le coût des fonds propres des assureurs ne peut qu’entraîner des hausses de tarifs (ou des effets d’éviction), tout comme, d’ailleurs, la politique de taux d’intérêt négatifs de la BCE …
Lors du Congrès de la mutualité précédemment cité, Etienne Caniard résumait ainsi la situation : « Au contraintes fiscales, réglementaires, au renforcement des règles prudentielles s’ajoute désormais la fragilisation d’un modèle économique soumis aux excès d’une approche trop focalisée sur les prix, notamment pour les contrats aidés, contrats collectifs ou ACS, au détriment des contrats de droit commun de plus en plus difficilement accessibles ». Un constat partagé par les IP. Ainsi, l’on peut lire dans le rapport annuel 2020 du CTIP : « Sur 10 ans, en santé, on observe ainsi que les cotisations des IP (+1,8 % par an) ont évolué au même rythme annuel que la progression des dépenses (+1,6 % par an). En revanche, la fiscalité sur les contrats a progressé de 10 % sur la même période ». La Mutualité française a davantage poussé le trait en déclarant de son côté : « En France, les contrats santé sont taxés à hauteur de 15 % : comment se fait-il que la santé, bien essentiel, soit trois fois plus taxée que le hamburger ? ».
Bien sûr, le domaine de la santé n’appartient pas aux acteurs de la protection sociale et l’Etat a son rôle légitime à jouer autour de quatre axes traditionnels : l’organisation et la réglementation de protection de la santé, le contrôle des professions et des établissements qui l’exercent. Toute la question est de déterminer si l’on attend de l’Etat la définition des grandes lignes d’une politique de santé publique avec un accès aux soins pour tous ainsi qu’aux mesures de prévention, mais en laissant aux différents acteurs les marges de manœuvre nécessaire pour atteindre les objectifs fixés ; ou si l’on veut qu’il devienne l’opérateur principal, disposant de toutes les manettes, depuis le champ du médical jusqu’au remboursement des prestations.
Plusieurs médecins hospitaliers, experts, universitaires et même des sociologues poussent à cette forme de nationalisation de la santé, dans le plus pur esprit beveridgien dont l’archétype est le modèle de la Grande Bretagne … Nous en reparlerons. Leurs critiques envers le système actuel portent sur les coûts de gestion de l’AMC versus l’AMO et l’inégalité d’accès à la complémentaire qui existe pour une partie de la population. De son côté, la Cour des comptes en juillet dernier avait également dressé un constat assez sombre (« Le système français de couverture des dépenses de santé est coûteux, inefficient et en partie inéquitable ») et elle avait proposé des remèdes de nature étatiste.
Deux principaux reproches au système actuel : les coûts de gestion et l’inégalité d’accès
Pour apprécier la pertinence de ces critiques, il est nécessaire de rappeler quelques données de base. Le poids des complémentaires santé dans le financement total des dépenses de soins et de biens médicaux n’est pas très élevé : de l’ordre de 13 % du total des dépenses (soit 29 milliards d’euros sur un total de 203,5 milliards d’euros en 2018). C’est donc l’assurance maladie qui supporte la plus grande part des dépenses. Mais comme le souligne à juste titre l’expert et journaliste indépendant Jean-Claude Naimi, « cette prise en charge varie très largement selon les postes car si les assureurs santé sont en effet peu présents sur la prise en charge des soins hospitaliers (5 %), ils remboursent, en revanche, près de 75 % des dépenses d’optique et plus de 40 % des soins dentaires. Difficile, par conséquent, de les contourner si facilement ».
Pour appuyer leurs critiques envers le système français articulant l’AMO et l’AMC, deux arguments sont régulièrement avancés par les tenants de la « Grande Sécu » : le coût de gestion du dispositif actuel en raison d’une prétendue complexité et, surtout, l’inégalité de traitement qui existerait en défaveur de certaines populations : fonctionnaires, chômeurs et retraités. L’objectif du HCAAM vise ainsi à limiter le renoncement aux soins en offrant à tous une couverture à 100 %, tout en simplifiant les procédures de remboursement. La Grande Sécu serait la « solution » miracle pour remédier à ces maux « systémiques ».
Remarquons que ces deux arguments existaient aussi à l’appui du projet de réforme des retraites aboutissant à la création du « Régime universel » : la complexité, également facteur de coûts (assurance vieillesse et régimes complémentaires obligatoires), et l’inégalité du fait de l’existence de « régimes spéciaux » et des conditions de retraite des fonctionnaires jugées très/trop avantageuses. Coûts et inégalités seraient en fait les deux « mamelles de l’Etatisation ». Mais à l’épreuve des faits, l’on peut en discuter comme nous allons le voir.
Les détracteurs du système actuel s’appuient sur le fait qu’environ 4 % (seulement) de la population ne disposeraient pas d’une assurance complémentaire, ce qui est relativement faible puisqu’inversement 96 % en disposent ! Nous sommes dans le registre des quelques trains qui arrivent en retard, alors que ceux qui sont à l’heure sont très largement majoritaires… En outre, cette carence relative (4 %), dénoncée sous une tonalité quelque peu « émotionnelle » pour culpabiliser l’opinion, pourrait être supprimée par des mécanismes de solidarité, sans créer pour autant une « usine à gaz » sous le contrôle total de l’Etat et de son administration.
Par conséquent, pour renforcer cette argumentation d’inégalités, l’on se plait ainsi à dramatiser davantage le constat en soulignant que 10 % de ceux qui appartiennent au 1er décile de revenus et 13% des chômeurs sont pénalisés par cette absence de couverture. En outre, il y aurait des personnes, en l’occurrence les retraités, qui pairaient cher une protection sociale complémentaire tout en étant mal couverts. D’où des renoncements aux soins et conséquemment, des surcoûts lorsque l’assurance maladie doit financer trop tardivement leur traitement thérapeutique.
En fait, c’est surtout ce problème d’inégalités qui est le plus mis en avant pour justifier un système unique. Ce dernier aurait, selon les contradicteurs à la complémentaire santé, des coûts de gestion plus limités. L’on prétend ainsi que le surcroît d’efficacité viendrait de la substitution d’un dispositif unique de prélèvement et de versement à l’actuel système dual, d’où la réalisation de fortes économies d’échelle. A l’appui, tel économiste de santé observe du haut de sa chaire qu’un même dossier (oh surprise !) est traité à 2 reprises – une fois par l’Assurance-maladie, une autre fois par la complémentaire –, et que cela engendre des millions d’opérations en double tout en mobilisant du personnel – en particulier dans les hôpitaux. Alors, par rapport à un coût de 10 milliards actuellement, un système unique peut engendrer des économies. En outre, derrière ce chiffre, nous dit la Cour des comptes, se dissimulent des niches fiscales et sociales accordées aux salariés et aux entreprises pour plus de 7,9 milliards en 2019 ! « C’est trop important » avait déclaré de façon péremptoire le ministre Véran, le 22 octobre sur BFM-TV et RMC. De façon perfide, l’on précise que les surcoûts dénoncés proviendraient, des « dépenses de prospection, de marketing et de publicité » (40 % de ces presque 8 milliards). Haro donc sur la pub ….
En bref, puisque les coûts de gestion des assureurs santé sont jugés 4 à 6 fois supérieurs à ceux de la Sécurité sociale, donc supprimons les assureurs santé ! Dans ce prolongement, l’économiste Nicolas Da Silva estime que l’économie réalisée « pourrait être recyclée en gains de pouvoir d’achat au profit des ménages. » Une manne bienvenue en ces temps d’inflation. L’Etat providence dans toute sa splendeur. Pour financer les nouvelles dépenses transférées à l’assurance-maladie obligatoire, notre professeur indique que « les ménages seraient mis à contribution par le biais d’une hausse de la CSG, donc en fonction de leurs revenus… Ce mécanisme remplacerait les primes payées aux organismes complémentaires, qui, elles, tiennent compte de l’âge, mais pas des ressources. ». Inégalité, quand tu nous tiens …
Comparaison n’est pas raison
La piste de la « Grande Sécu » a suscité des désapprobations multiples et, bien sûr au premier chef, dans les rangs des complémentaires (FFA, FNMF, CTIP). Leurs dirigeants font valoir qu’ils supportent des coûts, liés au recouvrement des cotisations, qui ne sont pas comparables avec l’assurance-maladie car celle-ci en est exonérée. Ils dénoncent également la forte taxation que leur impose l’Etat. En outre, selon la FNMF, les coûts de publicité ne représentent que 0,2 % des cotisations payées par les adhérents ! On est donc loin des 40 %.
Mais reprenons plus en détail et pas à pas ces deux critiques. On ne peut nier effectivement qu’il existe des situations de précarité au sein de la population française. Mais l’Etat ne porte-il pas une certaine responsabilité dans cette situation, en ayant pris la décision de généraliser les contrats d’entreprise ? En outre, les chiffres produits pour argumenter une insuffisance de couverture ne peuvent que susciter un certain étonnement. Car une étude du CTIP sur les CCN de plus de 100.000 salariés (représentant 11 millions de salariés), ayant négocié une couverture prévoyance, montre que 1,2 million de salariés disposent, non pas d’une couverture minimale, mais d’une couverture maximale (incapacité, invalidité, décès, rente de conjoint, rente d’éducation et rente d’enfants handicapés). L’on note également que parmi ces branches professionnelles, ce sont 10 millions de salariés qui disposent au moins d’une garantie incapacité, invalidité et décès. Seul 1 million n’est couvert qu’en incapacité et invalidité, sans garantie décès.
Ensuite, le « reste à charge » des ménages est le plus bas des pays de l’OCDE ! En 2021, cet organisme international (dans « Panorama de la santé 2021 ») soulignait que pour notre pays « La couverture santé de la population est élevée, associée à une bonne satisfaction des patients et peu de besoins non-satisfaits ». A contrario, il regrettait que « le tabagisme et la consommation d’alcool en France demeurent bien plus élevés que la moyenne de l’OCDE ». Ce qui conduit logiquement à se demander si l’on ne devrait pas d’abord se focaliser sur le coût des addictions et des conduites à risque. En d’autres termes, concentrer les efforts sur l’amont et non pas sur l’aval. Pour mesurer cet enjeu, rappelons que le coût des drogues pour les finances publiques représente 1,1 % du PIB ! L’Etat doit chaque année payer respectivement pour l’alcool, le tabac et les drogues illicites, 4,9 milliards, 14 milliards et 2,4 milliards d’euros, soit plus de 21 milliards versus les 29 milliards de la complémentaire santé mentionnés plus haut. Par conséquent, prétendre que le système des complémentaires santé est peu efficace est une façon spécieuse de travestir la réalité. Plus globalement, si l’on peut faire de nombreuses critiques à notre système, il faut constater que les dépenses de santé par habitants pour la France sont plutôt en dessous de nombreux pays européens alors que l’espérance de vie reste supérieure à la moyenne de l’OCDE.
Graphique 7.4
Cela n’empêche pas qu’à chaque examen du PLFSS se répand l’opinion selon laquelle les complémentaires santé sont trop coûteuses pour les assurés français. Or, une étude de Tripalio dressant le bilan de la généralisation de la complémentaire santé de 2013 à 2017 avait montré que les gains de pouvoirs d’achat, permis par la mise en concurrence systématique des complémentaires santé dans la mise en œuvre des accords de branche, avaient été d’environ 750 millions d’euros annuellement …
Certains experts se penchant sur les simulations du HCAAM ont également contesté plusieurs éléments chiffrés en relevant des incohérences. Ainsi, si l’on prend le montant que versent chaque année les complémentaires santé (les 29 milliards d’euros), la reprise des dépenses de santé par l’AMO retenue par le HCAAM ne serait que de 19 milliards ! Qui va financer les 10 milliards restants ? Les ménages, qui verront ainsi leur reste à charge fortement augmenter parce que les dépenses non reprises par l’AMO ne seront plus assurables ou alors à un prix dissuasif puisque l’effet de mutualisation ne jouera plus suffisamment. Second point : financée majoritairement par l’AMC, l’offre 100 % santé pour l’optique, l’audiologie et les prothèses dentaires patira certainement d’un reste à charge accru, avec là encore un chiffre sous-évalué par le HCAAM. Ensuite, transférer les activités des complémentaires santé à la Sécurité sociale pose la question du maintien dans l’emploi des 100.000 salariés qui, selon la FFA, travaillent chez les assureurs santé. Rejoindront-ils le cortège des chômeurs ? Quelle perspective dramatique pour des organismes dont la dimension sociale est consubstantielle à leur existence. Est-ce bien là le rôle de l’Etat que de provoquer de telles conséquences ?
Quant à ‘l’enfumage » des frais, pour reprendre le terme de Jean-Paul Benoît, le président de la Fédération des mutuelles de France, celui-ci apporte des explications concrètes et précises[7] : « Dans cette histoire, on juge nos mutuelles sur la base du plan comptable des sociétés d’assurance. Or, ce plan, taillé pour les sociétés de capitaux, n’identifie que des prestations monétaires. Aucune des autres prestations n’est prise en considération et n’est assimilée à des « frais de gestion ». Ces derniers sont subdivisés en trois parties : frais d’acquisition, frais de gestion des sinistres et frais d’administration. Comme rien n’est calibré pour des organismes comme les nôtres, qui délivrent aussi des prestations sociales en nature à leurs adhérents, on nous oblige à arbitrairement répartir ces prestations dans l’une de ces trois rubriques. Convenez que ça fausse singulièrement le raisonnement. C’est alors que les accusations pleuvent : frais de gestions trop élevés, dépenses de marketing somptuaires etc. ».
Jean-Paul Benoit poursuit sur les actions de prévention : « Alors quand on nous dit que les frais de gestions sont des dépenses indues, il faudrait préciser le réquisitoire. Qu’est-ce qui est indu ? Le développement des centres de santé sans dépassement d’honoraires et pratiquant le tiers-payant, dans un pays en proie aux déserts médicaux et où un quart des 18-24 ans renoncent à des soins pour des raisons financières ? Qu’est-ce qui est indu ? Les actions de prévention dans un système de santé qui peine à sortir du tout-curatif ? Vous le voyez, ce que l’on appelle les « frais de gestion » des mutuelles sert à permettre l’accès aux soins ; cela sauve des vies ».
Bien d’autres considérations pourraient être abordées au regard des évaluations du HCAAM, comme, par exemple, les pertes de recettes pour l’Etat de l’ordre de 10 à 11 milliards d’euros pour les taxes directes, et sans doute à beaucoup plus, au travers des contributions indirectes, à la suite de la forte contraction des activités.
En résumé, l’on pourrait penser que l’on a habillé le coupable avec des chiffres sur mesure pour convaincre l’opinion que la Grande Sécu serait plus efficace et moins chère… Cette argumentation faussement comptable laisse de côté tout une dimension que développent les acteurs du secteur des complémentaire. Ainsi, il serait judicieux de prendre en considération des apports plus qualitatifs, mentionnés par Jean-Paul Benoit mais non monétarisés. A cet égard, Thomas Saunier, le Directeur général de Malakoff Humanis, estimait il y a quelques temps que la valeur ajoutée des mutuelles peut facilement être démontrée par les « réseaux de soins » (Carte Blanche Partenaires, Itelis, Kalixia, Santéclair, Sévéane) avec lesquels des négociations permettent d’obtenir de meilleurs tarifs pour leurs adhérents : c’est le cas en optique mais l’on voit des démarches similaires avec les soins dentaires. De plus, les mutuelles discutent fréquemment avec les cliniques privées et les établissements de soins pour moduler le prix des chambres ou encadrer le prix du service médical.
Les complémentaires santé montrent une autre utilité vis-à-vis des patients : celle d’être présentes dans leurs parcours de soins[8] et, au-delà, dans les domaines de la prévention, ce qui est essentiel car potentiellement, cela participe d’une réduction des dépenses maladies, suivant le vieil adage « vaut mieux prévenir que guérir ».
Enfin, à l’aube de développements importants en matière de digitalisation des processus, il faut relever les capacités d’innovation et d’adaptation de ces organismes, avec des garanties ajustées aux besoins des différents « segments » de population.
Côté investisseurs institutionnels, pour ceux qui connaissent bien dans le détail les politiques d’investissements des assureurs, des mutuelles et des groupes de protection sociale, les encours concernant le financement de l’E-Santé par exemple (logiciels de télémédecine, solutions dopées à l’intelligence artificielle, objets connectés) ne cessent d’être en augmentation d’année en année[9]. En tant qu’ancien président du Jury des Couronnes Agefi-InstitInvest, l’auteur peut largement en témoigner[10].
En la matière, il n’est pas démontré que l’Etat soit un innovateur très actif. C’est plutôt le marché concurrentiel qui incite à des améliorations ou à la création de nouveaux produits ou formules.
La Grande Sécu, une idée pour les présidentielles qui commence à faire un flop !
Pour concrétiser l’idée d’une grande Sécu, il apparaît donc que le gouvernement, par l’intermédiaire du ministre Véran et dans l’optique des présidentielles, voulait passer en force, en s’appuyant sur le HCAAM dont on a vu que les travaux préparatoires péchaient par certaines omissions, voire des erreurs manifestes. Devant les vives réactions suscitées par le projet, il semble que le gouvernement ait mis de côté (pour le moment ?) cette idée, pourtant déjà ancienne comme nous l’avons indiqué. En d’autres termes, dans un autre contexte, l’on pourrait à l’avenir voir ressortir le lapin du chapeau…
Cela nous rappelle quelques souvenirs. En effet, pour ceux qui ont étudié en profondeur le projet de « Régime universel de retraite », on trouve quelques similitudes dans l’approche : des argumentations un peu courtes, de nombreuses imprécisions, et des questions sans réponses. Prenons un exemple : au regard de l’axiome présidentiel « un euro cotisé donne les mêmes droits », slogan certainement vendeur en termes de communication publique, l’analyse menée en avril 2019 par Deloitte et le Cabinet Sapiendo avait montré que c’était tout sauf simple … Ainsi que l’expliquait Valérie Batigne[11] à l’époque, « une grande source de divergences provient du montant de rémunération qu’il faut percevoir pour cotiser un euro ». Il faudrait donc faire en sorte, précisait-elle, qu’un euro gagné génère les mêmes cotisations pour tous. Or en 2019, un euro de gagné ne génère pas, selon les statuts, le même montant de cotisation ni les mêmes droits à la retraite.
Il y a donc une confrontation réelle entre des experts plus ou moins proches des pouvoirs publics (économistes et professeurs d’université, médecins hospitaliers, etc.), et les opérationnels assureurs qui ont une connaissance pragmatique des situations. Les premiers, qui entrent dans ce que l’on peut qualifier le « champ bureaucratique » (pour revenir à notre néolibéralisme à la française) sont très favorables depuis longtemps à une étatisation de la santé. Dans le contexte politique actuel, ils font feu de tout bois pour réduire la dimension concurrentielle sur le marché de la santé, et dont les grands acteurs résistent d’autant plus qu’ils prennent appui sur leurs valeurs mutualistes.
D’ailleurs, en 2019, Pierre-Louis Bras, un inspecteur général des affaires sociales familier de ces thématiques, et président actuel du COR, avait déclaré dans la revue « Les Tribunes de la santé » qu’il fallait vaincre « une coalition politique très large ». Les détracteurs des complémentaires ont donc poussé à un big bang du financement de la santé, en voulant profiter des prochaines élections présidentielles pour avancer leurs pions, et cela d’autant plus que leur projet aurait pu être de nature à séduire Emmanuel Macron qui, une fois réélu, aurait fait ainsi coup double : réformer les retraites et l’assurance maladie, les deux sources de nos déficits que fustige la Commission européenne… Quelle idée géniale ! Puisque la Sécurité sociale est en déficit alors que les mutuelles sont en excédent, jouons les vases communicants… Mais on l’a vu, tant la réforme des retraites que la Grande Sécu « ont pris l’eau », selon nous par excès d’idéologie et de technocratie.
Car ainsi que le « regrettait » Pierre-Louis Bras, les oppositions sont d’autant plus fortes qu’elles réunissent différents acteurs sociaux et économiques qui partent des mêmes constats. Mais n’est-ce pas là l’expression normale de la démocratie face à des velléités d’autocrates technocratiques ? Eric Chenut, le président de la Fédération nationale de la mutualité française exprimait récemment ses doutes sur un projet qui ne réglerait en rien les problèmes de fond de la Sécurité sociale : « Est-ce que ça va faire reculer les déserts médicaux ? Remédier à la raréfaction du temps médical ? Répondre au défi du vieillissement ? Régler le trou abyssal de l’assurance maladie ? ». Thomas Saunier, déjà cité, estimait quant à lui que « Notre modèle, avec une grosse couche de solidarité et une couche de liberté est vertueux. Il permet d’éviter une médecine à deux vitesses, comme on le voit dans les pays qui ont tout étatisé. ».
La présidente de la FFA, Florence Lustman, a également fait une mise au point relativement ferme, en particulier sur le projet du gouvernement d’une contribution exceptionnelle prélevée sur les complémentaires santé pour financer la Sécurité sociale en période de crise sanitaire : « Je rappelle que nous sommes des activités privées, soumises à une série de réglementations. Ce qui fait que, globalement, nous devons être équilibrés dans nos comptes, mais aussi alimenter nos fonds propres et donc dégager du résultat ».
Dans un Livre Blanc publié fin octobre, « Redessiner l’assurance santé au bénéfice d’un système créateur de valeur pour tous les Français », la FFA a fait plusieurs propositions : adapter le cadre réglementaire existant, notamment celui du contrat responsable, pour redonner aux assureurs des marges d’action et d’innovation au bénéfice des Français ; développer le champ des partenariats avec les professionnels de santé pour valoriser de nouvelles formes de prise en charge et d’accompagnement des Français ; redéfinir les territoires de prise en charge intégrale par les assureurs dans une logique d’efficience collective ; renforcer le partenariat État-assureurs dans les missions de prévention qui, à bien des égards, reste le point faible de notre système de santé ; élargir l’accès à une assurance santé essentielle à des publics susceptibles de renoncer aux soins en raison de revenus particulièrement limités, en adaptant la fiscalité.
Les organisations syndicales, FO, CFDT, etc. et les employeurs ne sont pas en reste quant aux critiques de la « Grande Sécu ». De nombreux professionnels de santé sont aussi sur la même ligne. Le président de la Confédération des syndicats médicaux français, Jean-Paul Ortiz, invoquait le fait que les dépassements d’honoraires, remboursés par les complémentaires, « sont indispensables à la survie de certaines spécialités en médecine libérale, en particulier la chirurgie et l’obstétrique, ainsi qu’à l’exercice dans certaines villes, comme Paris ». Qu’adviendra-t-il de la prise en charge de ces dépenses si une assurance-maladie à 100 % pour tous voit le jour ? ».
Par rapport aux dépenses d’assurance maladie en général, qui représentent environ 15 % des dépenses publiques, celles concernant l’hôpital public pèsent pour environ 50 %. Les complémentaires santé n’interviennent que pour 5 % dans le financement des dépenses hospitalières. La balle est donc plutôt à la Sécurité sociale et au gouvernement pour mieux gérer ces dépenses. Ce devrait être d’ailleurs la priorité des priorités. Sur la radio « Europe Matin », le 21 décembre dernier, le chef du service d’urologie de l’hôpital Cochin à Paris, Michaël Peyromaure, a dressé un diagnostic sans appel et à partir duquel il a énuméré plusieurs propositions pour « sauver le système » hospitalier français.
Ce professeur réputé a d’abord expliqué que l’argent octroyé par l’État (11% du PIB français, au-dessus de la moyenne des pays de l’OCDE) allait principalement dans la bureaucratie. « Dans notre pays, on a voulu absolument épargner aux patients d’avoir à contribuer. Nous sommes le pays où les soins sont les moins chers, avec un reste à charge le plus faible de l’OCDE (…). Pour préserver cette gratuité ou quasi-gratuité, il faut prendre ailleurs…[…]… Comme la bureaucratie s’est développée, et que la technostructure nous coûte beaucoup (d’argent), les efforts se sont focalisés uniquement sur les soignants. C’est pour ça que les salaires sont faibles, que les hôpitaux sont mal entretenus, que la consultation du généraliste ne vaut que 25 euros, etc. ».
Enfin, de nombreux sondages et enquêtes d’opinion ont montré ces dernières années que les Français étaient relativement satisfaits des complémentaires santé.
Quelques exemples édifiants de l’Etatisation de la santé…
Prenons l’exemple du système de santé britannique, le NHS en place en 1948, conforme aux principes beveridgiens. Selon l’opinion de la fondation Commonwealth Fund en 2017, les déficits des budgets des hôpitaux ne cessent de se creuser ; les patients sont toujours plus nombreux à devoir attendre plus de quatre heures avant d’être pris en charge aux urgences ; le personnel est insuffisant, comme le prouve le nombre croissant de postes non pourvus. Toujours selon cette institution, 44 % seulement des personnes interrogées en 2016 estimaient que le NHS fonctionnait correctement, contre 63 % en 2013. Le NHS étant financé par l’impôt, c’est l’État qui fixe le montant total des dépenses en pourcentage du PIB.
Nous sommes bien dans un modèle « comptable », ce qui traduit véritablement un choix de société, lequel mériterait s’il était institué en France, la tenue d’un débat démocratique. Car les conséquences sont loin d’être négligeables. En Angleterre, les chiffres avant l’épidémie du Covid montraient que 1,9% des patients avaient attendu plus de six semaines avant de passer des examens ; 9,7 % avaient attendu plus de 18 semaines avant d’être admis à l’hôpital ; et 19,5 % des personnes susceptibles d’être atteintes d’un cancer avaient dû patienter plus de 62 jours avant de commencer un traitement. On dénombrait 4 millions de personnes en attente d’être opérées… Après Brexit, l’on n’a pas encore de données statistiques, en particulier sur les postes non pourvus de soignants.
Si l’on prend maintenant l’exemple du système de soin du Canada, entièrement étatisé, la présidente de l’Institut économique Molinari, Cécile Philippe (PhD) soulignait dès 2016 les méfaits de cette politique qui aboutissait au rationnement des soins : « Des pénuries de médecins, un accès bureaucratisé aux nouveaux traitements et des délais d’attente signifient que des patients en souffrance perdent du temps et doivent déployer beaucoup d’efforts pour obtenir les soins nécessaires, risquant une détérioration de leur état de santé. Dans certains cas, ils sont dans l’incapacité de poursuivre leur vie professionnelle et subissent une détérioration supplémentaire de leur qualité de vie. Tous ces aspects représentent de multiples coûts économiques et humains difficilement chiffrables, mais bien réels, typiques du système canadien au sein duquel le contrôle étatique est quasi-total. »
La mise en cause du paritarisme de gestion
Le dernier point que nous voulons soulever est qu’à travers le projet de Grande Sécu, nous devons comprendre qu’il s’agit d’une nouvelle remise en cause du paritarisme de gestion. Nous l’avions déjà dénoncé lors de la Réforme des retraites : depuis de longues années, l’assurance vieillesse a été confrontée à d’énormes déficits, conduisant à des réductions de droits tout en augmentant la dette sociale, alors que par comparaison, l’Agirc Arrco a toujours pris des mesures difficiles et courageuses pour assurer son équilibre financier. Il en est de même avec la gouvernance responsable des IP et des mutuelles. Le 14ème Baromètre de la prévoyance CTIP/CREDOC a montré d’ailleurs que 60 % des salariés et 60 % des employeurs portent un jugement positif sur la gouvernance paritaire des IP. Des enquêtes similaires font état d’une même satisfaction concernant les mutuelles, plus ouvertes aux souscripteurs individuels.
De fait, lors que le néolibéral Jean-Charles Simon, économiste et président de Stacian, ancien bras droit de Laurence Parisot au Medef, appuie dans le Figaro[12] le projet de « Grande Sécu », l’on ne peut que se rappeler qu’il y a quelques années, une partie de l’organisation patronale entendait supprimer le paritarisme de gestion. En Octobre 2016, Jean-Charles Simon avait rédigé un opuscule « Faut-il en finir avec le paritarisme ? ». Bien sûr, le paritarisme n’est pas exempt de critiques et une refondation pourrait en améliorer largement le fonctionnement, ce qui suppose une sorte d’aggiornamento idéologique de certaines organisations syndicales. L’auteur en est d’autant plus convaincu qu’il fut lui-même, durant plusieurs années, membre confédéral d’une importante organisation syndicale.
Les critiques de Jean-Charles Simon ne s’arrêtent pas au paritarisme. Elles portent sur le mutualisme dans une vision assez caricaturale, alors que celui-ci garde tout son sens dans une société moderne. Car c’est une construction qui se base sur le libre arbitre et la volonté de chacun d’agir dans un cadre collectif pour l’intérêt de tous. Or, à l’égard du projet de « Grande Sécu », la position de Jean-Charles Simon, qui postulait d’ailleurs en 2018 à la présidence du Medef, n’est pas sans susciter quelques étonnements de notre part quant au bien-fondé de ses arguments : « Les mutuelles, avec leurs puissants réseaux d’influence et leurs relais nombreux, veulent conserver les structures économiques actuelles qui leur permettent de faire de l’action sociale et du marketing. Cela relève à mon avis plutôt de la gabegie : je ne vois pas en quoi sponsoriser des voiliers ou des équipes cyclistes avec les cotisations des Français améliore leur santé ». Le lecteur jugera…
[1] Voir « Le néolibéralisme, modèle économique dominant » d’Hugues Puel. Revue d’éthique et de théologie morale 2005/1 (n°233)
[2] Professeur d’économie politique internationale à la John F. Kennedy School of Government de l’Université Harvard.
[3] La théorie du « champ bureaucratique » a été développée par Pierre Bourdieu en 1993.
[4] Tête de file du mouvement Occupy Wall Street
[5] Flash Economie 9 avril 2021 – 263
[6] A cet égard, on lira avec intérêt l’interview de l’économiste Bruno Amable paru dans la Tribune du 15 octobre 2021 « Macron est un néolibéral chimiquement pur ». Son analyse porte sur le néolibéralisme français.
[7] Miroir Social du 3 janvier 2022 : « Les frais de gestion sauvent des vies » – Jean-Paul Benoît, président de la FMF. Il faut lire cette interview qui remet bien les pendules à l’heure.
[8] Précisons que le réseau des « Mutuelles de livre III » représente autour de 2.800 établissements de soins et d’accompagnement, constituant ainsi le premier réseau privé non lucratif… Une indication omise volontairement par les partisans de la « Grande Sécu », alors même qu’une partie de son financement est porté par les mutuelles de Livre II (les « Mutuelles assurantielles »). De plus, ce réseau est souvent à la pointe de l’innovation.
[9] Selon un récent recensement réalisé par la société de capital-investissement Karista, la France est le pays d’Europe qui compte le plus de fonds investissant dans l’e-santé. L’étude de l’Institut Montaigne, associant le cabinet McKinsey, démontre que le déploiement de l’e-santé permettrait de générer jusqu’à 22 milliards d’euros par an mais aussi de dessiner le système de santé de demain.
[10] Il faut également rappeler le programme d’investissement « Assureurs – Caisse des Dépôts Relance Durable France » avec son « volet Santé ».
[11] Fondatrice de Sapiendo
[12] Figaro du 11 novembre 2021 : « Grande Sécu »: «Plus simple pour les entreprises, plus équitable pour les assurés»