Faut-il, encore le rappeler, époque, en grec, cela signifie « parenthèse ». Une parenthèse, comme chacun sait, c’est quelque chose qui s’ouvre et qui se ferme. D’où la nécessité quand une époque s’achève de trouver les mots permettant de décrire ce qui est en train de naître.
« Mal nommer les choses, c’est ajouter aux malheurs du monde. »
Ce constat d’Albert Camus n’est pas une coquetterie d’intellectuel. C’est la définition même de la fonction de l’intellectuel : non pas dire ce qui devrait être, ce qu’il voudrait qui soit, mais ce qui est.
Ce qui est justement, ce qui change et changera en 2019, c’est ce qui a déjà largement commencé à changer. Nous changeons d’année certes, c’est la réalité du calendrier, mais nous sommes surtout dans une période de transition entre deux époques, l’époque moderne, celle de l’individualisme, du rationalisme, du productivisme, de l’économicisme et l’époque que faute de terme approprié on nomme postmoderne, dont nous discernons peu à peu les grandes structures de l’imaginaire : tribalisme, nomadisme, hédonisme, présentéisme.
Je décris depuis une trentaine d’années le surgissement de ces phénomènes et il faut bien dire que les différents évènements, dont ceux qui ont affecté notre pays à la fin de l’année ne peuvent que me conforter dans mes analyses[1].
À condition bien sûr de consentir à voir ce qui est et non pas juger ce qui se passe à l’aune de valeurs saturées.
Les Gilets Jaunes, témoins de ce changement
Ainsi de ces agrégations tribales ou communautaires qu’ont été les gilets jaunes. Fustigées au nom du communautarisme, ou du populisme. Parce qu’on n’y retrouvait ni le processus de lutte des classes censé expliquer les révoltes populaires, ni les traditionnelles listes de revendications portés par les instances représentatives. L’année finissant et les rites de fêtes prenant le relais des rassemblements aux ronds-points, le mouvement s’est effiloché. Le pouvoir aurait tort de croire qu’il a calmé le peuple, car il n’est pire danger que l’eau dormante : sous la surface plane d’un lac de haute montagne, on ne discerne pas les grouillements qui l’agitent en profondeur.
Après l’idéal démocratique, l’idéal communautaire
Plutôt que de dénier les changements, tâchons de les comprendre.
Soyons ainsi attentifs aux multiples manifestations de ce nouvel être ensemble, ce que j’ai nommé l’idéal communautaire succédant à l’idéal démocratique. Elles sont légion : qu’il s’agisse des flash-mob ou des grands rassemblements festifs, musicaux, religieux, des nouvelles manières de manifestations politiques ou syndicales, toujours il s’agit d’éprouver ensemble des émotions, de partager des sentiments, d’exprimer des affects. C’est bien sûr cela que nos structures institutionnelles et politiques, conçues à une époque où l’homme pensait faire entendre raison au monde, sont impuissantes à saisir. D’où le sentiment d’ingouvernabilité qui en résulte.
Sentiment d’ingouvernabilité accentué bien sûr par le double jeu du pouvoir, qui lors des élections a pu donner l’impression qu’il entendait les changements à l’œuvre, qu’il s’inscrirait dans les mutations sociétales en cours et qui a retrouvé dès l’accession au pouvoir les réflexes traditionnels de la technocratie et du politique vertical. Procurant dès lors un sentiment de fragilité, dès lors que ce qui était revendiqué comme Juvenoïa s’avère être une sorte de débilité infantile, que ce qui augurait du passage de la loi du Père à celle des frères est abandonné au profit de l’autoritarisme des sachants et des experts de la technocratie et de la finance.
Pouvoir institutionnel et puissance populaire
Le pouvoir donne et donnera un sentiment d’impuissance dès lors qu’il n’est plus en phase avec la puissance populaire. En phase non pas pour céder à ces revendications souvent « irréalistes » et toujours contradictoires que brandissent faute d’une expression appropriée les divers mouvements sociaux, mais en phase pour trouver ensemble de nouveaux modes de régulation du vivre ensemble.
Car c’est bien de ce changement là qu’il s’agit. Le contrat social réunissait des individus contractant librement et choisissant leurs représentants sur la base de programmes essentiellement économiques et sociaux ; ce contrat social ne fonctionne plus parce que c’est la démocratie représentative elle-même qui vacille, tenue debout par la seule force d’inertie des institutions. Ce que disent à leur façon, souvent maladroite, parfois violente, mais aussi festive et solidaire les divers mouvements sociétaux qui agitent et agiteront nos sociétés, c’est bien le passage de l’idéal démocratique à l’idéal communautaire.
Proximité, localisme, présentéisme, voilà autant d’impératifs pour notre temps. Et ce non pas dans un habit bien propret d’une participation concoctée par des communicants habiles au marketing tribal, mais dans une acceptation raisonnée et sensible des mutations de l’époque.
Transition, violence, incertitudes, tâtonnements
Les périodes de transition entre deux époques, ainsi celle qui marqua la fin de l’Empire romain ou d’ailleurs celle qui inaugura la modernité par les multiples révoltes puis révolutions du 18ème siècle ne sont pas des périodes calmes.
Les nouvelles formes du vivre ensemble s’élaborent au jour le jour, dans le désordre ; mais vouloir ordonner les choses, vouloir réduire trop rapidement au principe de réalité un réel foisonnant et désordonné ne peut qu’accentuer la césure profonde entre le peuple et les élites.
Celles-ci doivent, dans les années à venir, apprendre à écouter, à entendre, à s’accommoder à un nouvel ordre des choses dont on ne commence que lentement à saisir les tenants et les aboutissants. Avancer par essais et erreurs, accompagner les changements en cours au plus près des communautés de base voilà sans doute quelques pistes pour l’année à venir.
Renouer avec l’humilité fondamentale des gouvernants
Les siècles précédents ont cru pouvoir changer le monde, en tout cas changer la société, construire un système social pour l’éternité. On a vu à quelles dévastations et à quelles catastrophes ont abouti ces volontés féroces de faire entendre raison à la nature comme à l’ensemble sociétal.
Il s’agit maintenant de renouer avec l’humilité fondamentale qui devrait être celle des gouvernants comme des penseurs, des commentateurs comme des décideurs. Laisser au vestiaire les habits de l’arrogance, de l’ambition, du développement à tout prix pour retrouver ensemble ces valeurs que la modernité avait abandonnées : le rêve, l’imaginaire, la créativité.
Et ce pour le meilleur et pour le pire. C’est cet accommodement collectif à l’ordre des choses qui seul permettra d’affronter les changements sociétaux inéluctables de l’année et de l’époque à venir.
Michel Maffesoli
Professeur Émérite à la Sorbonne
Membre de l’Institut universitaire de France
[1] Cf. M. Maffesoli, Être postmoderne, éditions du Cerf, janvier 2018, postface Hélène Strohl, Emmanuel Macron, icône ou fake de la postmodernité.
Cf. entre autres, Maffesoli, Le temps des tribus, (1988), rééditions, La Table ronde.
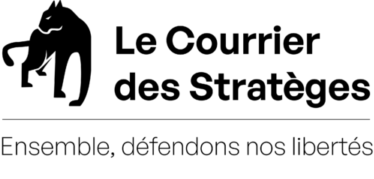





Oui. Pour poursuivre dans le même sens, j’ai entendu dire que les cités grecques anciennes étaient dotées de gouvernants d’un côté, d’un législateur de l’autre. Pas de pb, ras, sauf qu’il semblerait que les débats étaient publics et que les gilets jaunes de l’ époque pouvaient non seulement écouter mais aussi intervenir…ils étaient apparemment regroupés au sein d’une assemblée populaire constituée des présents volontaires du jour..
Ce que je veux dire par là c’est qu’il y a plusieurs millénaires, le besoin constaté aujourd’hui était déjà pris en compte… Un historien pourrait peut-être nous éclairer…