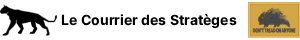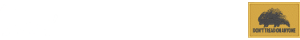La guerre commerciale déclenchée par Donald Trump bouleverse les équilibres établis entre les États-Unis et l’Afrique. Madagascar, pourtant partenaire commercial stratégique des États-Unis, subit de plein fouet les nouvelles mesures douanières américaines. La décision de Washington de suspendre pour trois mois les droits de douane sur les exportations malgaches vers les États-Unis n’a pas suffi à rassurer les travailleurs des zones franches. Initialement, un taux de 47% – le deuxième plus élevé en Afrique après le Lesotho (50%) – avait été annoncé par l’administration Trump.

Les États-Unis occupent le deuxième rang des pays importateurs de produits malgaches. En 2024, les échanges bilatéraux ont atteint 733,2 millions de dollars, dont 679,8 millions proviennent des exportations de Madagascar vers les États-Unis. Cette relation, pourtant favorable à l’économie malgache, est désormais remise en cause. Le déficit commercial américain avec Madagascar, estimé à 93 %, a été pris en compte par l’administration Trump pour imposer un nouveau droit de douane de 47 % sur les exportations malgaches.Pour Madagascar, la remise en question de l’AGOA et l’imposition de nouveaux droits de douane pourraient gravement affecter son économie.
Des conséquences directes sur l’économie malgache
Cette décision affecte particulièrement les produits phares comme la vanille, le textile, le cobalt et l’huile essentielle. Bien que certains bénéficient des accords préférentiels comme l’AGOA (African Growth and Opportunity Act) ou le Système Généralisé de Préférence (SGP), l’application des nouvelles taxes remet en cause ces avantages. Côté importations, Madagascar s’approvisionne en produits électroniques, automobiles et dérivés du pétrole américains, qui restent peu impactés par la mesure.
Face à cette situation préoccupante, une réunion d’urgence a été organisée au ministère des Affaires étrangères entre les responsables du secteur privé , entre autres Groupement des entreprises de Madagascar (GEM), le Groupement des entreprises franches et partenaires (GEFP) et le Syndicat des industries de Madagascar (SIM), et les membres du gouvernement et l’ambassadricxe américaine le 08 avril dernier, les risques liés à cette décision ont été clairement exposés. Les mesures protectionnistes de Trump pourraient :
- Affaiblir la compétitivité des entreprises malgaches
- Menacer des milliers d’emplois, notamment dans les zones industrielles
- Réduire l’attractivité de Madagascar comme plateforme d’exportation vers les États-Unis
Les autorités malgaches ont décidé de mobiliser tous les leviers diplomatiques pour demander une révision des mesures et garantir l’accès équitable au marché américain. Des démarches ont d’ores et déjà été entreprises auprès de l’ambassade américaine à Antananarivo.
Pour autant, un sursis de 90 jours a été accordé par la Maison Blanche, laissant une fenêtre ouverte pour des négociations. Cependant, Donald Trump lors d’un récent discours laisse présager des discussions difficiles.« L’accès au marché américain est un privilège, pas un droit. C’est la règle d’or de notre âge d’or ! » avait proclamé le président américain.
Un avenir incertain pour les secteurs clés et l’AGOA
Béatrice Chan Chin Yiu, présidente du GEFP a alerté sur les risques de licenciements massifs et de chômage technique que les fameux 47% de droits de douane de Trump pourraient engendrer. En effet, le secteur des entreprises franches, largement tourné vers l’exportation, notamment dans le cadre de l’African Growth and Opportunity Act (AGOA), est en première ligne.
Avec 180 000 emplois directs, le secteur textile représente 19% du PIB malgache. Les droits de douane de Trump menacent directement cette filière, comme le témoigne un cadre du secteur : « Ils ont de la stabilité, ils reçoivent leur paie mensuellement… Si on retire les machines, ils meurent avec leurs machines. ». L’industrie textile, principale bénéficiaire de l’AGOA, reste l’un des plus gros pourvoyeurs d’emplois du pays.
Les travailleurs, souvent peu qualifiés, risquent de perdre leurs emplois formels et leurs avantages sociaux, plongeant des milliers de familles dans la précarité.
Bien que la suspension des droits de douane soit provisoire, elle offre un répit . Dans la filière vanille , Madagascar étant le premier producteur mondial avec 80 % du marché, les exportateurs de vanille se précipitent actuellement pour expédier leurs cargaisons. Le transport maritime vers les États-Unis prend entre 70 et 90 jours, et la crainte est grande que les règles douanières changent une fois les produits arrivés à destination. « Tous nos clients américains nous demandent de charger immédiatement, tant que la suspension est en vigueur », confie un exportateur local sous couvert d’anonymat.

L’AGOA, qui célèbre cette année ses 25 ans, est également menacé. Certes, la suspension partielle des nouveaux droits de douane pendant trois mois a donné un bref répit, mais la confusion règne.Son expiration prévue en septembre, dans un contexte tendu, rend son renouvellement très incertain.
Dans un contexte mondial marqué par les tensions commerciales, la Grande Île doit faire preuve de stratégie pour préserver son économie. Le pays doit agir vite pour : protéger ses industries et emplois vulnérables, négocier des exemptions ou réductions tarifaires et surtout renforcer ses partenariats économiques alternatifs. Madagascar devra engager rapidement des négociations diplomatiques et commerciales, parmi les pistes envisagées, elle devra mettre en avant les ressources stratégiques (terres rares pour les nouvelles technologies et énergies renouvelables). Le projet Base Toliara, bien que controversé localement, pourrait servir d’argument dans les négociations.