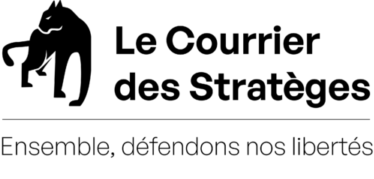par Lionel Tourtier
Consultant, Lionel Tourtier est économiste et président du think tank Génération Eric.
Ce millésime 2020 nous réserve bien des surprises et, sans doute, ce n’est pas fini. Nous avions déjà connu ces toutes dernières années les taux négatifs, une première hérésie ; ensuite la planche à billets des Banques centrales sans reprise de l’inflation, une hétérodoxie monétaire ; et voilà que ce lundi 20 avril, le prix du pétrole américain est devenu lui aussi négatif. Là, on tombe dans l’absurde ! À jeter ses manuels d’économie par la fenêtre ! Cependant, l’irrationalité de la situation est bien plus rationnelle qu’on ne pourrait le penser. Mais pour expliquer ce dérèglement du marché pétrolier, un univers de grande complexité, il faut d’abord disposer de quelques clefs de lecture.
Le b.a.-ba du marché pétrolier pour comprendre ses hauts et ses bas
Malgré toutes les critiques des écologistes, le pétrole reste et restera encore et largement au cœur du fonctionnement de nos sociétés thermo-industrielles. Il est consommé par la quasi-totalité des modes de transport (routiers, aériens, maritimes, soit 60 % de la production), il permet de construire et maintenir nos infrastructures routières (asphalte et bitume), chauffent nos habitats, et il est très largement utilisé dans la pétrochimie (plastique, huiles, solvants, engrais azotés) ainsi que dans la pharmacie (enrobage de médicaments et base de préparation). Pour fixer les idées, 80 % de l’énergie primaire mondiale est de l’énergie fossile : pétrole et gaz en forment l’essentiel.
Pour le moment, l’adorable Greta Thunberg, la nouvelle Pythie des écolos, ne nous a pas expliqué par quoi et comment remplacer le pétrole dans toutes ses applications (en particulier pour la pétrochimie qui apparait comme l’un des principaux angles morts du débat énergétique). Or, quoi qu’on en pense, cette énergie a été l’un des facteurs d’amélioration de notre qualité de vie et de notre croissance. L’avenir du pétrole, c’est donc aussi l’avenir de nos modes de vie : lorsqu’il n’y en aura plus, il faudra bien trouver des substituts à performances techniques équivalentes ; à moins de vouloir consciemment revenir au Paléolithique, c’est-à-dire à une société de « chasseurs-cueilleurs », mais à bicyclette. Nous n’avons que quelques décennies pour y réfléchir.
Le pétrole, c’est donc la vie, mais c’est aussi la guerre. C’est un fait historique. Cela s’explique par l’importance de cette énergie et par le fait qu’il y a une distance géographique importante entre les sites de production et les lieux de consommation. Les voies de transport qui l’acheminent sont donc stratégiques. Par exemple, 30 % de la production mondiale de pétrole et 25 % du gaz naturel liquéfié passent par le détroit d’Ormuz, une zone située entre le golfe Persique et le golfe d’Oman. Ce qui en fait l’artère principale du commerce pétrolier mondial. Bloquer Ormuz (40 kms de large seulement), ou couler un des 2.400 pétroliers qui l’empruntent chaque année, et l’on fait sauter le couvercle de la cocote minute mondiale. Pourtant, Iran, Arabie saoudite et Etats-Unis s’y livrent au jeu explosif du chat et de la souris. Le pétrole est aussi une arme de guerre.
Quels sont les États producteurs ?
Les principaux pays producteurs de pétrole sont : les États-Unis l’Arabie Saoudite, la Russie, chacun fournissant un peu plus de 10 % de la production mondiale de brut. Viennent ensuite la Chine, l’Iran, l’Irak, le Koweït, le Mexique, le Venezuela, le Canada, le Nigeria, la Norvège, les Émirats Arabes Unis, l’Algérie et la Libye.
Pour peser sur les prix (c’est-à-dire les réguler au mieux de leurs intérêts), plusieurs producteurs, pour la plupart des pays arabes, se sont regroupés en 1960 dans l’OPEP : on recense aujourd’hui l’Arabie saoudite (2ème producteur mondial), l’Irak, (6ème), les Émirats arabes unis (7ème), ainsi que le Koweït, l’Algérie, la Libye. L’Iran, qui est perse, est également présent (5ème producteur mondial). Sept autres pays non arabes en font également partie : l’Angola, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Nigéria ainsi que le Venezuela et l’Equateur pour l’Amérique du Sud.
On remarquera que ces 14 membres, représentent 3 zones géopolitiques à tensions, alimentant régulièrement nos actualités : le Moyen-Orient au sens large, la plus sensible ; l’Afrique, toujours instable ; et l’Amérique du Sud (avec l’offensive des Etats-Unis contre le Venezuela, lequel est soutenu par la Russie et la Chine).
Côté producteurs toujours, il ne faut pas omettre l’existence de trois autres organisations internationales :
- l’OPAEP (Organisation des Pays Arabes Exportateurs de Pétrole), créée en 1968 et qui suit des objectifs similaires à l’OPEP : elle regroupe Bahreïn, Égypte, Qatar, Syrie et Tunisie ;
- l’alliance OPEP+ (ou OPEC+ en anglais) également appelée « Groupe de Vienne », formée en 2016 par 24 pays : les 14 de l’OPEP et 10 autres Etats : Azerbaïdjan, Bahreïn, Brunéi, Kazakhstan, Malaisie, Mexique, Oman, Russie, Soudan, Soudan du Sud. En fait, c’est une initiative de l’Arabie saoudite et de la Russie pour planifier ensemble leur production face à la montée en puissance de l’huile de schiste des Etats-Unis ;
- l’Organisation des Producteurs Africains ou APO en anglais (initialement APPA), constituée en 1986 par 8 pays : Algérie, Angola, Bénin, Cameroun, Congo, Gabon, Libye, Nigeria. Aujourd’hui, cette organisation en compte 18 (avec une revendication de 12% des réserves mondiales), dont : l’Afrique du Sud, la RD Congo, la Côte d’Ivoire, l’Egypte, la Guinée équatoriale, le Ghana, la Mauritanie, le Niger, le Soudan, le Tchad. Leur objectif est de disposer d’une plateforme commune pour lancer des initiatives et développer leurs stratégies dans le domaine du pétrole et du gaz en Afrique. En 2018, ces Etats ont passé un contrat d’assistance.
L’OPEP+ représente 55 % des approvisionnements mondiaux et 90 % des réserves « prouvées », ce qui lui confère en théorie un niveau d’influence sur l’économie mondiale jamais atteint auparavant. Encore faut-il réunir un consensus, ce qui est loin d’être évident, comme la crise récente l’a révélé.
Du côté de la demande, les plus gros consommateurs de pétrole sont : les États-Unis, l’Union européenne, la Chine, le Japon, l’Inde, la Russie et le Canada. Certains producteurs sont donc des deux côtés du miroir. Une situation propice à une forme de schizophrénie. Un peu du style, les « fous ont pris le contrôle de l’asile » … La suite va le démontrer.
Les inquiétudes à l’égard des pays consommateurs portent essentiellement sur la Chine. En effet, selon certains diplomates occidentaux, le développement des besoins énergétiques (et surtout pétroliers) chinois pourrait créer à l’avenir une menace pour l’équilibre géostratégique mondial. Ce qui s’ajouterait aux tensions actuelles entre la Russie et les Etats-Unis, entre la Russie et l’Europe (Ukraine) et entre la Russie et le Japon (Iles Kouriles). Bien sûr, ce n’est qu’une analyse occidentale, probablement d’inspiration « Otanienne » pour justifier quelques budgets militaires. Il faut reconnaître cependant que le centre de gravité mondiale s’est déplacé sur le tripode Chine-Inde-Russie. Peut-être un signal du déclin à venir de l’empire américain…
Coût fiscal d’équilibre et jeu d’acteurs
Il y a donc un jeu d’acteurs à la fois subtil et violent entre les pays producteurs et les pays consommateurs (certains étant des deux côtés comme nous l’avons souligné) au gré des luttes d’influence, des tensions internationales, des alliances stratégiques, voire la recherche d’une hégémonie mondiale et son corollaire de conflits. Comme le déclarait Georges Clémenceau en 1918 : « l’essence est aussi nécessaire que le sang dans les batailles de demain ». Depuis l’on a eu le Koweït, l’Irak, la Syrie… souvent sous le prétexte de la défense de la démocratie et des droits de l’homme. Mais ne soyons pas dupes : cela n’a rien à voir. Pétrole quand tu nous tiens !
En fait, si l’on veut comprendre la manière d’user d’un rapport de force dans le pétrole, il faut retenir trois manettes : les réserves, la capacité de production et le prix du baril. On peut aussi recourir à des formes modernes de « politique de la canonnière », mais raisonnons d’abord à partir de variables techniques. Cela nous aidera à comprendre la situation actuelle.
Le Moyen-Orient détient les deux tiers des réserves mondiales. L’on trouve ensuite le Venezuela pour 18 % (membre de l’OPEP), le Canada pour 10 %, et la Russie (sans prendre en considération une quote-part des réserves potentielles en Arctique qui pourraient atteindre 100 milliards de barils de pétrole et 318 milliards de gaz en équivalent pétrole). Précisons que le Venezuela et le Canada disposent de réserves d’hydrocarbures « non conventionnelles », donc coûteuses à exploiter, contrairement aux réserves saoudiennes.
Nous avons vu que les principales capacités de production se trouvent dans trois pays : aux Etats-Unis (13,6 millions de barils par jour), en Arabie saoudite (12 millions de barils) et en Russie (9 à 11 millions de barils). D’où les efforts de coordination des pays de l’OPEP+ pour se fixer des plafonds de production en fonction de leurs réserves « prouvées ».
C’est à ce stade que le problème du prix du baril se pose et surtout celui du coût de production. C’est le coût marginal par baril qui permet (ou pas) au producteur d’augmenter sa production pour compenser en volume ce qu’il peut perdre en valeur. Or, à la base, le coût de production est différent selon la nature du gisement et les techniques d’extraction. Le pétrole offshore de la Mer du Nord entraîne un coût d’environ 53 dollars par baril, tandis que l’exploitation des sables bitumineux au Canada occasionne un coût d’environ 41 dollars par baril. Dans les conditions d’exploitation les plus difficiles, cela peut monter au-delà de 75 dollars.
Il peut y avoir aussi des écarts, selon que l’on intègre ou pas le coût d’exploration (la recherche des gisements). Ce qui est certain, sur longue période, c’est que les coûts d’extraction du pétrole augmentent régulièrement du fait des équipements, des salaires (ceux des spécialistes) mais aussi de la réglementation (sécurité des installations et réduction de l’impact sur l’environnement).
Pour donner un exemple concret, le prix de location des appareils de forages pour l’offshore très profond s’élevait à environ 200.000 dollars par jour en 2002 ; il atteignait dix ans plus tard (2013), 650.000 dollars ! Cela explique que de nombreux projets soient finalement abandonnés. Néanmoins, l’offshore représente 28 % des réserves d’hydrocarbures et 28 % de la production mondiale. Et les trois-quarts des volumes découverts le sont notamment en offshore. Ce qu’il faut retenir, c’est que la tendance pour produire du pétrole est à la hausse des coûts.
Mais ce n’est pas tout. Car en réalité, le prix du baril doit équilibrer le budget du pays producteur (« coût d’équilibre fiscal »). Par exemple, l’Arabie Saoudite a un coût d’extraction très faible, de l’ordre de 4,7 dollars le baril (source Aramco), soit parmi les moins chers au monde. Avec le coût d’exploration ce chiffre passerait à 5,20 dollars, selon Dmitry Marinchenko, analyste chez Fitch Ratings. Or, le pays a besoin d’un prix du baril entre 83 et 88 dollars (selon les sources), pour maintenir l’équilibre de son budget national. La production de son pétrole représente ainsi environ 30 % du PIB mais 79 % des recettes d’exportation.
Par comparaison, la Russie a besoin pour ses finances publiques d’un baril à 42 dollars par rapport à un coût de production de 17,3 dollars par baril. Mais les coûts de production en Russie sont peu documentés. Le Financial Times, dont le sérieux ne peut être mis en doute, indique 5 dollars : « According to company data, last year it cost Rosneft Rbs199 on average to extract a barrel of oil, and another Rbs202 to refine it: the total cost equates to about $5. » Les ressources pétro-gazières représentent environ 20 % du PIB, 46 % des recettes du budget fédéral et 64 % des exportations. Résultat : la Russie a terminé l’année 2019 avec un surplus budgétaire de 2,6 % du PIB, tandis que l’Arabie saoudite a affiché un déficit de plus de 4 % !
À ces considérations budgétaires, il faut aussi tenir compte dans les variables de décision de la situation monétaire, celle de la devise du pays versus le dollar. Le Financial Times, déjà cité, explique les avantages du rouble : « Russia’s free-floating currency — unlike the Saudi rial and the United Arab Emirates dirham, which are pegged to the US dollar — is another boon. As oil prices fall, the rouble generally weakens, increasing domestic earnings per exported barrel. » De même, comme l’explique Sergei Guriev professeur d’économie à Sciences Po, Moscou possède d’importantes réserves financières : « Le rouble a un taux de change flexible, de sorte que la chute des prix du pétrole entraîne une baisse de la valeur de la monnaie, mais, en parallèle, une augmentation de celle du fonds souverain. Ainsi, la Russie possède suffisamment de réserves pour les trois ans à venir ».
Un autre expert a un avis un peu différent. Michael Liebreich, de Bloomberg New Energy Finance, estime qu’avec son coût fiscal d’équilibre, les réserves de change de l’Arabie Saoudite pourraient maintenir les prix du pétrole à un niveau record à la baisse pendant seulement deux ou trois ans. Alors qu’avec un seuil de rentabilité budgétaire de 40/42 dollars le baril, et une économie beaucoup plus diversifiée, la Russie pourrait survivre aux bas prix du pétrole pendant une décennie. A vérifier…
Que faut-il retenir de ces trois éléments ? Une règle : chaque producteur tente de maintenir sa part de marché en maximisant sa production et en baissant ses prix. Une donne essentielle : la situation des pays producteurs doit être analysée prioritairement au regard de la diversification de leurs activités économiques. Les Etats les plus vulnérables sont ceux pour lequel le pétrole représente l’essentiel des revenus. Enfin, la parité devise du producteur/dollar a également son importance.
Une source de tensions et un moyen de pression
Nous avons donc à la fois : une fourchette de coûts de production très large avec, pour les plus petits pays producteurs, un niveau de prix de revient qui peut être très pénalisant ; et un coût fiscal d’équilibre très variable, qu’il faut rapprocher de l’existence ou pas d’un « trésor de guerre » (réserves financières et fonds souverains). Ces différences de situation illustrent parfaitement le déroulement de la guerre des prix qui s’est engagée il y a quelques semaines entre la Russie et l’Arabie saoudite, ainsi que la difficulté de réunir des consensus à 24 pays… Ces facteurs structurels sont au cœur de l’instabilité constante du marché pétrolier.
Affaiblir les pays producteurs est une tentation permanente, que l’on soit producteur ou consommateur. Le pétrole n’est pas un long fleuve tranquille. En outre, il peut devenir politiquement un véritable jeu de go à l’échelle mondial.
Ainsi, il y a toute juste un an, en avril 2019, Trump voulait réduire à zéro les exportations de pétrole en provenance de l’Iran. Son but était d’accentuer la pression économique sur ce pays qui faisait déjà face à de nombreux défis : la contraction de son économie, une inflation au-dessus de 25 % et de graves inondations. Pour serrer davantage le garrot, Trump annonça la fin des dérogations accordées à 8 pays acheteurs du brut iranien : Chine, Inde, Turquie, Japon, Corée du Sud, Taïwan, Italie et Grèce. Cela entraîna immédiatement une hausse du baril de Brent, qui passa à 75 dollars. Ce faisant, cette décision renforçait les tensions au-delà de l’Iran : avec la Turquie et la Chine notamment. Une situation qui pouvait aboutir par conséquent à un risque de conflit, notamment par ricochet entre Israël et l’Iran, et donc déstabiliser l’offre mondiale de pétrole. Trump fut contraint d’atténuer la mesure.
Aujourd’hui, la situation de l’Iran n’est pas meilleure. C’est la double peine : le pays, en pleine crise du Covid19, continue de souffrir des mesures d’embargo sur son pétrole (Téhéran ne vend plus qu’une infime partie de son brut à la Chine) et le prix du baril l’appauvrit encore davantage. Pour la première fois de son histoire, l’Iran a sollicité du FMI l’octroi d’un prêt urgent de 5 milliards de dollars pour lutter contre la pandémie. Mais Washington, non sans raison, a appliqué son droit de véto.
Du coup, les tensions militaires recommencent. Ainsi, le 22 avril, Donald Trump a donné l’ordre à l’US Navy d’abattre et de détruire toute embarcation iranienne qui harcèlerait les navires américains. Mais l’on doit relier cet avertissement au fait que le Codiv19 paralyse, lui aussi, la flotte américaine à Ormuz. C’est donc de la com façon testostérone… Car il est difficilement envisageable pour les Etats-Unis de déclencher un conflit avec l’Iran en ce moment. C’est, de plus, s’engager sur une voie frontale avec la Russie et la Chine.
Plus généralement, nous devons tirer de ces faits un comportement de prudence dans l’analyse des situations au Moyen-Orient. Pétrole et manipulation vont de pair. Et l’origine d’incidents n’est pas forcément là où l’on pourrait le croire.
Parties de Poker menteur
Par exemple, si l’on revient sur l’attaque du 14 septembre dernier par drones contre des sites d’Arabie saoudite (ceux de Khurais et d’Abqaiq), on prend acte comme du bon pain de la revendication officielle des rebelles yéménites Houthis. Première version. Après tout, c’est une contrepartie logique du conflit au Yémen. Toucher l’Arabie saoudite au portefeuille, c’est de bonne guerre…
Mais ce n’est pas l’avis de l’Arabie saoudite et de son allié américain qui le font savoir « urbi et orbi ». L’envergure et la précision des attaques de drones démontrent plutôt un lancement depuis l’Ouest et le Nord-Ouest. Donc, pas du Yémen. Deuxième version : c’est forcément un coup des Iraniens. D’ailleurs, n’ont-ils pas arrêté le 16 septembre, sous le prétexte de contrebande, un navire chargé de 250.000 tonnes de pétrole battant pavillon émirat ? Or, l’Iran ne se trouve pas au Nord-Ouest, mais au Nord-Est de la province saoudienne d’Achd-Charqiya.
Troisième explication : c’est donc plutôt à partir de l’Irak que le coup serait parti. Oui, mais pourquoi ? En outre, il semblerait qu’en plus de drones, l’attaque a été effectuée avec des missiles de croisière ! Du coup, les analystes se demandent si Israël n’est pas derrière toute cette histoire, d’autant plus que l’attaque a eu lieu à la veille des législatives anticipées et qu’une petite pression martiale de Trump sur les Iraniens ferait bien l’affaire du Likoud. Nul n’ignore que des missiles de Téhéran sont pointés sur l’Etat hébreu. Quatrième version : donc, c’est probablement le Mossad ? D’ailleurs, comment se fait-il que les nombreux radars de surveillance qui couvrent la zone, y compris ceux de la 5ème flotte américaine, n’aient rien vu ? On se gratte la tête…
Pendant ce temps-là, le prix du baril Brent a augmenté de 20 % (jusqu’à 71 dollars), et de 17 % pour le baril WTI (64 dollars). Car l’attaque sur des deux sites, dixit l’Arabie saoudite, « aurait entraîné la suspension de pétrole de brut à hauteur de 5,7 millions de barils », soit 50 % de la production de la compagnie saoudienne Aramco. Donc, avec cette agression sans morts ni blessés, producteurs américains mais aussi saoudiens pouvaient se frotter les mains. Un bien pour un mal ou un mal pour un bien selon. A la veille de l’incident, le prix du baril était passé sous la barre psychologique de 60 dollars. Finalement, cette histoire sentait bon l’aubaine. Cinquième version : et si c’était … Et l’on creusa la question, normal pour du pétrole. Les « Poirot » en tout genre compilèrent tous les faits, les mettant bout à bout, et firent des rapprochements, parfois surprenants.
D’abord, il y avait le projet d’introduction en Bourse d’Aramco. Une « petite hausse » du baril augmenterait forcément la valorisation dans un marché plutôt baissier. Des analytes financiers faisaient d’ailleurs circuler l’information qu’une nouvelle attaque pourrait bien pousser le prix du baril aux environs de 100 dollars. En quelque sorte, du « pousse au crime ».
Ensuite, quelques jours avant l’attaque, le 2 septembre, le Prince héritier saoudien venait tout juste de virer le patron d’Aramco, le ministre de l’Energie Khaled al-Faleh, pour manque de performances : il n’avait pas réussi à augmenter les prix. Il fut remplacé au ministère par le fils du roi, le Prince héritier saoudien Abdel Aziz ben Salmane et c’est Yassir al-Roumayyan, le patron du fonds souverain saoudien qui prit les commandes de la société pétrolière.
Troisième interrogation : pourquoi faire état d’une réduction aussi importante de la production pétrolière ? Certes Abqaïq est (fut ?) l’un des principaux gisements pétroliers du Royaume, mais il est en cours d’épuisement et à partir de 1973, la production a été restreinte… Quant à Khurais, ce serait le plus important gisement. Mais il avait été abandonné avant que Aramco ne le réactive en 2009. La confusion dans l’histoire tient au fait qu’il y a des raffineries et qu’on ne sait pas exactement si ce sont elles (on parle d’incendies dans la presse) ou les installations d’extraction du pétrole qui ont été touchés. Une succession de faits étranges… A défaut de latin, on en perd son arabe !
Enfin, une petite ONG, spécialisée dans le désarmement, indiqua, sans que personne ne lui ait rien demandé, que les missiles de croisières utilisés étaient des « Quds » Yéménites, lesquels ressemblent étrangement aux « Soumar » iraniens, mais finalement n’en sont pas. Retour à la case départ ? Question : qui finance l’ONG ? Pas de réponse. Mais au moins l’ONG aura fait le bonheur des joueurs de scrabble puisque les noms propres sont désormais acceptés : Soumar et surtout Quds qui va en dépanner plus d’un.
Le pétrole est donc un immense jeu de poker menteur. Une partie de billard à trois bandes. Se positionner sur ce marché, comme nous le verrons plus loin, ne peut être l’apanage d’investisseurs de fonds éthiques ou partisans de l’ESG. Il faut plutôt avoir l’imagination d’un scénariste de sciences-fictions d’Hollywood, teintée d’une capacité à psychanalyser tous les « Pinocchio » et matadors du marché.
Dans ce style de « cinéma », un parallèle avec le Venezuela peut également être fait. Début avril de cette année, les Etats-Unis ont déployé un important arsenal militaire dans la mer des Caraïbes, ce qui double la capacité américaine dans la région. Donald Trump a justifié ainsi cette pression : « Nous ne devons pas laisser les cartels de la drogue exploiter la pandémie pour menacer les vies américaines ». Le Codiv19 et la cocaïne ont bon dos… Rappelons-nous que le Venezuela dispose des plus grandes réserves mondiales de pétrole. Forcément, ça ouvre les appétits. En janvier dernier, le Secrétaire américain au Trésor avait déjà gelé tous les actifs de la Compagnie de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Outre la captation des réserves pétrolières, destituer Nicolas Maduro et placer à la tête du pays Juan Guaido, un « ami » des Etats-Unis, permettrait de couper les relations du pays avec la Chine, la Russie, la Turquie et l’Iran. Donc de réduire l’influence de ces « trouble-fêtes » dans la région. Coup double ! Vive la « Pax americana ». Mais il y a un os. Encore Poutine…
Car le pétrole du Venezuela fait l’objet d’un partenariat avec la compagnie pétrolière Rosneft, majoritairement détenue par l’Etat russe. Son président, Igor Setchine, est d’ailleurs un proche de Poutine. Retenez bien ce nom : Setchine. L’homme du pétrole russe. Sa société joue (jouait, nous en verrons pourquoi plus loin) un rôle clef dans l’exploitation et la distribution du brut vénézuélien, en lien avec PDVSA. Jusqu’à une date récente, elle gérait 60 à 70 % des exportations du pays ! Rosneft est présente dans le pays depuis 1999, donc bien avant les tensions avec les Etats-Unis. Elle a poursuivi le développement de ses activités, malgré l’embargo décrété par les Etats-Unis sur le pétrole.
Les sanctions, dans la grande tradition de l’extraterritorialité du droit des Etats-Unis, visent deux cibles : les entreprises américaines ont l’interdiction d’acheter du brut vénézuélien ; les sociétés étrangères ne peuvent pas utiliser le système bancaire américain pour réaliser des transactions liées au pétrole vénézuélien. Pour ne pas brouiller ses relations avec Trump, la Chine se retira du jeu, en apparence du moins, comme nous allons le voir. Ce n’est pas le cas de la Russie.
Selon BBC Mundo, Rosneft a trouvé une astuce légale pour contourner l’embargo : antérieurement aux sanctions américaines, le Venezuela avait contracté une dette à l’égard de la Russie. Les approvisionnements effectués dans le pays par Rosneft constituent un mode de remboursement de cette dette. Astucieux, le troc…
Toujours selon BBC Mundo, le pétrolier russe intervient également comme intermédiaire privilégié vis-à-vis de la Chine. Rosneft lui fait livrer très discrètement du brut via l’Inde et Singapour. Cela se passe de nuit, au moyen de navires tous feux éteints, précise BBC Mundo. On se croirait dans un film d’aventure des années 50, avec des chinoises à la robe de soie fendue : « L’or noir de Macao » …
Fin mars de cette année, en raison du contexte international, Rosneft a pris soudainement la décision de vendre au gouvernement russe tous ses actifs au Venezuela. Cette manœuvre permettrait d’éviter toute sanction américaine dans une escalade de la lutte entre Caracas, Washington et Moscou. L’opération démontre une fois de plus, pour ceux qui n’en étaient pas convaincus, que les sociétés d’hydrocarbures russes constituent un des bras armés de la stratégie géopolitique du Kremlin.
Au cours des 10 dernières années, la part de marché du pétrole américain est passée de 7 % à plus de 14 %, au détriment notamment de la Russie et de l'Arabie Saoudite. Tout ceci à la grande satisfaction de Trump. Il y a un peu du cocu dans cette histoire.
Lionel Tourtier Tweet
Le pétrole : un marché financier à terme
Venons-en maintenant aux aspects de négociation, ce qui nous permettra ensuite d’aborder les facéties de la semaine du 20 avril.
Précisons d’abord qu’il existe au moins 160 différentes qualités de pétrole brut dont trois sont de référence mondiale : le Brent de la Mer du Nord, le West Texas Intermediate américain (WTI) et le Dubaï Light. Nous ne retiendrons que les deux premiers.
- Le Brent de la Mer du Nord représente un type de pétrole léger et qui est un mélange de la production de différents champs pétroliers de la mer du Nord (Broom, Rannoch, Etive, Ness et Tarbert). Retenons que ces gisements sont en déclin. En 2016, une estimation montrait que sur les 63 milliards de barils de pétrole pouvant être récupérés en mer du Nord, 43 milliards avaient déjà été extraits. Ceci explique que sur les 330 gisements répertoriés, une partie commence à être démantelée et ce d’autant plus vite que le prix du baril compense de moins en moins le coût d’exploitation. De ce fait, il y a eu un élargissement de la base d’extraction, qui s’appelle désormais BFOE, l’acronyme de quatre gisements de mer du Nord : Brent, Forties, Oseberg et Ekofisk. Le Brent est acheminé par pipeline au terminal de Sullom Voe, dans les Shetland en Ecosse. Pratique et économique.
- Le WTI est un type de pétrole brut, également léger, extrait en Amérique du Nord. Il est essentiellement produit au Texas, un peu en Louisiane et au Dakota du Nord, avant d’être livré à Cushing, au fin fond de l’Oklahoma. Plus léger que le Brent, il se valorise mieux car il permet de produire plus d’essence.
Les différences de prix entre ces deux types de pétrole reposent sur des critères de qualité et des caractéristiques techniques qui conditionnent le choix des opérations de raffinage.
Le Brent est un marché maritime. Il ne supporte donc pas les mêmes contraintes que le marché du WTI qui n’a pas accès au littoral. Il en résulte que les coûts d’exportation du WTI sont plus élevés. Il faut savoir qu’aux États-Unis, le « Jones Act » accroit le coût du transport de pétrole. En effet, cette loi fédérale qui régit le commerce maritime aux États-Unis exige que les marchandises expédiées entre des ports américains soient transportées sur des navires construits, possédés et exploités par des citoyens américains ou des résidents permanents.
La qualité supérieure du WTI explique aussi son prix plus élevé que le Brent. Il ne contient que 0,24 % de soufre contre 0,37 % pour le Brent. La densité API du WTI, qui mesure sa viscosité, se situe autour de 39,6 contre 38 pour le Brent, ce qui rend le pétrole américain plus facile à raffiner. A contrario, le Brent convient mieux à la production de distillats tels que le kérosène ou le diesel. Le WTI permet de produire du Kérosène mais pas de diesel. Il faut garder en mémoire ces caractères techniques pour la compréhension de la crise. Sous l’angle de l’utilisation, il n’y a pas réellement de possibilité de substitution d’un pétrole par l’autre.
Historiquement, le baril de WTI s’est longtemps échangé environ un dollar plus cher que celui du Brent. Mais cet écart s’est progressivement réduit jusqu’à s’inverser au cours de la dernière décennie. La raison principale réside dans la croissance de la production du pétrole de schiste aux Etats-Unis. Cela a entraîné un double mouvement : l’offre de pétrole sur le marché américain a pesé à la baisse sur les prix et, pour le Brent, la diminution de la production a poussé à la hausse le prix du baril. La pression sur le WTI s’est un peu réduite lorsque Obama a levé l’interdiction en 2015 de vendre du WTI à l’étranger.
Globalement, le pétrole aux Etats Unis est produit dans 32 Etats et le long des côtes. Il faut néanmoins distinguer l’industrie du pétrole de schiste de celle du WTI. Le premier a permis aux Etats-Unis de redevenir exportateur. Mais comme nous le verrons, il est fragile. Si l’expansion du pétrole de schiste a fait l’affaire de Trump ces dernières années, la crise actuelle rebat les cartes. Car le secteur pétrolier comptabilise 6 % des emplois, ce qui constitue un vrai enjeu électoral pour Trump. Cinq Etats représentent à eux seuls 69 % de la production. Quatre d’entre eux avaient voté pour Trump en 2016: Texas (38 grands électeurs), Dakota du Nord (3 grands électeurs), Oklahoma (7 grands électeurs), Nouveau-Mexique (5 grands électeurs). Seul le Colorado a été gagné par Hillary Clinton (9 grands électeurs). Pour une élection à venir très disputée, les Etats pétroliers vont compter singulièrement.
Sur les dernières années, le marché mondial est devenu très volatil. Le prix du baril de brut ne cesse de fluctuer : 85 dollars en octobre 2018, 50 dollars en décembre, 75 dollars en mai 2019, 68 dollars en décembre 2019. Or, cette volatilité attire les traders et les investisseurs. En prenant en considération tous les éléments que nous venons d’exposer, en retenant les facteurs les plus pertinents dans le contexte, il est possible d’échanger du pétrole brut sur les marchés à terme et d’options.
Le mécanisme est très simple : si l’on anticipe des prix plus élevés, on utilise des contrats d’achat et si l’on mise sur une baisse des prix, on prend des contrats de vente. Partant du baril physique, on s’échange en fait du « baril papier ». Entre l’appareillage et le déchargement d’un tanker, sa cargaison peut avoir changé de propriétaire plusieurs dizaines de fois ! Si le cœur « bien accroché » vous en dit, vous pouvez vous faire la main en consultant le « Crude Oil WTI – Contrats ».
En réalité, le marché à terme du pétrole est tout simplement un marché financier :
- le Brent est traité à l’ICE (InterContinental Exchange) de la bourse de Londres,
- le WTI (West Texas Intermediate), traité au Nymex de la bourse des matières premières de New-York
Le Brent reflète l’équilibre mondial de l’offre et de la demande tandis que le WTI reflète la position du marché intérieur américain. Raffiné sur le territoire, il sert essentiellement à la consommation américaine.
Le succès des « futures », ces contrats à terme, s’explique par leur grande souplesse. Le volume élevé des transactions y assure (en temps normal) une bonne liquidité, particulièrement aux échéances courtes (quelques mois). Deux groupes d’acteurs opèrent sur ces « futurs » : des opérateurs qui souhaitent se couvrir des variations du prix ; des spéculateurs qui recherchent un profit de nature financière sans vouloir procéder à un échange sur le baril physique. Et comme l’innovation financière n’a pas de limite, on a également conçu des ETF sur le pétrole. On n’arrête pas le progrès en matière financière.
Mais à force de faire d’un marché physique un marché financier hyper-spéculatif, on devient vulnérable au chant du cygne (de l’or) noir… Venons-en maintenant à l’étude de la crise d’avril.
Entre le « Black Friday » et le « Black Monday », il n’y a pas réellement de différence : le monde du pétrole est fou !
Nous allons donc aborder maintenant l’étude de « l’asile ». Il faut d’abord replacer dans le temps la chronologie de plusieurs évènements. Où l’on retiendra que le virus biologique et le virus de l’argent ne font pas bon ménage …
Fin 2019, et malgré une baisse constante du prix du baril, beaucoup d’experts, à commencer par ceux de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), estimaient que le pétrole pourrait encore connaître de beaux jours sur les vingt prochaines années. « La consommation des pays matures devrait logiquement être en baisse », disaient-ils. « Mais elle serait néanmoins compensée par l’augmentation des besoins en pétrole des nations en développement », alimentée par : leur croissance économique, leur essor démographique et l’émergence de classes moyennes. Une annonce à gâcher le noël de la petite Greta…
L’OPEP de son côté évaluait à la même période un rythme de progression de 12 à 13 % d’ici à 2040. A l’appui de cet optimisme, l’AIE rappelait dans son rapport que la demande mondiale en énergie, toutes sources confondues, avait connu en 2018 sa plus forte croissance depuis dix ans. Certes, il y a la pression des écologistes, reconnaissaient les experts, mais la mise en œuvre des énergies de substitution devrait être lente. Sans doute n’ont-ils par tort.
Par conséquent, la préoccupation immédiate à l’époque où l’on réveillonne était plutôt le sous-investissement dans le secteur pétrolier, en particulier pour améliorer l’efficacité des opérations d’exploitation. L’échéance d’un prochain « Pic d’exploitation » tant redouté semblait donc s’éloigner, au grand dam des collapsologues.
Pour apprécier avec le recul ces prévisions et « avis d’experts », souvenons-nous que l’OMS avait déclenché une alerte mondiale le 10 janvier 2020 et annoncé le 30 janvier une urgence de santé publique internationale (USPPI). Manifestement, la théorie des signaux faibles n’est pas encore bien intégrée par les décisionnaires du marché pétrolier (ni par les autres d’ailleurs).
Comment plomber durablement l’industrie américain du pétrole de schiste
Aucun dirigeant mondial en ce début d’année ne semblait évaluer la gravité de l’épidémie, même pas en France où nos gouvernements sont tellement « clairvoyants » (sauf peut-être Agnès Buzyn, – pour rire !).
Malgré la situation chinoise à Wuhan, le 15 janvier, le jour de la « galette des rois », et donc 5 jours après l’alerte de l’OMS, l’OPEP publia un rapport où elle estimait que la croissance économique mondiale devrait atteindre 3,1 % en 2020 après 3,0 % l’année passée. D’où, si vous suivez bien, une augmentation de la demande de brut devant passer de 99,77 millions de barils jours en 2019 à 100,98 en 2020. On se pince devant ces prévisions ! Le 22 janvier, la Chine mit la ville de Wuhan en quarantaine (11 millions d’habitants). Le 25 janvier 2020, elle élargissait la mesure aux 59 millions d’habitants de la province du Hubei, à ceux de Huanggang (7,5 millions) et d’Ezhou (1 million). Personne à l’OPEP ne fit de lien… Pourtant, la Chine représentait en 2019 14 % de la consommation mondiale, soit 14 millions de barils par jour. Par rapport à ce volume, toute baisse prend une ampleur significative sur le marché pétrolier.
Dans ce climat « optimiste », certains dirigeants, Poutine, le Prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane (dit MBS), Trump et d’autres, pensaient sans doute que l’épidémie ne serait que de courte durée. Vous savez bien, « la grippette » … selon Michel Cymès, le docteur « cathodique », spécialisé en audience pour le troisième âge et les hypocondriaques. D’ailleurs, tout le monde se voulait rassurant. Le 18 février, l’OMS avait publié une déclaration pour minimiser la situation : la maladie “touche une très petite proportion de la population“, avec un taux de mortalité d’environ 2 %.
Par précaution néanmoins, la Russie ferma le 30 janvier ses frontières avec la Chine, principal foyer d’infections. Au passage, en France, notre gouvernement n’était mobilisé que par l’article 49.3 sur la réforme des retraites et ses élections municipales.
Puis à partir de février, la situation économique se dégrada rapidement : l’épidémie touchait de plus en plus de pays. Les mesures de confinement, d’arrêt des transports et des usines provoquèrent une baisse de la consommation mondiale. En Chine, les industries et entreprises de mégapoles importantes comme Wuhan, Pékin, Shanghai, Shenzhen ou encore Wenzhou baissaient leurs rideaux ou ralentissaient leur activité. Même constat pour les transports chinois : avions, voitures, camions et cargos désertent les routes aériennes maritimes et terrestres du pays. Aujourd’hui, après presque quatre mois de crise, l’activité ne reprend que très timidement en Chine
« Début mars, on ne connaissait pas encore toute l’ampleur des dégâts du virus », commente Roger Diwan, Vice-président d’IHS Markit, entreprise américaine d’information économique. « Les estimations étaient faussées car il n’y avait encore rien de grave en Italie et l’économie de la Chine commençait à reprendre. Personne ne prévoyait que la crise serait globale. On envisageait à l’époque une baisse de la demande de 2 millions de barils/jour. On est à moins 30 millions maintenant ! ».
Pour être précis, début mars, selon l’AFP, parmi les 81 pays infectés, les plus touchés après la Chine étaient la Corée du Sud, l’Italie, l’Iran ainsi que le Japon. Quelques jours plus tard, le nombre de pays passa à 92, avec une représentation plutôt similaire des principaux pays touchés. Le 25 mars, la Chine leva le déconfinement général, sauf pour Wuhan qui terminera sa quarantaine le 8 avril.
A cause du ralentissement des activités et de la consommation, le prix du baril du Brent ne cessait de fléchir depuis le début de l’année. Il était de 68 dollars en janvier. Il recula début mars à 50 dollars environ. Pour les producteurs de l’OPEP+, en particulier l’Arabie saoudite à qui cela posait de sérieux problèmes de budget, il fallait donc trouver rapidement un accord sur le niveau de production afin de stabiliser les prix. Toutefois, il faut souligner que Poutine et le Prince héritier se concertèrent dès le début du mois de février !
Ces dates nous interpellent. Nous avons vu que le 15 janvier, l’OPEP maintenait des prévisions de croissance de la demande de brut sur l’année. Le 25 janvier, la Chine confinait certaines métropoles. Or, le 2 février, deux semaines plus tard après la publication de l’OPEP, une réunion technique fut convoquée à Vienne avec la Russie pour parler des mesures à prendre au regard de la situation.
Or, en janvier 2020, le prix du pétrole s’était replié de – 5,3 % en dollars (la moyenne des cours du pétrole Brent s’établissait à 63,6 dollars par baril). Rien de dramatique. En février, mais sur l’ensemble du mois, la chute des prix fut un peu plus marquée (– 12,5 % après les – 5,3 % de janvier). La moyenne des cours du pétrole Brent en dollars se fixa à 55,7 dollars par baril contre 63,6 en janvier.
Ainsi, en l’espace de 15 jours, les opinions changèrent au sein de l’OPEP, suffisamment pour organiser en urgence des réunions techniques avec la Russie. Or, la volatilité des prix du pétrole est une donnée constante et, à l’époque, la crise se concentrait essentiellement sur la Chine. Pour preuve, en Italie, second foyer d’infection, le début officiel de la crise sanitaire date du 20 février, avec l’identification d’un malade de 38 ans, à l’hôpital de Codogno (Lombardie) !
Pourquoi donc une réunion le 2 février ? Ne peut-on imaginer d’autres raisons pour justifier la recherche d’un accord sur le volume de production ? Par exemple, le pétrole de schiste américain ? La question mérite d’être posée.
Nous relatons ici l’histoire officielle des discussions et plus loin les arcanes des échanges entre Poutine et MBS.
L’histoire officielle : le dresseur du faucon et le joueur d’échec
En fait, lorsqu’ils commencèrent à discuter de la situation, les deux dirigeants avaient en mémoire une « pilule amère ». Car en s’imposant à eux-mêmes des restrictions de production depuis 2016, les producteurs de l’OPEP+, Arabie Saoudite et Russie en tête, avaient finalement permis au pétrole de schiste américain de bénéficier d’un prix favorable. Ils avaient offert tout bonnement aux producteurs américains, et sur un plateau (en or noir), une opportunité rêvée : celle de rentabiliser leurs exploitations de pétroles de schistes, et donc de favoriser la croissance de leurs exportations sur le marché international.
Au cours des 10 dernières années, la part de marché du pétrole américain est passée de 7 % à plus de 14 %, au détriment notamment de la Russie et de l’Arabie Saoudite. Tout ceci à la grande satisfaction de Trump. Il y a un peu du cocu dans cette histoire.
Pour mettre un terme à cette situation de « cornuto » comme disent les italiens, l’Arabie saoudite proposa le 6 mars à Vienne une diminution de la production de pétrole mondiale de 1,5 million de barils par jour, dont 500.000 barils supportés par la Russie. La réduction avancée par Riyad avait pour objectif officiel d’absorber la baisse de la consommation chinoise et de maintenir les prix. Mais l’on sait que nos deux dirigeants avaient autre chose en tête. Le Kremlin avait fait déjà savoir dans les discussions préalables en février qu’il souhaitait une limitation à 600.000 barils pour l’ensemble des producteurs. Ce niveau lui semblait suffisant pour déstabiliser les producteurs de schiste américains, tout en maintenant un volume de production satisfaisant.
De l’avis d’un délégué de l’OPEP, les discussions furent « difficiles ». Nous allons en comprendre la raison. Alors que la réunion entre l’OPEP et ses alliés se poursuivaient, l’agence Bloomberg avait révélé quelques minutes plus tôt que Moscou souhaitait attendre le mois de juin avant de décider de nouvelles baisses de production. Selon une source à Interfax, au regard des discussions tendues, le ministre de l’Energie russe, Alexandre Novak, et son homologue saoudien ressentirent le besoin de discuter en aparté, dans le cadre d’un entretien bilatéral. Les saoudiens redoublèrent de pression sur les négociateurs russes. Finalement, à la surprise de tout le monde, Alexandre Novak, en accord avec Poutine, répondit par une fin de non-recevoir.
Soyons clairs : Poutine entendait profiter de la situation économique à l’encontre des Etats-Unis. Une façon de renvoyer à Trump la monnaie de sa pièce de dollar concernant les mesures américaines qui faisaient obstacle à Nord Stream 2, notamment les dernières décisions de décembre 2019. Mais il voulait en même temps défendre ses parts de marché. D’où une position plus mesurée que les saoudiens. Essayons d’entrer dans le raisonnement du dirigeant du Kremlin le 6 mars. Il avait observé que depuis mi-février, l’épidémie avait fini par gagner les Etats-Unis. La consommation de pétrole commençait à diminuer sur le continent nord-américain. Les prix aussi. Mais Trump n’avait pas encore pris les mesures d’interdiction d’entrée de ressortissants européens, ni les opérations de confinement. Elles n’interviendront que les 10 et 13 mars. Une fenêtre de tir s’ouvrait donc.
En laissant filer doucement le prix du baril, pour atteindre les 30 dollars pour le WTI, Poutine prévoyait que de nombreux producteurs américains de pétrole de schiste allaient courir à la faillite. Il n’avait pas tort. L’industrie du pétrole de schiste a une dette 6 fois plus importante que ses revenus. De plus, un rapport de l’agence Moody’s, dévoilé mi-février, indiquait que l’ensemble des sociétés d’exploration et de production aux États-Unis et au Canada avaient environ 86 milliards de dollars de dettes à rembourser entre 2020 et 2024. Et Moody’s précisait que 62 % de cette dette est considérée comme spéculative. Une partie d’échec se forma dans l’esprit du dirigeant russe.
Tout était donc une question de timing. En réduisant un peu sa production journalière, Poutine jugeait que le prix du baril continuerait de baisser du fait de l’épidémie, mais sans mettre le feu au marché. Il comptait sur l’importance de ses réserves financières pour tenir. Entre un prix du WTI à 30 dollars le baril, qui ferait des ravages, et sa contrainte budgétaire à 42 dollars, la partie était jouable. JPMorgan Chase avait déterminé un prix de revient à environ 45 dollars le baril dans le bassin Midland au Texas et à environ 55 dollars dans le bassin du Delaware.
En tout état de cause, les prix à la baisse du baril du WTI conduiraient les producteurs américains à réduire leur production de plusieurs milliers de barils. Et comme la mise en place d’un nouveau puit de pétrole de schiste implique un baril à 50 dollars pour couvrir les investissements, le risque d’avoir l’ouverture de nouveaux sites de production était quasi-nul. Porter un coup sévère au pétrole américain renforcerait à terme les parts de marché de la Russie. Et une fois la reprise de la consommation amorcée, sans doute au second semestre, le prix du baril devrait remonter singulièrement. Poutine avança donc sa tour vers le roi Trump. Mais il ignorait l’impulsivité du jeune MBS.
L’Arabie saoudite adhérait aussi au même constat que les russes. Cependant, la hausse de la production du pétrole de schiste américain, et la baisse des prix du baril qui s’en était suivie, avaient pénalisé la situation financière du royaume de façon inextricable. Bien plus qu’en Russie. Car contrairement à ce dernier pays, c’était l’Arabie saoudite qui portait le plus l’ajustement à la baisse de la production mondiale. MBS prit donc très mal la position de statut quo de son partenaire russe. Cela revenait à maintenir sur l’Arabie saoudite la pression financière occasionnée par la baisse des prix et le déséquilibre de son budget (cf. « coût d’équilibre fiscal »). Une seconde façon d’être « cornuto » … Pour « punir » la Russie en lui prenant rapidement des parts de marché, MBS réagit brutalement, malgré le désaccord de ses conseillers.
Le Prince héritier saoudien lança son faucon sur les opérateurs : il effectua le 9 mars la plus importante réduction de ses prix pétroliers en 20 ans, une vraie braderie pour ne pas dire boucherie : 10,25 dollars en dessous du baril de Brent. Parallèlement, sa société Aramco augmenta sa production pour passer à 12.000 barils jour dès avril, contre 9.800 début mars. C’est ainsi que MBS visait deux objectifs : d’une part, mettre un terme à l’exportation de pétrole américain, d’autre part, réduire les parts de marché de la Russie en Europe et en Asie, sachant que la production russe resterait à 11.000 barils jour. C’est une manœuvre typique d’une guerre des prix.
Notons qu’au même moment, soit aussi le 9 mars, l’AIE publiait son rapport mensuel, avec une forte révision à la baisse comparée à ses dernières prévisions de février ! La demande mondiale en 2020 allait se contracter de 90.000 barils par jour en moins par rapport à 2019. Cela aurait dû susciter quelques prudences de la part du Prince héritier saoudien. Sa décision allait aboutir à suramplifier la baisse des prix. Mais trop tard pour faire machine arrière.
Pour garantir les livraisons à ses futurs clients, Aramco comptait utiliser en cas de besoin ses réserves stratégiques de plusieurs dizaines de millions de barils de brut. Tout le monde serait ainsi servi. Cependant, les semaines suivantes montrèrent que le calcul du Prince héritier était en partie faux : l’ampleur de la récession internationale provoquée par le Covid19 était telle qu’elle ne suscita pas réellement de demande supplémentaire de pétrole ! A l’exception de l’Inde qui voulut montrer une forme de solidarité en augmentant ses réserves stratégiques, et quelques autres pays qui voulaient compléter à bas coût les leurs.
Pour faire face à la situation, les sociétés pétrolières avaient réduit les taux de traitement des raffineries et n’étaient pas pressées d’acheter des barils en plus. S’y ajoutait la hausse des taux de fret qui était également pénalisante.
En résumé, lorsqu’ils engagèrent leur bras de fer, début mars, on peut considérer, sans risque de se tromper, que les deux protagonistes avaient sous-évalué considérablement les conséquences à venir.
Avec une chute sans précédent de 30 % des prix du brut, le marché dévissa. Le baril de WTI était tombé sous la barre symbolique des 30 dollar, pour atteindre 27 dollars ! On aurait pu penser l’objectif contre l’industrie pétrolière américaine atteint, sans trop de réactions violentes de la part de Washington. On aurait donc pu en rester là et stabiliser les prix. D’ailleurs, Trump déclara à l’époque, dans un de ses tweets facétieux : « L’Arabie saoudite et la Russie se disputent au sujet du prix et des volumes du pétrole. Ceci ainsi que les fake news sont à l’origine de la chute du marché ! C’est bon pour les consommateurs, les prix de l’essence baissent » ! Trump n’avait pas encore confiné sa population… ni bien réfléchi. On vous l’a dit : « les fous ont pris le contrôle de l’asile ».
La machine était déréglée et personne n’y pouvait plus rien. La demande mondiale avait chuté de 30 millions de barils par jour, ce qui représente un recul d’environ 30 %. Presqu’un chiffre magique : moins 30 % pour la baisse des prix et pour la baisse de la production.
Tandis que la production se poursuivait, les stockages augmentaient, proches de leur capacité maximale. Et les prix continuaient leur évolution à la baisse. Pour en mesurer l’ampleur, le prix du pétrole Brent (de la mer du Nord), comme nous l’avons indiqué précédemment, atteignait 68 dollars par baril le 6 janvier 2020. A l’époque, les fortes tensions entre l’Iran et les Etats-Unis avaient fait grimper les prix. A la fin du mois de mars, le même baril de Brent se négociait à 23 dollars. Soit une variation de 45 dollars et une chute de 66 % en trois mois seulement. Lorsque les deux « apprentis sorciers » avaient commencé leurs discussions en février, le baril était à 63,6 dollars…
Cette guerre des prix a donc amplifié l’impact de la baisse des cours liée à la chute de la consommation du fait du Covid19. Bravo les gars… Les dégâts sont considérables, bien au-delà des bénéfices que les deux dirigeants avaient escomptés. Sous la pression des Etats Unis, la Russie et l’Arabie saoudite reprirent, mais avec difficulté, leurs discussions.
Halte au feu !
L’ampleur prise par la guerre des prix a engendré des conséquences préjudiciables pour tout le monde, à commencer par les producteurs américains, ce qui était initialement l’objectif recherché. Mais la réaction politique des Etats Unis fut assez violente, en particulier à l’égard du maillon faible : l’Arabie saoudite, considérée normalement comme un allié historique de l’Amérique.
Face aux arrêts d’exploitation de pétrole de schiste et au début en chaîne de faillites dans le secteur pétrolier, Trump se rendit compte finalement que cette chute n’allait pas beaucoup servir l’intérêt des consommateurs américains. Tous les propriétaires de voitures étaient confinés … A force des faire de Tweets intempestifs, on peut se les reprendre comme un boomerang dans la figure, surtout en si peu de délai. Ainsi, alors que la guerre des prix éclatait le 9 mars, moins de 15 jours plus tard, un important projet d’installation de traitement du gaz naturel de Shell Oil en Pennsylvanie, à Monaca, fut brutalement suspendu. Or, Trump avait inauguré la construction du site en août 2019, en déclarant aux ouvriers : « Vous avez de l’or sous vos pieds ». On utiliserait certainement une image différente aujourd’hui …
Alors que Trump faisait de la réussite de l’industrie pétrolière un argument de campagne pour les prochaines élections de novembre, le retournement de la situation pouvait le pénaliser gravement dans l’opinion en plein démarrage de sa campagne électorale. Un véritable défi s’engagea : stopper les dégâts du pétrole qui s’additionnaient à ceux de l’épidémie. Un vrai cauchemar. C’est en consultant au jour le jour la presse américaine que l’on peut mesurer comment la panique a gagné l’économie du pays, son Président, et le Parti Républicain.
En quelques jours, l’Administration Trump reçut de nombreux messages d’alerte sur l’impact social de la situation. Dans la seule semaine du 15 au 21 mars, 3,3 millions d’Américains s’inscrivirent au chômage, un chiffre historique, d’une ampleur jamais atteinte. En février, le taux de chômage était tombé à son plus bas niveau depuis des années : 3,5 %. En 3 semaines, il atteignit 10 %. Le risque de se retrouver à 15 % ne pouvait pas être exclu. On serait à 26 millions de chômeurs aujourd’hui et la pauvreté gagne rapidement du terrain. Pour saisir toutes les affres de la réalité sociale que revêt la misère aux Etats-Unis, il faut relire impérativement Steinbeck.
Le 13 mars, Trump déclara l’état d’urgence aux Etats-Unis. Le même jour, une douzaine de sénateurs républicains américains exhortèrent le « Prince héritier d’Arabie Saoudite » à prendre des mesures pour apaiser les tensions sur le marché pétrolier.
Le 14 mars, Trump répondit favorablement à la proposition de lobbyistes pétroliers de renforcer les réserves stratégiques, ce qui permettrait d’absorber 77 millions de barils. « Nous allons remplir le SPR (Strategic Petroleum Reserve) jusqu’au sommet, sauver les contribuables américains des milliards et des milliards de dollars, aider notre industrie pétrolière », avait déclaré la Trump la veille.
Le 22 mars, le Secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin annonça que l’Administration allait lancer un plan de relance américain de 4.000 milliards de dollars pour soutenir l’économie. Mais l’intervention de la puissance publique suscita une vive résistance du Congrès. Certains démocrates soupçonnaient un risque de corruption de l’Administration, tentée de renflouer les amis de Trump et ses bailleurs de fonds politiques, en particulier les producteurs de pétrole du Texas et de l’Oklahoma.
Le 24 mars, à l’occasion d’un webinar de Schlumberger Ltd. destiné aux analystes et aux investisseurs le directeur financier de Halliburton (Houston), Lance Loeffler, fit une remarque qui jeta un large trouble dans la communauté des producteurs : « Wall Street est désormais fermée à l’industrie du schiste. Il n’y a plus de bouée de sauvetage. Les marchés financiers ne prêtent plus leur soutien. »
Le 25 mars, le secrétaire d’État Michael Pompeo s’entretint avec MBS à la veille d’une conférence téléphonique entre les dirigeants du « Groupe des 20 », et il exhorta le dirigeant saoudien à « saisir l’occasion et rassurer » les marchés de l’énergie en période d’incertitude économique. Sans grand succès. Le même jour, le Sénat et la Maison Blanche trouvèrent un accord pour fixer à 2.200 milliards de dollars le plan de relance, avec la décomposition suivante : 30 % d’aides à la population (aide directe, chômage, report des prêts étudiants), 25 % pour les grandes entreprises en difficulté en servant de fond d’amorçage pour les prêts de la Fed ; 19 % pour les PME (sous forme de prêts non remboursables si aucun salarié n’est licencié et les salaires payés), 17 % pour les Etats américains et les communes 9 % pour les services public, dont l’hôpital.
Le 4 avril : réunion de Trump avec les représentants de l’industrie pétrolière. C’est à cette occasion qu’il prit conscience de la difficulté à dégager un consensus sur les mesures à prendre : entre les grandes multinationales et les producteurs de pétrole de schiste, rien n’allait plus. Aux États-Unis, il y a plus de 6.000 foreurs de pétrole, avec de nombreuses petites entreprises de pétrole de schiste du Texas et du Dakota du Nord. Face à eux, il y a des géants mondiaux comme Exxon Mobil Corp. Bien avant la guerre des prix, les premiers étaient favorables à des mesures de réduction obligatoire de la production, et les multinationales opposées à tout type d’intervention gouvernementale. La culture du libéralisme n’est pas aussi forte que l’on croit dans le temple du capitalisme … Les petits patrons sont interventionnistes.
Le 9 avril, Schlumberger, une entreprise phare du secteur, diffusa un communiqué par lequel elle annonçait une mise en disponibilité de ses employés, la modification des horaires de travail, la réduction de la rémunération des dirigeants de 20 %.
Le même jour, près de 50 représentants républicains américains adressèrent une nouvelle lettre à MBS, en montant cette fois-ci d’un cran la pression. Ils attiraient son attention sur les « conséquences diplomatiques » qu’entraînait sa position rigide. En d’autres termes, la coopération économique et militaire entre Washington et Riyad était menacée, à moins que le royaume ne contribue à stabiliser les prix du pétrole en réduisant la production de brut. « Si le royaume ne parvient pas à agir équitablement pour inverser cette crise de l’énergie manufacturée, nous encouragerions toute réponse réciproque que le gouvernement américain jugerait appropriée », était-il indiqué dans la missive. Les signataires représentaient environ un quart des républicains à la Chambre des représentants des États-Unis, qui est contrôlée par les démocrates.
Cette initiative rejoignait celle, plus ancienne, du confident de Trump, le milliardaire de schiste Harold Hamm. Il avait demandé le 11 mars que les États-Unis sanctionnent les Saoudiens avec des tarifs antidumping et il s’était même proposé de déposer une plainte auprès du département américain du Commerce contre l’Arabie saoudite pour dumping « illégal ». Bref, le ton montait sérieusement.
Le 24 avril : face à la multiplication des annonces de licenciement, Steven Mnuchin annonça qu’il envisageait la création d’un programme de prêt gouvernemental pour les sociétés pétrolières américaines en attente d’une aide fédérale, « alors qu’elles font face à une chute des prix dévastatrice ». Une partie du lobby pétrolier proposa une mesure supplémentaire, consistant à percevoir une certaine forme de taxe sur le pétrole importé entrant aux États-Unis, en vertu du Trade Expansion Act de 1962.
Le même jour, un mois après le lancement du plan de relance de 2.200 milliards de dollars, le Sénat et les élus de la Chambre des représentants validèrent une enveloppe supplémentaire de 483 milliards de dollars. Mais certains républicains n’avaient pas oublié le premier montant annoncé par Steven Mnuchin : les 4.000 milliards. Pour situer les choses, cette somme représente environ un cinquième de la richesse annuelle produite par l’économie américaine et son montant semble plus adapté à l’ampleur de la récession.
Au vu de l’aggravation de la situation sociale il est fort à parier que de nouvelles mesures seront engagées par l’Administration Trump en mai ou en juin, sans doute via la Fed. Car de premières révoltes gagnent de plus en plus du terrain parmi les américains qui veulent retourner travailler : au Michigan, au Minnesota, en Virginie, au Texas, au Maryland, en Ohio, etc., Trump les soutient fustigeant au passage les gouverneurs démocrates qui selon lui « sont allés trop loin…certaines actions n’étaient probablement pas nécessaires ». Toutes les opportunités sont bonnes pour taper sur l’adversaire en campagne électorale.
Parallèlement au plan de sauvegarde de l’économie, la normalisation du marché du pétrole a été et reste à ce jour un impératif pour Washington. D’où la pression qui fut exercée par Trump sur la Russie et l’Arabie saoudite pour trouver un compromis. Le Président américain s’y engagea pleinement, d’autant plus que les deux protagonistes ne faisaient pas beaucoup d’efforts pour se parler. Leur façon de jouer la montre était de réclamer que les Etats-Unis participent aussi à l’effort de réduction de la production. Or, la réglementation anti-trust aux Etats-Unis interdit toute négociation avec l’OPEP+, considéré comme un cartel. De plus, les grands groupes pétroliers américains sont allergiques aux réglementations et veulent maintenir leur indépendance. Autant Poutine et MBS ont la main sur leur industrie pétrolière, autant Trump n’a d’autres possibilités que de trouver un consensus entre les petits producteurs et les multinationales.
Au vu de ses efforts, deux réunions (virtuelles) furent organisées les 9 et 12 avril entre la Russie et l’Arabie saoudite. Mais Trump avait déjà annoncé dans un tweet l’éventualité d’un accord le 2 avril, ce qui fut démenti ensuite par le Kremlin. Cette précipitation était-elle une technique de négociation ou encore une bévue ? Toujours est-il que cela entraîna une augmentation quasi immédiate du baril de 40% ! La plus grande hausse dans l’histoire du pétrole en 24h ! Des tweets en or…
Le 10 avril, le Kremlin annonça que Poutine avait parlé à MBS et que « tous deux s’étaient mis d’accord sur davantage de contacts Russo-saoudiens » dans le contexte de la réduction de la production de pétrole. Le même jour, Trump fit mention que le président mexicain Obrador, et lui-même avaient trouvé un arrangement pour réduire la production du Mexique, ce qui permettait de lever le dernier obstacle aux négociations au sein de l’OPEP+. Le Mexique diminuerait sa production de 10.000 barils jour et les Etats-Unis accompagneraient ce mouvement par une réduction supplémentaire de 250.000 barils jours par rapport à leurs engagements précédents.
Le 12 avril, Poutine téléphona à Trump et au roi Salmane d’Arabie saoudite pour confirmer qu’un accord avait été trouvé au sein de l’OPEP+. Cela conduisit Trump à féliciter, toujours par tweet, les deux dirigeants pour la conclusion de cette négociation. Mais est-ce la fin de l’histoire ?
Un accord qui n’a pas convaincu les marchés
En l’espace de quelques jours, la pression américaine permit d’ouvrir un espoir : l’arrêt de la chute des prix du baril. Le principe, et plus encore le pari, était de stabiliser le marché pétrolier en réduisant la production, le temps nécessaire à une reprise de la croissance entraînant une augmentation de la consommation. D’où un accord conclu pour une période de 2 ans, du 1er mai 2020 au 30 avril 2022. Il prévoit 3 phases avec des réductions de production de pétrole diminuant au fur et à mesure de la reprise économique mondiale.
- La première phase couvre la période mai-juin 2020, avec une réduction de la production de 9.700.000 barils par jour, ce qui entraîne une réduction de 10 % sur l’année. Comme elle constitue un test pour la suite, les pays du G20 ont promis une coopération accrue.
- La seconde couvre le deuxième semestre 2020, avec une réduction de la production de 7.700.000 barils par jour.
- La dernière phase se déroulera du 1 er janvier 2021 au 30 avril 2022, avec une réduction de 5.800.000 barils par jour. L’Arabie saoudite et la Russie se partageront, à part égale, la moitié des baisses de production décidées le 12 avril.
Tout dépend donc du potentiel de reprise à la rentrée et de la dynamique de croissance qui s’en suivra sur l’année 2021. Compte tenu du poids de la Chine, c’est certainement sur ce pays que les attentions devraient se porter pour vérifier le bien-fondé de ce scénario, et notamment à deux niveaux : la reprise de ses exportations mais surtout le redémarrage du transport aérien. Ce secteur ne représente que 1 % du PIB mondial, mais près de 10 % de la consommation de brut. Or, la Chine est une plaque tournante importante de la demande mondiale de kérosène (environ 10,7 %). Il y a donc une interrogation qui, en elle-même, peut servir d’indicateur pour la vigueur de la reprise économique : à quel rythme reprendront les déplacements en avion et avec quel niveau de fréquentation (volume de voyageurs transportés versus celui de l’avant-crise) ? Certains prédisent que lorsque l’épidémie sera passée, cela sera très lent, car les gens hésiteront à voyager…
Malgré les engagements pris dans l’accord, la baisse du baril se poursuivit dès le 13 avril ! En fait, les marchés avaient anticipé une réduction encore plus importante de la production : de l’ordre de 15 à 20 millions de barils par jour. Or, pour l’OPEP+, l’effort lié à l’accord représente une réduction de 23 % de la production des pays membres, en prenant comme référence les allocations de production d’octobre 2018. Difficile d’envisager d’aller plus loin. Cependant, pour beaucoup d’analystes et surtout d’investisseurs, cet accord était arrivé trop tard et les coupes dans la production ne seraient pas suffisantes pour répondre à la chute de la demande de brut.
C’est pourquoi l’OPEP+ lança un appel aux autres pays producteurs en leur demandant de réduire eux-aussi leur production de 5 millions de barils jour. Si cet objectif était atteint, ce serait environ 15 millions de barils jour retirés du marché. Pour ce faire, plusieurs membres de l’OPEP+, et d’autres producteurs non adhérents à l’organisation, s’entretinrent par visioconférence le 21 avril. Il semblerait que ces producteurs aient accepté de réduire leur production de 3,7 millions de barils jour, ce qui permettrait de se rapprocher de la cible souhaitée par les marchés. Il faut cependant noter que ni la Russie, ni l’Arabie saoudite n’avaient participé à cette visioconférence.
Le même jour, le 21 avril, la colère redoublait parmi les producteurs de pétrole de schiste. Ils avaient eu connaissance qu’une flottille de 19 pétroliers saoudiens supergéants – chacun capable de contenir 2 millions de barils de pétrole – était en route vers les États-Unis ! Selon Reuters, « les pétroliers transporteraient sept fois plus de pétrole saoudien que le royaume n’en expédie habituellement sur la côte américaine du golfe du Mexique ». Une véritable provocation pour les américains, alors que leurs centres de stockage étaient proches de la saturation. Une opération perçue comme visant à déstabiliser encore un peu plus l’industrie pétrolière américaine. Répondant à une question d’un journaliste, Trump annonça que son administration examinerait une proposition visant à bloquer les expéditions de pétrole saoudien aux États-Unis. Le sénateur américain Ted Cruz lança un message sur Twitter qui en dit long sur la dégradation des relations entre les deux « alliés » : « My message to the Saudis : Turn the tankers the hell around »
Le 22 avril, les contrats à terme WTI se négociaient entre 13,72 et 16,18 dollars le baril. Une situation pire que lors du début de la guerre des prix début mars.
Le 25 avril un responsable de l’industrie saoudienne indiqua qu’Aramco avait commencé à réduire sa production de pétrole, pour atteindre le niveau convenu de 8,5 millions de barils par jour, avant la date de début du 1er mai. Le Koweït et l’Algérie semblaient avoir procédé de même et le Nigéria également, ce pays ayant déjà atteint ses limites de stockage. Des pays africains, membres de l’Organisation des producteurs de pétrole africains (APO), qui avaient approuvé cet accord, annoncèrent leur volonté de prendre des mesures allant dans le même sens. Tous les petits producteurs sentaient venir la ruine.
A l’annonce de ces efforts, le marché resta inerte… En fait, encore aujourd’hui, il n’y croit toujours pas, car il a en mémoire les bidouilles du passé. « Le quota global de production décidé lors de la précédente réunion de l’OPEP (NB : avant celle de mars 2020) a été atteint uniquement grâce à des arrêts involontaires de production en Iran, au Venezuela et en Libye », affirme Alexandre Andlauer. Trois pays qui étaient exemptés de coupes volontaires, rappelle l’analyste. « Les autres pays de l’OPEP ont augmenté leur production depuis octobre (2016). Quelle confiance, alors, accorder à de nouvelles coupes potentielles ? ». La Russie, elle aussi, avait été accusée à plusieurs reprises comme ne respectant pas son quota. Cela, le Prince héritier aussi le savait … Poker menteur, on vous l’a dit !
Le retour des Shadocks !
Dans le film « Fantasia » de Walt Disney, l’épisode de l’apprenti sorcier n’ayant pas réussi à maitriser les forces magiques est une très belle métaphore de la situation actuelle. Poutine et MBS sont dans la même situation : impuissants à juguler la chute des prix. Le marché continue d’être inondée par les producteurs qui ne peuvent arrêter d’exploiter leurs gisements, sauf à en subir des conséquences irrémédiables ensuite, comme nous l’expliquerons. La consommation baisse mais la production se poursuit aux Etats-Unis (et ailleurs) : il y a donc un déséquilibre croissant entre l’offre et la demande sans que rien ne stoppe ce mouvement suicidaire. On vous avait prévenu : une histoire de fous.
Cela rappelle les épisodes des Shadocks : « Ils pompaient le matin, ils pompaient l’après-midi, ils pompaient le soir, et quand ils ne pompaient pas… ils rêvaient qu’ils pompaient » ! Ou encore : « « Il vaut mieux pomper même s’il ne se passe rien, que risquer qu’il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas ». Une réflexion digne des tweets de Trump.
Plus sérieusement, l’arrêt d’exploitation est une mesure difficile à prendre pour les producteurs américains. Lorsque les prix baissent, les entreprises agissent souvent assez rapidement pour réduire le forage – bien avant de fermer la production existante. Mais dans les circonstances actuelles, les décisions sont cornéliennes. Pour simplifier, soit la fermeture est définitive, soit elle est temporaire.
Si elle est définitive, son impact n’est pas immédiat. En effet, le pétrole brut dans un pipeline peut prendre des semaines pour atteindre sa destination, ce qui signifie que le pétrole acheté à la fin mars pourrait encore être en transit à la fin avril. Donc, il y a un délai de latence et il faudra attendre quelques semaines pour constater la baisse effective de la fermeture des puits sur le territoire. Pour mémoire, le nombre d’appareils de forage actifs est tombé de 825 il y a un an à moins de 440 aujourd’hui ! Mais le compteur tourne.
Si l’arrêt est temporaire, c’est l’avenir qui est néanmoins compromis. Pourquoi ? Parce que la remise en activité d’un puit nécessite, de façon certaine, de réinvestir pour obtenir le même niveau de production qu’avant la fermeture. Cela augmente le coût d’exploitation, dans un marché plutôt tendu au niveau des prix. Si bien que beaucoup de producteurs, qui ont l’espoir d’un retournement sur le marché, refusent la fermeture temporaire et continuent de produire, même à perte, pour autant qu’ils disposent de quelques recettes. Tout dépend de leur situation financière, de leurs dettes. Les banques créancières les poussent de plus en plus à la fermeture. Parfois, ils sont contraints de continuer l’exploitation à cause d’obligations contractuelles : par exemple, des baux qui les obligent à forer sur le terrain loué. Certains ne veulent pas prendre le risque d’une résolution de la location qui ferait transmettre à bon compte le bail à un concurrent.
Il existe cependant une option mixte : fermer les puits les plus récents, ceux qui ont occasionné un coût de mise en œuvre important et maintenir les puits les plus anciens qui produisent moins. Ce n’est pas l’avis d’un expert, Raoul LeBlanc, Vice-président d’IHS Markit. Pour lui, il vaut mieux fermer les puits conventionnels et maintenir ceux qui sont les plus productifs. Les premiers ne produisent seulement que quelques dizaines de barils par jour, ce qui représenterait 1,75 million de barils par jour. Cependant, les seconds, plus récents, pourraient aider à attendre la reprise, en fournissant une partie de flux de trésorerie, même s’ils la production est à perte.
Une dernière raison peut expliquer l’hésitation des exploitants : le risque que représentent les puits d’hydrocarbures abandonnés et les possibles contentieux en matière d’environnement qui peuvent en résulter par la suite. Le journal le Monde en avait présenté une analyse détaillée. A partir de la conclusion d’une étude américaine publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, le journal indiquait que si les puits « n’offrent plus de combustibles à brûler, ils demeurent, longtemps, une source insoupçonnée de gaz à effet de serre – d’autant plus problématique qu’elle n’est souvent pas comptabilisée dans les inventaires nationaux ». Prenant l’exemple de la Pennsylvanie avec 470.000 à 750.000 puits en déshérence, l’étude précisait que les émissions de méthane devraient être rehaussées de 5 % à 8 % par rapport aux chiffres officiels ! Le méthane est un gaz à effet de serre très puissant, qui a un pouvoir de réchauffement climatique 25 à 30 fois supérieur à celui du CO2.
Robert Howarth, professeur à l’université Cornell (New York), rappelait dans l’article qu’à travers l’ensemble des Etats-Unis, le nombre de puits de pétrole ou de gaz abandonnés était estimé à l’époque à plus de 3 millions, et ce nombre allait augmenter dans le futur. Il ajoutait : « Au niveau mondial, la concentration de méthane dans l’atmosphère augmente rapidement, depuis environ 2009, après une décennie de quasi-stagnation. Des études récentes indiquent que les Etats-Unis sont bien une source majeure de ces émissions. »
La décision de fermer un puit est donc le résultat de pressions mais aussi de plusieurs calculs, avec comme premier élément la question « shakespearienne qui tue » : croire ou ne pas croire en une reprise prochaine ? Ensuite, peut-on stocker la production ou pas en attendant la bonne nouvelle ?
Car la raison essentielle de la chute des prix du pétrole WTI réside dans la congestion mondiale du stockage, et plus spécifiquement aux Etats-Unis. Si l’on pouvait stocker toute la production actuelle, il y aurait moins de problème. Les surcoûts pourraient être lissés et compensés sur la durée. Or, la nature même des exploitations américaines impliquent surtout, comme nous l’avons dit, un stockage sur terre et non sur mer.
Voyons les chiffres. Durant la semaine du 10 avril 2020, le niveau des stocks américains de pétrole avait augmenté de 19,2 millions de barils jour (Mbj), atteignant un volume total de 504 millions de barils. « Soit environ 64 % de la capacité totale de stockage de pétrole disponible aux États-Unis, estimée à 782 Mb », constate IFP Énergies nouvelles. La situation est « encore plus tendue à Cushing », site de stockage stratégique dans l’Oklahoma(1) dont le taux d’utilisation avoisine 70 %(2) par rapport à une capacité maximale de 76 millions de tonnes. Au rythme où le site (on dit le hub) de Cushing se remplit – une moyenne de 16 millions de barils par semaine au cours des trois dernières semaines – les analystes affirment que le site pourrait atteindre sa capacité à la mi-mai, ou au plus tard au cours des premières semaines de juin. Fantasia vous dis-je.
La situation n’est pas meilleure dans le monde. Tout est proche de la saturation, avec des centaines de millions de barils de brut stockés au cours des deux derniers mois. Rappelons que les baisses d’activités (arrêt d’usines, des transports, etc.) liées aux coronavirus ont effacé environ un tiers de la demande mondiale de pétrole en quelques mois.
En outre, « nombre de sociétés disposent de contrats cadres avec les organismes de stockage » et certaines capacités apparemment disponibles « sont en réalité déjà réservées, c’est à dire inaccessibles », soulignait Benjamin Louvet, gérant matières premières chez OFI Asset Management. Ernie Barsamian, directeur général de The Tank Tiger, un centre d’échange de stockage de terminaux à Princeton, dans le New Jersey confirmait ce point : « Les terminaux ont déjà contracté leur stockage à 100 % ».
A partir de ce constant début avril, et partant de l’hypothèse d’un sur-approvisionnement du marché d’environ 25 millions par jour, Benjamin Louvet estimait que les capacités de stockage mondiales seraient complètement saturées au bout de quarante jours ! Donc à mi-mai 2020. l y a quelques jours, Bjørnar Tonhaugen, analyste responsable des marchés pétroliers chez Rystad Energy, avançait même cette date. Pour lui, le stockage mondial de pétrole à terre serait saturé dès les premiers jours de mai. Par conséquent, selon lui, il fallait s’attendre dans les semaines à venir à des prix très bas, sans précédent dans les semaines à venir. Opinion partagée par Paul Sankey, analyste pétrolier de Mizuho Securities, expert reconnu car il avait mis en garde, dès le mois de mars, contre des prix négatifs. Récemment, il déclarait : « Allons-nous atteindre un prix négatif de 100 dollars le baril le mois prochain ? C’est fort possible. Le monde des prix négatifs n’a pas de plancher, et après cette semaine, tout est possible ». Il faut donc trouver d’autres solutions de stockage, mais lesquelles ?
Un coût de stockage flottant devenu prohibitif
L’idée qui est venue en premier est le stockage flottant, c’est-à-dire stocker son pétrole sur un pétrolier. Aujourd’hui, il y aurait environ 160 millions de barils de pétrole sur des pétroliers en attente d’acheteurs. Une paille… mais en or. Pour les armateurs.
Globalement, on dénombre environ 770 VLCC (very large crude carriers) des supertankers capables de transporter 2 millions de barils. D’une soixantaine, sollicités il y a quelques semaines pour du stockage et non pour du transport, on pourrait atteindre plusieurs centaines en raison d’une très forte demande. Les flottes de pétroliers disponibles se trouvent généralement dans le golfe du Mexique et au large de Singapour.
Sur ce marché du stockage flottant, les prix ont considérablement augmenté depuis février. Ashok Sharma, directeur général du courtier maritime BRS Baxi à Singapour, déclarait à Asia Times Financial que les prix de fret quotidiens moyens pour les VLCC étaient de l’ordre de 10.000 dollars par jour en 2019. Puis les prix ont augmenté en 2020, passant de 25.000 à 30.000 dollars par jour avant la crise, jusqu’à atteindre 170.000 dollars il a quelques semaines. Aujourd’hui, les centres de stockage étant saturés, on est plutôt à des coûts d’affrêtement de l’ordre de 335.000 dollars par jour ! A ce prix-là, les armateurs préfèrent arrêter les activités de transport pour se repositionner essentiellement sur le stockage. En raison de l’augmentation de la demande, des navires de taille plus modeste seraient même utilisés.
Il est évident que le coût d’affrêtement pratiqué actuellement est inabordable pour les petites et moyens producteurs. Ceux-ci, sans autre solutions alternatives sur terre, se voient contraints de fermer leurs puits. C’est encore une fois la taille du producteur et sa surface financière qui expliquent le recours au stockage flottant : essentiellement des majors comme Royal Dutch Shell qui a réservé plusieurs VLCC récemment.
On estime que 80 à 100 supertankers stockent désormais du pétrole au large de la côte américaine du golfe du Mexique et dans les eaux étroites du détroit de Singapour, à proximité des principales capacités de raffinage. Comme nous le laissions entendre, avec une offre de pétrole toujours bien supérieure à la demande, jusqu’à 200 supertankers, voire plus, pourraient être nécessaires selon les prévisions de l’industrie.
Dans certaines régions pétrolières, le stockage flottant n’est pas sans risque. Ainsi, selon Verisk Maplecroft, consultant en risques politiques, ce stockage sur mer va augmenter les attaques de pirateries en Afrique de l’Ouest. Les pirates souffrent comme tout le monde de la situation. Monter à bord de pétroliers statiques, utilisés comme installations de stockage offshore pour la production invendue, est une aubaine. « L’équipage et la cargaison des navires représentent des cibles idéales et relativement simples pour les pirates ».
Autre risque : des naufrages avec pollution. Ainsi, aux Etats-Unis l’augmentation des pétroliers sur les côtes ont conduit les Coast guards à multiplier les contrôles. Le risque d’un accident environnemental est pris de plus en plus aux sérieux.
La guerre des prix conjuguée à la course à la hausse de la production de pétrole lancée par Riyad au lendemain de l’échec de la réunion OPEP+ du 6 mars, paraît avoir atteint l’objectif stratégique recherché : faire apparaître l’Arabie saoudite comme un acteur déterminant et incontournable de la stabilité des marchés de l’Energie, tout particulièrement dans cette période de crise économique la plus profonde de l’histoire récente. Cette stratégie, en accélérant, en l’espace d’un mois, la chute des prix du pétrole à leur niveau le plus bas depuis 2003, aura provoqué, sous la pression déterminante des Etats-Unis, le retour à la table des négociations des principaux acteurs de l’OPEP+.
Un difficile recours à la SPR aux Etats-Unis
Une solution « simple », avancée par Trump le 14 mars comme nous l’avons indiqué, consisterait à compléter la Strategic Petroleum Reserve (SPR). C’est la plus grande installation de stockage du pays, avec une capacité de 713,5 millions de barils de pétrole brut dans des cavernes souterraines de sel, le long de la côte du Golfe. Mais, à la mi-avril, il y avait déjà 635 millions de barils de brut stockés, soit un taux de remplissage de 89 %.
Creusons un peu plus cette proposition. La SPR ne se contente pas de stocker du pétrole. Elle doit stocker de l’huile de différentes compositions chimiques pour répondre aux multiples besoins de raffinage (essence, diesel, fioul lourd, naphta, bitume, etc.). Sinon, cela n’aurait guère de sens en tant qu’approvisionnement d’urgence. Il existe donc une contrainte technique à ce recours à la SPR.
Explication. Sans rentrer dans trop de détails, les pétroles très légers comme ceux issus des hydrocarbures de schiste, doivent impérativement être coupés avec des références de brut plus lourdes pour faire fonctionner les raffineries à plein régime. Les raffineries américaines ont été construites autour de « process » optimisés pour des bruts plutôt lourds. Dit autrement, les Etats-Unis doivent et devront toujours importer du pétrole de qualité plus lourde. Ils le font avec le Canada qui leur fournit du pétrole issu des sables bitumineux ou du golfe du Mexique. Les importations représentent ainsi environ 6 millions de barils jours, en majorité du Canada. Mais l’on trouve aussi du pétrole d’Arabie Saoudite (600.000 barils par jour) et d’autres pays du Moyen-Orient pour un total de 1,2 million de barils par jour. Au passage, il était donc faux de prétendre, comme certains, que les Etats-Unis étaient autosuffisants en matière de pétrole. Il leur faudra toujours importer du lourd.
La conséquence de cette situation, c’est que la SPR ne peut pas surstocker du « shale oil » (car beaucoup trop léger), ce qui impliquerait de recourir davantage au pétrole importé, notamment du Moyen Orient… et marginalement du Texas, si sa viscosité est compatible avec celle du pétrole de provenance off-shore.
Un vrai casse-tête qui permet de comprendre que production et raffinage sont très interdépendants. La diversité des besoins de consommation du marché implique un outil de raffinage adapté, et une diversification des sources d’approvisionnements en qualités de pétrole.
Cela nous ramène à nos pétroliers saoudiens que le sénateur Ted Cruz avait prié vertement d’aller se faire voir ailleurs. La situation confine à l’absurde, n’est-ce pas ? Il y a une surproduction de Shale Oil, mais la SPR ne peut pas l’intégrer dans ses stocks sans aussi importer du lourd, car les caractéristiques du pétrole de schiste ne répondent pas à l’ensemble des objectifs stratégique du stockage.
Mais ne dit-on pas qu’une règle fixée par la loi peut être modifiée par la loi ? Par conséquent, le 20 avril, Trump a relancé l’idée d’un achat majeur pour le SPR. En outre, selon son Administration, cette option présenterait un intérêt financier. L’achat de pétrole brut national pour la SPR serait non seulement un soutien pour l’industrie, mais la faiblesse actuelle des prix pourrait réduire les coûts d’achat en les moyennant à la baisse. En effet, le coût d’acquisition moyen pour le pétrole déjà stocké dans la SPR s’élève à environ 50 dollars. Avec un prix en deçà de 18 dollars aujourd’hui, il peut y avoir un intérêt à procéder à l’opération. Le plan de relance américain avait prévu d’ailleurs un budget de 38 millions de dollars à cette fin. En tout état de cause, le recours à la SPR ne pourrait être que très ponctuel.
The shut and swap idea
Début avril, une idée originale a germé dans l’esprit d’un financier, Greg Pardy, codirecteur de la recherche énergétique mondiale à RBC, l’une des plus grandes banques du Canada. On sait que ce pays subit de plein fouet également le choc pétrolier. Comme aux Etats-Unis, l’industrie pétrolière canadienne attend du gouvernement un plan de sauvetage. Les producteurs devraient fermer ou réduire entre 1,2 à 1,7 million de barils jour, soit entre un quart à un tiers de l’offre au cours des 2ème et 3ème trimestres.
Le dispositif proposé est le suivant : le gouvernement canadien achèterait du pétrole aux producteurs à un prix défini. Mais les producteurs devraient laisser leur pétrole dans le sous-sol jusqu’à ce que les prix remontent. Cela impliquerait une fermeture temporaire. Au moment où les prix atteindraient un certain niveau, les producteurs recommenceraient à extraire leur pétrole et à le vendre, mais à un prix plus élevé que celui que le gouvernement leur a payé. Avec le produit des ventes, ils rembourseraient ensuite le gouvernement. C’est l’idée du « Fermez et échangez ».
Pour Greg Pardy, l’argument majeur en faveur de cette technique financière réside dans le fait qu’elle assure aux producteurs une trésorerie immédiate, face à la gravité de la crise. Par comparaison, d’autres formules ou crédits d’impôts ne permettraient pas de générer des flux de trésorerie aussi rapidement. Le gouvernement canadien pourrait facturer des intérêts au taux de base de la Réserve fédérale et le contribuable serait finalement remboursé en totalité. En résumé, ce dispositif serait un moyen de garder intacts les flux de trésorerie des entreprises tout en freinant la surproduction. Une idée qui a séduit les banques et les fonds spéculatifs, mais qui politiquement n’a pas rencontré beaucoup la faveur des contribuables. On se méfie des montages financiers des banques…
Cette idée a néanmoins traversé la frontière des Grands Lacs pour atteindre l’Administration de Washington. L’on s’y est dit que la SPR pourrait effectivement payer les producteurs pour qu’ils gardent leur pétrole sous terre ; quelques 365 millions de barils tout de même. C’est une décision possible sur le plan légal. Du moins, rien ne semble l’interdire et elle serait donc une prérogative du ministère de l’Energie. La loi de 1975 sur la politique énergétique et la conservation de l’énergie, qui décrivait les limites et le rôle du SPR, permettrait au gouvernement (restons au conditionnel) de maintenir dans le sous-sol jusqu’à un milliard de barils de réserves de brut.
On se pose alors la question : mais pourquoi depuis l’annonce de Trump le 14 mars, les choses n’ont pas avancé ? Tout simplement parce que la décision d’achat pour la SPR nécessite l’approbation du Congrès ! Or, les démocrates du Congrès, majoritaires, ont bloqué le 25 mars une demande de l’Administration Trump d’un budget de 3 milliards de dollars afin d’acheter jusqu’à 77 millions de barils de pétrole destinés à la SPR. Cela aurait soulagé les producteurs américains, mais la plupart sont des électeurs et soutiens financiers des républicains. Les démocrates ne sont pas masos…
Face au refus du Congrès, Trump a trouvé une astuce pour contourner l’obstacle : celle de louer le volume de stockage restant disponible dans la SPR. Concrètement, il s’agit de mettre à disposition la capacité disponible par le biais d’un échange par lequel le producteur paye en pétrole plutôt qu’en dollars. L’accord est essentiellement un contrat impliquant un stockage temporaire du brut en excès dans le SPR. Bien sûr, démocrates et écologiques, comme « Friends of the Earth » fourbissent tous les arguments juridiques possibles pour empêcher cette opération de location. On attend la suite.
La location de réservoirs de fracturation
Parmi toutes les solutions plus ou moins hasardeuses avancées, l’une d’elle mérite néanmoins d’être étudiée. Elle consisterait à réutiliser les « réservoirs de fracturation ». Un réservoir de fracturation contient généralement de l’eau ou un mélange chimique appelé fluide de fracturation avant d’être pompé dans un nouveau puits en construction. Or, il y aurait beaucoup de réservoirs de fracturation inactifs, d’où l’interrogation suivante de certains producteurs : ces réservoirs pourraient-ils contenir autre chose que des fluides de fracturation ? En d’autres termes, du pétrole brut ? Sachant qu’un réservoir pourrait contenir 500 barils de pétrole ?
Passant outre ces questions, le marché de la location de réservoirs a augmenté de 33 % en quelques semaines. Imaginez si quelqu’un avançait l’idée de stocker du pétrole dans les piscines de particuliers… En raison de cette hausse des prix, certains producteurs ont refusé de s’engager dans cette voie. Le PDG de Teal Natural Resources, John Roby, un producteur de schiste avait fait le calcul suivant : stocker la valeur d’un mois de production coûterait à Teal environ 20 dollars par jour par réservoir, soit environ 300.000 dollars par mois. À ces taux, le patron a préféré fermer ses puits.
Cette quête au stockage suscite beaucoup de créativité. Il y a de l’argent à faire. Par exemple, Caliche Development Partners, stocke des liquides de gaz naturel dans des cavernes souterraines près de Houston. L’entreprise a le projet d’ouvrir une nouvelle caverne souterraine de sel, de 3 millions de barils pour le pétrole brut ou l’essence. Mais ces deux carburants nécessiteraient l’achat de nouvelles pompes. Aux acheteurs intéressés, l’entreprise profite de son rapport de force en leur imposant la prise en charge du coût des investissements de mise à niveau des installations.
Vers la réduction obligatoire ?
À défaut de capacité de stockage, la dernière possibilité est d’imposer une réduction de production aux producteurs. Une démarche contre-nature au pays du libéralisme. Aux Etats-Unis, il n’existe actuellement aucun mécanisme fédéral pour instituer un quota de production fédéral ni d’interdiction de la fracturation hydraulique. Toute initiative de rationnement revient donc aux autorités locales.
Au niveau du Texas, il existe une Agence dirigée par trois membres élus et qui réglemente l’industrie pétrolière et gazière pour cet Etat : la Texas Railroad Commission ou TRRC (rien à voir avec les chemins de fer). Selon Sergio Chapa, journaliste au Houston Chronicle, cet organisme réfléchirait à imposer un rationnement proportionnel à tous les puits de pétrole au Texas. Le prorata limiterait la quantité que chaque puits de pétrole pourrait produire au cours d’une période donnée. Elle avait déjà imposé une telle mesure de prorata en 1972. Dans une consultation, le 21 avril, elle avait reçu les avis de 47 producteurs : 19 étaient en faveur du prorata, 20 y étaient opposés et 8 n’avaient pas exprimé de choix.
Mais en raison de la gravité de la crise, la TRCC proposerait le 5 mai prochain le vote d’une proposition visant à réduire la production de pétrole de 20 %, soit environ 1 million de barils par jour. Dans l’ordonnance de huit pages de la TRCC, il est prévu que seraient exemptées de cette réduction obligatoire les petites entreprises qui produisent moins de 1.000 barils de pétrole par jour. Mais rien n’est encore assuré. L’opposition des majors restent forte. Elles soulignent que la réduction est déjà en marche.
Selon l’analyse par Rystad Energy des premières publications financières des sociétés, six grands producteurs américains de schiste devraient réduire leur production d’environ 300.000 barils jours pour les mois de mai et juin. Et le mouvement s’étend. ConocoPhillips, l’une des plus grandes sociétés pétrolières américaines, va réduire sa production en Amérique du Nord de 225.000 barils par jour.
Mais l’entreprise a décidé également de couper dans ses dépenses de plus d’un quart, en les ramenant à 4,3 milliards de dollars. L’industrie va non seulement connaître une baisse de chiffre d’affaires mais, également, elle prend le risque d’hypothéquer l’avenir en réduisant ses investissements.
D’ores et déjà, l’on sait que les nouveaux puits de pétrole américains devraient diminuer de 87 % d’ici la fin de cette année. Et les sociétés cotées en bourse ont supprimé plus de 31 milliards de dollars des budgets de forage ! (Nous reviendrons sur cette baisse des investissements, car sans doute sont-ils prédictifs d’une autre crise pétrolière à venir, d’une ampleur encore plus forte, mais dans l’autre sens).
Malgré de premières initiatives, prises librement, l’idée d’une mesure obligatoire fait son chemin. Déjà le Dakota du Nord et l’Oklahoma se réuniront durant le mois de mai pour débattre de la même résolution. Car c’est une question de vitesse liée aux prévisions de saturation du stockage d’ici juin, dans le meilleur des cas. Les prix mondiaux du pétrole pourraient tomber à 10 dollars le baril !
Et la suite ? Pour bon nombre d’experts, les stocks sont si importants qu’il faudra des mois, voire un ou deux ans en fonction de la puissance de la reprise, pour les ramener au seuil normal d’un marché fluide.
Les dessous de la chasse au schiste
Nous l’avons vu : la guerre des prix lancée par l’Arabie saoudite a amplifié les conséquences de la crise épidémique, si bien que l’on peut dire, sans exagérer, que la situation est devenue catastrophique pour l’industrie pétrolière, en particulier aux Etats-Unis.
Bien sûr, l’on pourrait penser comme Trump au départ que cela servira finalement les intérêts du consommateur. Nous verrons que ce n’est pas le cas. Tout simplement parce que les budgets des Etats vont sortir exsangues de la récession et que le « moulin à fiscalité » va tourner à grande vitesse, à commencer par les taxes sur les carburants.
Donc, tout ça pour ça ? Comment en est-on arrivé là ? Hors des multiples « Davos » internationaux et de leurs clichés traditionnels, qui montrent des dirigeants mondiaux sympathiques, et souriants de toutes leurs dents blanchies chimiquement, la vie réelle est un peu différente. Finalement, le pétrole rend la dent dure. Et plus encore lorsque l’on mêle des intérêts économiques à des préoccupations politiques. Certains médias avaient relaté une vive altercation au téléphone entre François Hollande et le président russe, au sujet du petit producteur pétrolier qu’est la Syrie. On se rappelle aussi comment Nicolas Sarkozy était sorti en sueur d’un entretien tumultueux avec Poutine. Le vin n’explique pas tout. On s’interroge donc : comment ont tourné les relations entre le patron du Kremlin et le Prince héritier saoudien ? Cela nous donnera aussi l’occasion de déterminer quel est le gagnant de cette confrontation.

Dans le secret de MBS
Pour rechercher un peu de piquant, il faut donc aller vers des sources moins officielles. Pour ce qui concerne le pétrole et le Moyen Orient, il y a deux sites, à manier néanmoins avec des pincettes. Le premier est MIDDLE EST EYE, le second est ARAB NEWS. Ils reflètent la lutte d’influence entre le Qatar et l’Arabie Saoudite. MEE est un média en ligne à Londres et qui a été créé en 2014 avec des anciens d’Al Jazeera. Son rédacteur en chef est David Hearst, ancien patron de la rubrique « étranger » du Guardian. Les contributeurs de MEE sont souvent des personnalités de premier plan, soit britanniques, soit du Moyen-Orient ou de la Turquie. Mais cela n’empêche pas certaines critiques sur l’intégrité des informations fournies : en particulier, celles d’être un instrument du Qatar, d’avoir une certaine proximité avec les Frères Musulmans et de publier souvent des Fake News. Ces mises en cause viennent de concurrents, notamment d’ARAB NEWS : un média également sur site, publié en Arabie saoudite. Son siège est basé à Djeddah. Les informations sur le pétrole un peu confidentielles proviennent de ces deux sources.
Le 21 avril sous la plume de David Hearst, MME publie un article intitulé : « Exclusive : Saudis launched oil price war after ‘MBS shouting match with Putin’ ». On apprend ainsi (avec la réserve qui s’impose) que juste avant la réunion du 6 mars, les deux dirigeants avaient échangé au téléphone. Le Prince héritier saoudien a la réputation d’avoir un caractère impulsif. Et, semble-t-il, il ne fait pas dans le détail si l’on en juge le meurtre du journaliste dissident Jamal Khashoggi, dont il a fini par reconnaître la responsabilité.
Bref, devant la position réservée de Poutine, MBS finit par se montrer agressif et il menaça le patron du Kremlin avec un ultimatum : faute d’accord, les Saoudiens lanceraient une guerre des prix ! Comme le souligne un témoin anonyme de la scène, cette conversation fut « très personnelle ». On devine les noms d’oiseaux échangés. Bref, les deux dirigeants se raccrochèrent au nez, prenant le risque de ruiner des mois de détentes.
Il faut rappeler que la Russie et l’Arabie saoudite avaient passé d’importants accords d’armement au nez et à la barbe des américains à la suite de l’attaque de septembre 2019. Le journaliste nous apprend également qu’en octobre, l’Arabie saoudite avait investi 2,5 milliards de dollars sur une promesse de 10 milliards dans l’énergie, les infrastructures et la technologie russes. En fait, c’est depuis 2015, donc bien avant la désignation de MBS comme Prince héritier en juin 2017, que les relations entre les deux pays se sont développées. Mais c’est MBS qui leurs a données un coup d’accélérateur.
Ce qui est intéressant de noter (toujours avec les réserves d’usage), c’est qu’avant cet échange téléphonique, selon le journaliste de MEE, le Prince héritier avait pris la peine de discuter avec Jared Kushner, gendre et principal conseiller de Trump. MEE par sa source anonyme révèle que « l’appel passé à Poutine avait reçu la bénédiction de Trump via Kushner. Kushner n’a pas demandé à MBS de le faire, mais il était au courant et n’y a pas mis de veto. Ben Salmane a tiré ses propres conclusions ». Cela éclaire les tweets de satisfecit du Président américain et sa grave erreur d’analyse. Son Administration avait donc connaissance des projets de réduction de la production de l’OPEP+.
Sur le même site, l’on prend connaissance de l’explication de la position russe par Pavel Sorokine, vice-ministre russe de l’Énergie. Comme nous l’avons indiqué plus haut, Moscou ne souhaitait pas se retirer totalement de l’accord de l’OPEP+ mais voulait une quotité moindre en jouant la prudence : « Nous ne pouvons pas combattre une demande en baisse lorsqu’on ne sait pas jusqu’où va descendre la demande. On peut aisément se faire happer dans un cercle vicieux ». Remarque prémonitoire.
L’information de l’altercation entre MBS et Poutine est reprise le 23 avril par l’édition russe de Sputnik, sous la plume de Peter Akopov. L’analyse est différente et tend à relativiser l’ambiance conflictuelle des échanges. Les deux dirigeants exprimaient simplement des désaccords. Peter Akopov va plus loin. Il soupçonne que la publication par MEE vise en fait à déstabiliser les relations entre la Russie et l’Arabie saoudite, et en particulier les contrats d’armement conclus après le bombardement des raffineries en septembre dernier. « L’un des éléments les plus importants de la guerre de l’information est l’introduction de la confusion dans les rangs de l’ennemi, et la Russie, qui a défié l’élite atlantique, est l’une des principales cibles des attaques ». Le journaliste russe émet d’ailleurs l’hypothèse que la manipulation viendrait des services spéciaux anglo-saxons. Plus globalement, cette tentative illustrerait les manœuvres engagées depuis longtemps pour compliquer les relations internationales de la Russie avec les grands dirigeants mondiaux, et les efforts de Poutine pour faire émerger un nouvel ordre mondial.
On est à moitié convaincu. D’abord parce que, comme tous les producteurs, l’Arabie saoudite avait analysé les statistiques de production faisant suite à l’accord de l’OPEP+ de décembre 2016. Or, il s’avérait que la Russie n’avait pas réellement respecté ses engagements ! Cela pourrait s’expliquer par un manque de flexibilité de l’outil de production russe, notamment liée au climat, puisqu’une partie du pétrole est située en Sibérie. Le pays ne dispose pas d’autant de capacités que l’Arabie saoudite pour accroître sa production pétrolière. Si elle peut augmenter assez rapidement la production de 200.000 à 300.000 barils jour, cela lui prendrait six mois de plus pour atteindre 500 000 barils jour.
Le second point important, nous semble-t-il, c’est la pression politique interne très forte qui s’exerçait à l’époque sur le Prince héritier, notamment par son proche entourage. Il faut rappeler que devant les menaces de l’Iran et le conflit au Yemen, MBS avait engagé un rapprochement avec Israel, dans la continuité des actions engagées sur la question palestinienne par le Royaume depuis 2015. L’évolution de la Palestine est devenue de moins en moins une source de désaccords internationaux.
Le site d’information d’Areion Group, spécialisé dans les relations internationales, rappelle qu’il y a bien longtemps que “ les responsables saoudiens reconnaissent implicitement l’existence d’Israël et expriment leur volonté de régler un conflit qu’ils considèrent comme menaçant pour la stabilité et la sécurité de la région”, donc du pétrole. “ Le plan Fahd de 1981, soutenu par Yasser Arafat, avançait déjà l’idée d’un règlement dans le cadre d’une paix régionale. En 2002, ce projet était relancé avec l’Initiative de paix arabe présentée par le Prince héritier saoudien de l’époque, Abdallah (v. 1921-2015)”.
Le rapprochement entre les deux états s’est fait à pas lents, mais sûrement. D’ailleurs, le 26 janvier dernier, le journal israélien Haaretz annonçait que « désormais Israël autorise officiellement les voyages en Arabie Saoudite ». C’est un geste en faveur des arabes israéliens qui veulent faire un pèlerinage à la Mecque et aussi un message politique : car il n’y a pas de relations diplomatiques officielles entre les deux Etats. Le quotidien libanais L’Orient-Le-Jour rebondit pour indiquer que d’autres rapprochements avaient été engagés avec des pays du Golfe (Émirats arabes et Bahreïn, deux alliés des Saoudiens).
Le célèbre romancier Turki Al-Hamad, figure de la mouvance libérale saoudienne et fervent partisan de MBS, avait mis les choses au point bien avant : en décembre 2017. « La Palestine n’est plus la cause numéro un des Arabes depuis que les propriétaires de cette cause l’ont vendue ». Lorsque le Hamas (le mouvement islamiste palestinien) avait refusé de considérer le mouvement libanais pro-iranien Hezbollah comme une « organisation terroriste », les dés avaient été jetés. Les Hezbollah sont très, trop proches des Iraniens. Il y avait donc un front commun tacite, entre Israël et les Pays du Golfe, pour normaliser, d’une certaine façon, la situation sur le dos des palestiniens.
La question palestinienne était d’ailleurs l’un des objectifs de Trump lors de sa campagne électorale. Il en avait engagé les préparatifs depuis trois ans, si bien que le 28 janvier 2020, le « Deal du siècle » était présenté par le Président des Etats Unis à la Maison Blanche, en présence de Netanyahou. Derrière l’élaboration de ce plan, on retrouvait le fameux Jared Kushner (dont les relations très proches avec MBS ont déjà été évoquées dans notre article). Trump et Netanyahou reconnaissaient que le plan n’était pas parfait, mais il leur semblait réaliste et correspondant aux attentes des deux entités. Cela règlerait le problème de la sécurité d’Israël et satisferait l’aspiration de la Palestine à devenir un Etat.
Trois ambassadeurs arabes étaient présents à la Maison Blanche lors de l’annonce du « Deal du siècle»: les représentants des Emirats arabes unis, de Bahreïn et d’Oman. Trois diplomates que Netanyahou, durant la réunion, remercia pour leur soutien. Inutile de préciser que ces trois pays, très proches de Washington, accueillirent avec enthousiasme la proposition de Trump. Pour l’Arabie saoudite, la prudence fut de mise, sur la forme du moins : gardienne des lieux saints musulmans sunnites, Ryad ne pouvait pas applaudir la fin des revendications arabes sur Jérusalem, ville sainte en islam. D’où une simple déclaration du Royaume saoudite « saluant les efforts » de Washington. Sur le fond, le Prince héritier saoudien était d’accord.
Or, cette perspective de normalisation déplut à certains membres de la famille royale ainsi qu’à des officiers supérieurs au sein de l’armée saoudienne. Ceux-ci fomentèrent carrément un coup d’Etat. Mais MBS en avait eu connaissance et le 7 mars, le lendemain de la réunion de l’OPEP+, il fit procéder à des arrestations au sein de l’armée, de l’appareil de sécurité et de la garde nationale. Plus des membres de la famille qui avaient versé dans le complot. Le quotidien extrarégional Al-Quds Al-Arabi indiqua à l’époque que l’oncle Ahmed ben Abdelaziz fut emprisonné pour « tentative de coup d’Etat ». Le journal The New York Times parla carrément de membres de la famille qui constituaient une menace pour le gouvernement du Prince héritier saoudien.
On comprend donc que durant la période de négociation avec Poutine, le Prince héritier avait quelques contrariétés. On peut penser qu’il avait une image d’autorité à défendre. D’où des échanges musclés avec le président russe. Mais ce dernier n’a pas l’habitude de se laisser impressionner ; et certains commentateurs estiment même qu’il est très dangereux de le pousser dans les cordes.
Cela nous amène à la question suivante : MBS et l’Arabie saoudite sortent-ils vainqueurs de la guerre des prix ?
Pour la diplomatie française, dans une note de l’ambassade de Riyad du 14 avril, c’est incontestablement oui : les gagnants sont l’Arabie Saoudite et son ministre de l’énergie. Car ce dernier aurait réussi à repositionner l’Arabie Saoudite et donc l’OPEP+ au centre du jeu, en imposant ses décisions.
« La guerre des prix conjuguée à la course à la hausse de la production de pétrole lancée par Riyad au lendemain de l’échec de la réunion OPEP+ du 6 mars, paraît avoir atteint l’objectif stratégique recherché : faire apparaître l’Arabie saoudite comme un acteur déterminant et incontournable de la stabilité des marchés de l’Energie, tout particulièrement dans cette période de crise économique la plus profonde de l’histoire récente. Cette stratégie, en accélérant, en l’espace d’un mois, la chute des prix du pétrole à leur niveau le plus bas depuis 2003, aura provoqué, sous la pression déterminante des Etats-Unis, le retour à la table des négociations des principaux acteurs de l’OPEP+. Le ministre saoudien l’Energie apparaît, dans ce contexte, comme le principal artisan du succès de la négociation. Riyad retrouve sa position d’acteur majeur du marché pétrolier prônant une discipline de contrôle de l’offre de brut pour favoriser une reprise l’économie mondiale post Covid-19 »
Cette analyse est pour le moins surprenante. Surtout la dernière phrase… On sait que depuis de nombreuses années, ou plutôt de décennies, la diplomatie française n’est plus ce qu’elle était. Plusieurs prises de position dans la presse ont fait état de cette carence dans la conduite de notre politique internationale. Il y a eu la tribune, dans le journal Le Monde en 2011, d’un collectif de diplomates français critiques, sous le nom du groupe « Marly » : « La voix de la France a disparu dans le monde ». Puis d’autres prises de position argumentée, comme sur le site lescrises.fr, avec l’article « Diplomatie française : de l’influence à l’effacement ». Ou encore la publication d’un excellent petit ouvrage de Roland Hureaux, membre du Comité scientifique de la Fondation Charles de Gaulle : « La France et l’Otan en Syrie ». Même le Président Macron s’y est mis dans son discours aux ambassadeurs, fin août 2019, lorsqu’il évoquait les réticences de l’« État profond » ! Ce qui ne manqua pas de saveur, venant de lui.
Donc, alors que notre pays a été totalement absent de cette bataille pétrolière, et encore plus l’Europe communautaire, cette note de notre ambassade à Ryad est, pour le moins, dans ses conclusions, une étonnante flagornerie.
Explication. D’abord, dire que le Royaume est un acteur majeur qui prône « une discipline de contrôle de l’offre de brut pour favoriser une reprise de l’économie mondiale » entraîne deux réactions différentes : soit on s’étouffe de rire, soit en s’étrangle de colère. Mais on ne sort pas indemne d’une telle assertion. Franchement, au niveau du prix actuel du baril, la discipline de contrôle est singulièrement absente… Heureusement que les américains de base ne lisent pas les notes de la diplomatie française.
Dans ce prolongement, qui peut nier que les relations diplomatiques entre l’Arabie saoudite et les Etats-Unis ne sortent pas fortement ébranlées de cet épisode ? Il suffit de rappeler les avertissements lancés au Prince héritier saoudien à plusieurs reprises par les parlementaires républicains. La menace de retirer leurs troupes et leurs équipements du sol saoudien n’étaient pas annoncées à la légère. Rappelons les propos du sénateur républicain de la Louisiane, Bill Cassidy, dépositaire d’un projet de loi le 9 avril : « Les États-Unis devraient retirer leurs forces d’Arabie saoudite dans les 30 jours qui suivent l’adoption de ce projet de loi ». Bill Cassidy, dont le nom rentre en consonance avec les grands westerns américains, estimait que l’augmentation de la production de pétrole par l’Arabie saoudite avait infligé de « lourdes pertes aux compagnies pétrolières américaines ». Une raison majeure pour sortir les colts. La décision de Trump d’interdire l’arrivée des pétroliers saoudiens s’inscrit dans le même état d’esprit. Finalement, l’Arabie saoudite prit très aux sérieux ces menaces et appela à une réunion d’urgence des pays de l’OPEP +, ce qui déboucha sur l’accord du 12 avril.
Le lendemain, le ministre saoudien de l’Energie, le prince Abdulaziz bin Salman, dans un entretien avec des journalistes, dont Amena Bakr d’Energy Intelligence, déclara, presque la queue entre les jambes que « L’Arabie saoudite n’avait pas eu l’intention de faire souffrir les producteurs de pétrole américains » ! Plus faux culs, tu meurs.
Comme la crise pétrolière aux Etats-Unis n’en finit pas de faire des dégâts, le contentieux avec l’Arabie saoudite ne peut que s’aggraver. L’on sait que Trump et les Républicains envisagent toutes les options qui s’offrent à eux pour faire payer aux Saoudiens la guerre des prix du pétrole. Rappelons au passage que lors des élections présidentielles de 2016, Hillary Clinton ne tarissait pas d’éloges sur le Royaume, qu’elle présentait comme une « force de paix et de stabilité », à l’opposé de l’opinion de Trump pour qui Riyad était « le plus gros bailleur de fonds mondial du terrorisme » ! Les relations changèrent en 2018 lorsque l’Administration Trump se retira unilatéralement de l’accord Iran-nucléaire, inaugurant un bras de fer qui se poursuit aujourd’hui. De ce jour, l’Arabie saoudite se rapprocha de Trump. Mais désormais, la lune de miel est terminée.
Sous les plumes de Keith Johnson et de Robbie Gramer le magazine Foreign Policy titrait le 23 avril dernier : “How the Bottom Fell Out of the U.S.-Saudi Alliance”. Les deux journalistes résumaient, en début d’une longue analyse, la situation de la façon suivante : « Ce printemps, comme au début des années 1970, les Saoudiens ont lâché leur arme à pétrole, causant des dommages à l’économie américaine en faisant délibérément chuter les prix du pétrole à un moment d’effondrement économique mondial au milieu de la pandémie de coronavirus. Les législateurs de Capitol Hill avaient déjà peu d’amour pour les Saoudiens, désillusionnés par les violations continues des droits de l’homme dans le royaume, une guerre brutale menée par les Saoudiens au Yémen et, peut-être le plus choquant, la boucherie ordonnée par l’État saoudien d’un chroniqueur du Washington Post. »
La rupture semble donc engagée et même Trump, qui avait défendu la relation jusqu’à récemment, a pris de la distance, comme nous l’avons vu. En fait, il y a un certain consensus sur le peu d’intérêt à poursuivre une relation aussi « décevante » : faut-il encore « protéger le pétrole saoudien ? La plus grande partie est désormais vendue à la Chine et à d’autres acheteurs asiatiques, plutôt qu’à l’Europe et aux États-Unis ». Quant à Joe Biden, le candidat des démocrates à la prochaine élection présidentielle, les choses sont relativement claires : l’ancien vice-président a qualifié l’Arabie saoudite de « paria » et il a déclaré qu’il couperait les ventes de matériels militaires. Avec l’assassinat de Khashoggi, MBS a perdu beaucoup de soutiens aux Etats-Unis et dans de nombreux pays.
Le seul évènement qui pourrait changer un peu la donne, c’est une confrontation militaire entre les Etats-Unis et l’Iran : la haine ancienne pour ce pays semble plus forte que celle récente envers l’Arabie saoudite. Mais n’oublions pas que l’opinion américaine est restée très remontée contre les saoudiens, complices, selon eux, des attentats du 11 septembre. La crise actuelle ravive cette blessure. Du coup, plusieurs chroniqueurs estiment que les forces américaines pourraient sans difficulté se repositionner au Qatar, jugé plus fiable, malgré ses liens avec l’Iran. Les américains y sont déjà implantés avec la base aérienne d’Al-Udeid, la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient et le quartier général avancé du United States Central Command. La chaine de télévision Qatarienne Aljazeera enfonçait le clou le 30 avril : “Could the oil price crisis radically redefine US-Saudi relations? ”
Les relations avec les autres membres de l’OPEP ne sont pas meilleures. Elles ont également été sérieusement écornées si l’on en juge certains articles de presse. Lorsque « Le Matin d’Algérie », journal en ligne, titre le 10 mars, après le lancement de la guerre des prix, « Arabie Saoudite : 3ème coup de poignard dans le dos de l’Algérie », on ne peut qu’être surpris ! Car c’est l’Algérie qui assurait à l’époque la présidence de la conférence de l’OPEP. En fait, « Le Matin d’Algérie » est un journal d’opposition aux gouvernements antérieurs et actuel. Mais, toujours en faisant preuve de recul, il est intéressant de prendre connaissance des arguments développés et, ensuite, de les recouper avec les autres prises de position.
Comme d’autres pays dont la production est moins importante que celle des saoudiens, les algériens reprocheraient à l’Arabie saoudite d’avoir engagé une guerre des prix suicidaire. Couplée avec l’épidémie, la baisse des prix du barils va mettre à mal leur économie en générant des déficits, donc en réduisant leurs réserves de change et en les entraînant très probablement à recourir à un endettement externe. Ce scénario de déstabilisation s’appliquerait aussi aux petits producteurs : Venezuela, Libye, Nigéria, Sultanat d’Oman … Mais Oman, Bahreïn, l’Irak et l’Angola seraient dans une situation dramatique sur le plan financier. Certains pays pourraient même voir une explosion sociale.
Le Matin d’Algérie rappelle que ce n’est pas la première fois que l’attitude hégémonique du Royaume est contestable et contestée. « Durant l’été 1985, l’Arabie saoudite avait mis en œuvre un artifice de vente appelé « netback deal ». Il consistait à fixer le prix du baril en fonction de la valeur de vente du cocktail de produits finis qu’on peut obtenir sur le marché du raffinage. Ce qui voulait dire que sur un marché connaissant des fortes fluctuations des prix, le plus gros risque se trouve assumé par le vendeur du pétrole brut qui assurait d’une manière détournée la marge du raffineur. Abandonnant ainsi, sa stratégie de défense des cours du baril, ce nouveau deal s’est avéré contre-productif et a mené tout droit vers un « contre choc pétrolier » au détriment bien entendu des producteurs ». Cette politique a mis l’Algérie à genoux à telle point que le premier ministre de l’époque, décédé depuis, Kasdi Mesbah, convoqua l’ambassadeur du Royaume pour lui demander de passer un message au roi : « On nous a enlevé le pain de la bouche » !
Toujours dans cette année 1985 l’Arabie Saoudite avait entraîné les autres pays exportateurs à privilégier le volume au détriment du prix du baril, dans l’optique de gagner des parts de marché. Le résultat ne fut pas bénéfique pour les mono-exportateurs. En 2014, sans concertation, le Royaume s’attaqua déjà aux producteurs de gaz de schiste américains afin de récupérer « ses parts du marché ». Comme en 2020, les prix chutèrent, et ce d’autant plus que l’économie mondiale était atone. Le journaliste Rabah Reghis précise : « Depuis, le budget algérien s’est mis à accumuler des déficits qui ont totalement épongé son Fond de Régulation des Recettes (FRR), puis ont obligé de recourir à la planche à billets, procédé non conventionnel, dévastateur d’une économie de rente » !
L’imprudence de s’engager dans un conflit à la fois contre les Etats-Unis et la Russie, sur toile de fond de la guerre au Yémen, ne lasse pas de surprendre les analystes. Pour citer Oscar Wilde, “Perdre une guerre peut être considéré comme un malheur, en perdre deux ressemble à de la négligence.”
Dawud Ansari, expert de la politique énergétique des pays du Moyen-Orient à l’Institut allemand pour la recherche économique de Berlin, apporte une explication : « Punir l’intégralité du marché est un comportement habituel de l’Arabie saoudite lorsqu’un autre pays producteur de pétrole se montre insubordonné ». Le Royaume « ouvre alors le robinet à pétrole pour inonder le marché de sa production à bas prix, ce qu’elle fait depuis près de quarante ans pour défendre ses parts de marché et faire plier ceux qui ne se rangent pas derrière elle ». Cette analyse rejoint celle du « Matin d’Algérie ».
La chaîne de télévision du Hezbollah chiite libanais, Al Manar, (interdite en France) est bien sûr très critique à l’encontre du Royaume saoudien. Elle fit une annonce le 5 avril dernier : « L’Arabie saoudite sera la plus grande victime de la guerre du pétrole » ! Et de développer son message qu’elle veut prémonitoire : « La guerre du pétrole que l’Arabie saoudite a déclenchée à un mauvais moment, entraînera non seulement la destruction de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), mais fera également de Riyad la plus grande victime de ce processus, car ce pays perdra d’abord son rôle de leadership, puis une grande partie de ses revenus pétroliers ».
Effectivement, il semble bien que le Royaume perde sur les deux tableaux : d’abord la rupture des relations internationales avec les Etats-Unis, et peut-être avec d’autres petits pays producteurs. Ensuite, les pertes financières. Car en plus de l’impact économique de la crise du Covid19, les conséquences vont se faire sentir sur le budget de l’Arabie saoudite.
Avec un pétrole à moins de 20 dollars le baril, sans possibilité d’augmenter le volume de ses ventes du fait de la récession mondiale, la baisse des recettes pétrolières (d’environ 70 %) pourrait doubler son déficit budgétaire, en le portant à 120 milliards de dollars ! Cette perte de revenus s’ajouterait à celles concernant l’annulation du voyage à la Mecque. Les pèlerinages du Hajj et de la Omra, qui accueillent près de 10 millions de pèlerins par an, génèrent plus de 8 milliards de dollars de revenus !
Une telle mauvaise situation financière est de nature à retarder la mise en œuvre de « Vision Arabe saoudite 2030 », le plan de diversification économique du Royaume lancé en 2016. NEOM, la zone de développement économique sur les rives de la Mer rouge, dont le budget est estimé à plus de 500 milliards de dollars, est à l’arrêt, faute de cash. Autre mauvais signal : les retards de paiements sont de plus en plus fréquents.
Le magazine Challenge résume ainsi la situation : « L’Arabie saoudite n’a plus les moyens de ses ambitions ». Début 2015, les réserves de change s’élevaient à 732 milliards de dollars. En décembre 2019, elles étaient de 499 milliards de dollars, soit une perte de 233 milliards de dollars en 4 ans.
Reste à voir comment évoluera l’attitude de la Chine, un client important du pétrole saoudien. Chacun sait qu’elle a des visées sur le Moyen-Orient. Profitant de la relance de sa reprise économique, la Chine pourrait profiter de cette situation pour renforcer son influence géopolitique dans la région, et ce d’autant plus vite si les Etats-Unis se désengagent de ses liens privilégiés avec le Royaume. La nature a horreur du vide … Toutefois, comme nous le verrons, les ponts ne sont pas totalement coupés avec la Russie. L’ambition de Poutine sur le Moyen-Orient est ancienne. Elle a pris appui depuis l’URSS sur l’Algérie, la Syrie, la Lybie, et le Kremlin cherche d’autres soutiens. L’Arabie saoudite en était un très important.
Lorsque l’on met bout à bout toutes ces conséquences, l’avenir de Mohammed ben Salman semble fortement compromis. Car l’Arabie saoudite sort, économiquement et politiquement, très affaiblie d’une guerre des prix qu’elle a lancée de façon inconsidérée : « Une réaction stupide et violente » comme l’écrivait, en deux adjectifs saignants, le journaliste Sébastien Grob. Cela pourrait conduire à de nouveaux troubles au sein du Royaume et peut-être mettre un terme à la fonction du Prince héritier et donc son accession au trône. Toutefois, depuis sa désignation, le Prince héritier tient serrées les cordes du pouvoir.
En résumé, MBS ne sort pas gagnant de cette histoire ; ou alors, c’est une victoire à la Pyrrhus. En tout état de cause, c’est une donnée importante à prendre en considération pour la suite de la crise actuelle, mais aussi dans la perspective d’un second collapse pétrolier à venir, peut-être plus grave encore pour l’économie mondiale. Une hypothèse que nous examinerons.
Dans le secret de Trump
Nous avons suffisamment examiné l’évolution de la situation américaine pour en tirer déjà une première conclusion : l’industrie pétrolière des Etats-Unis va sortir très affaiblie de cette crise. Elle va survivre, certes, sans doute se restructurer, c’est-à-dire se concentrer : les majors font faire leur marché, en profitant à bon compte de la faiblesse ou des faillites des petits producteurs. Il en a toujours été ainsi. Mais elle devra se repositionner et tirer les leçons de son manque d’anticipation et de la faible flexibilité de son appareil de raffinage. Parfois, l’euphorie du marché et le succès facile, pour ne pas dire la rente financière, rendent aveugles. Attendons un peu de voir, car ce secteur subit encore de plein fouet la chute du prix du baril.
La crise a également renforcé la mobilisation des écologistes et leur confrontation avec les pétroliers. Il existe aux Etats-Unis une agence pour la protection de l’environnement : l’EPA. Seul le président américain peut nommer et licencier le patron de l’EPA. L’Administration Trump avait désigné à sa tête Andrew Wheller, ce qui avait déclenché l’ire des écolos, car c’est un ancien lobbyiste du charbon. Il avait travaillé notamment pour Murray Energy, le plus gros producteur de houille dans le pays. Comme le relate Les Echos, l’ONG Sierra Club avait déclaré à l’époque que la nomination d’Andrew Wheeler revenait à « donner les clés du coffre à un voleur ». En fait, cette nomination était perçue comme la mission, confiée par Trump, de détruire l’héritage de la politique climatique d’Obama.
Il s’avère qu’au mois de mars de cette année, en pleine crise pétrolière et sanitaire, l’EPA a assoupli un certain nombre de contraintes, en particulier à la demande de l’API, l’American Petroleum Institute. En faisant court, donner la possibilité aux entreprises « polluantes » de se réguler eux-mêmes par rapport à l’application des normes fixées par l’EPA (à l’exception d’infractions définies comme « criminelles » par les textes). L’argument du lobby pétrolier a pris appui sur un manque d’effectifs du fait de la crise sanitaire (confinement) et sur l’engagement que cette mesure ne serait que temporaire. Wheeler étant un excellent juriste, on comprend que cette démarche ait suscité l’inquiétude des écologistes, et ce d’autant plus que depuis sa nomination, il avait déjà mis en œuvre plusieurs réformes réglementaires à la demande de l’API. Alors du temporaire au définitif, il n’y a qu’une virgule…
L’ancienne directrice de l’EPA sous Obama, Gina McCarthy, devenue directrice du Natural Resources Defense, ne s’est pas privée de critiquer la mesure : « Il s’agit d’une licence ouverte pour polluer » a-t-elle déclaré. Le message que les défenseurs de l’environnement veulent passer en communiquant ainsi, c’est que le retard pris par les Etats-Unis pour entrer pleinement dans « l’économie verte de demain » conduira à dissuader un certain nombre de fonds à investir aux Etats-Unis. Cette considération « financière » fait un peu sourire. Car la mouvance gauchiste aux Etats-Unis, qui porte le mouvement écologiste, prend généralement appui sur l’exploitation de la pandémie en relation avec l’agro-industrie « capitaliste », la perte généralisée de la biodiversité et la destruction des écosystèmes naturels. « Covid19 et Pollution », même combat. On a déjà entendu ce refrain en Europe, notamment en France.
Malgré tout, la question environnementale est et sera un autre défi à relever pour l’industrie pétrolière, surtout si le prochain président est démocrate, car les partisans de Bernie Sanders ralliés à Joe Barden créeront une forte pression sur ce dernier pour renforcer les réglementations de protection de l’environnement. Elle sera d’autant plus forte que les écologistes craignent que la reprise, avec des prix du pétrole certainement encore faibles, ouvrent les vannes de la consommation d’essence. Un effet de balancier anticipé par beaucoup de professionnels d’ailleurs.
Venant en maintenant à la situation de Trump. Il apparaît politiquement comme le véritable perdant de la confrontation entre Poutine et MBS. D’abord, il a très mal évalué la situation et ses conséquences. C’est d’autant plus curieux que les Etats-Unis ne manquent pas de services secrets : la « communauté du renseignement » du pays (ou United States Intelligence Community) en regroupe pas moins de 17, appartenant à plusieurs ministères. On se doute qu’un cortège d’analyses, CIA en tête, scrute l’Arabie saoudite ainsi que les faits et gestes du Prince héritier. Comme nous l’avons indiqué, le gendre de Trump, Jared Kushner, a lui-même établi des relations privilégiées avec MBS. Et si l’on en croit les médias arabes, Kushner avait été directement informé par le Prince héritier saoudien des décisions qu’il comptait prendre, notamment à l’égard de la Russie. On est donc forcément perplexe.
Trump ne vit-il que dans l’instant présent ? A-t-il réellement une vision stratégique ? En tout cas, il semble toujours avoir un train de retard, comme semble le démontrer la prise en compte de l’épidémie du Covid19. En outre, ses diagnostics sont souvent justes, mais ses décisions, erronées…
Compte tenu des conséquences sociales que la double crise entraîne, le coût électoral pourrait lui être fatal en novembre prochain. Mais il est trop tôt pour faire des projections. Surtout du côté des grands électeurs. Nous savons que les Etats-Unis ont une culture de résilience étonnante. Du moins l’ont-ils démontré par le passé. Ce ressort pourra-t-il jouer dans les mois qui viennent ? Pour cela, il faudrait que le pays avec ses 50 Etats montre une unité sans faille. Or la crise actuelle semble amplifier la polarisation de la société américaine.
L’Amérique change, pas forcément en bien si l’on se réfère aux faits, et aux études sociologiques ainsi qu’aux témoignages d’observateurs du quotidien. Celui de la journaliste Géraldine Smith dans son livre paru en 2018 est particulièrement édifiant : « Vu aux Etats-Unis, bientôt en France ». Elle brosse le portrait d’une société américaine vivant au rythme des procès d’intention, des mises en accusation et des clivages attisés par les minorités.
Ces symptômes minent toutes les strates de l’Amérique profonde, y compris l’armée. Hormis la question des toilettes pour les « transgenres », celle-ci doit faire face à un grave problème d’obésité qui s’ajoute à celui de la drogue. En 2018, le général à la retraite Samuel Ebbesen indiquait dans un rapport que près d’un tiers des jeunes Américains étaient trop gros pour servir dans les forces armées. Si les Etats-Unis se sont dotés d’une armée professionnelle, pour autant, la conscription est nécessaire en cas de conflits sérieux (« Boots on the ground »). Et là, les chiffres parlent d’eux-mêmes : selon des chiffres du Pentagone datant de 2015, 71% des Américains âgés de 17 à 24 ans ne sont pas qualifiés pour servir dans les forces armées pour des raisons de surpoids, de niveau d’éducation insuffisant, de passé criminel ou d’usage de stupéfiants. Sur les jeunes désireux de s’enrôler, l’obésité en disqualifie près d’un tiers (31%). En d’autres termes, l’Amérique porte en elle des germes de déclin et elle n’a (n’aurait ?) plus les moyens militaires de son impérialisme des années 80.
Ce que la crise pétrolière nous enseigne, c’est que la maîtrise des circuits de décision politique devient un élément crucial. En stratégie d’entreprise, la vitesse est depuis longtemps un vecteur de réussite. En politique, on pouvait penser qu’il fallait un peu de temps long pour laisser se décanter les problèmes, notamment les nombreuses contradictions que porte la mondialisation.
L’antagonisme entre la Russie et l’Arabie saoudite a apporté un autre éclairage, lequel devrait susciter une profonde réflexion chez les dirigeants politiques. Mis à part pour l’Europe communautaire, qui est comme une sphère gazeuse dans les alizés. La diplomatie de la Commission européenne est une sorte de mélange de tubes anciens entre « 99 Luftballons », de la chanteuse allemande Nena, et du « ça plane pour moi » du français Plastic Bertrand. C’est l’Europe absente, évanescente même. Passons…
Plus sérieusement, nous avons vu concrètement dans cette guerre des prix la traduction de trois systèmes de décision, avec un élément complémentaire : la tutelle ou pas d’une industrie au service d’objectifs géopolitiques.
Il y a le système monarchique qui règne sur l’Arabie saoudite et la société Aramco : c’est le fait du Prince. Celui-ci a transformé un système collégial en concentrant tous les pouvoirs. Le circuit de décision est sans contre-pouvoir réel, du moins en l’état du système politique de la Monarchie saoudienne. Et lorsqu’il y a des opposants, nous avons vu que, depuis sa prise de fonction, MBS faisait régulièrement le ménage. Avec une vision à long terme et un dirigeant ayant un esprit calculateur mais absent de toute impétuosité, l’Arabie saoudite pourrait délivrer une stratégie très efficace. Ce n’est pas le cas.
Nous verrons plus loin comment a fonctionné le système dirigiste russe, autour d’un homme puissant : le président de la Fédération. Ce que l’expérience montre, c’est que la prise de décision est partagée avec une petite élite du complexe militaro-industriel, parce qu’elle suit une finalité géopolitique et économique. La prise de décision s’appuie sur le levier que constitue une industrie d’hydrocarbures dont la propriété a été intelligemment conçue comme une détention mixte (public privé) : la défense de la souveraineté du pays, et un peu d’argent au passage. La vision est très longue ; et elle est ancrée dans l’apprentissage de l’histoire et de la géographie. Comme le rappelait en 1976 Yves Lacoste, géographe et géo-politologue, : « La géographie sert d’abord à faire la guerre ». Et les élites russes, en particulier Poutine, l’ont bien compris.
Dans ces deux systèmes, Le Royaume et la Fédération, les circuits de décisions sont relativement courts et rapides. Mais l’un s’est montré impulsif, c’est d’ailleurs son surnom ; l’autre, plus réfléchi.
Et puis il y a le système démocratique américain, où le Président, nous l’avons vu, n’a aucun pouvoir sur le secteur privé, mais dont les relations avec lui sont équivoques : parce que les décisions sont d’abord prises en fonction d’intérêts économiques qui aboutissent ensuite à des orientations géopolitiques. L’invasion de l’Irak en a été la caricature. Les entreprises américaines représentées par la Chambre de commerce des États-Unis, n’hésitent pas à faire prévaloir leurs intérêts commerciaux auprès de l’Administration, du Congrès ou du Sénat, y compris dans des pays considérés comme hostiles aux États-Unis (Iran, Venezuela ou Cuba).
Chacun à leur manière, le néolibéralisme et le néo-conservatisme (les néocons) sont devenus le vecteur de l’impérialisme américain dans le monde. Ils transcendent d’ailleurs les partis : plutôt investis au sein du Parti Républicain à l’origine, on trouve des « néocons » aussi chez les Démocrates.
Mais leur influence semble se réduire, sauf dans les structures de l’Otan, de la NED (National Endowment for Democracy) et de l’USIP (United States Intitute of Peace). Du moins, le « populisme » recentré sur l’Amérique de Trump, a contrarié leur emprise sur les circuits de décision des institutions américaines. Le slogan « America first » a coupé court aux diverses formes de multilatéralisme. Il faudrait prendre le temps d’étudier plus profondément la politique internationale des Etats-Unis au filtre de ses élites et du respect des principes de la démocratie. Car ce n’est pas toujours clair. Ce n’est pas l’objet de cet article, mais ouvrons une rapide et petite fenêtre.
Wendy Brown, professeur de sciences politiques de l’université de Californie à Berkeley, expliquait que « le néo-conservatisme américain – rationalité morale et économique féroce – et le néolibéralisme américain – rationalité politique de marché – convergent sans le vouloir à des moments cruciaux pour continuer un processus de phagocytation de la démocratie ».
Concernant la dernière élection présidentielle américain, on peut considérer que Hillary Clinton représentait une présidence « néoconservatrice/néolibérale », ce qui pour certains politologues portaient de nombreux risques, notamment une guerre possible avec la Russie.
Wendy Brown conclut ainsi : « Après tout, l’establishment de Washington reste ravi des deux néos, favorisant l’interventionnisme type changement de régime du néo-conservatisme, et le mondialisme libre-échangiste du néo-libéralisme. En somme, Clinton s’est avérée être la candidate clairement favorite des élites, du moins depuis que les alternatives se sont limitées au populiste milliardaire Donald Trump et au socialiste démocrate Bernie Sanders. »
Trump a apporté une rupture à cette conjugaison circonstancielle des deux « néons », en ramenant la problématique politique au marché intérieur américain. Une partie de l’opinion, lassée des guerres sans fin, l’a élu pour ça. Il serait donc judicieux de s’interroger sur le système de pouvoir qui sera issu des prochaines élections américaines et quelles seront les forces de soutien du futur président face à l’éventualité d’une nouvelle crise.
On peut imaginer que l’attaque de l’Arabie saoudite et de la Russie contre le pétrole américain aurait suscité des réactions bien plus violentes de la part des démocrates « conservateurs » (le courant de pensée d’Hillary Clinton) s’ils avaient été au pouvoir, sans parler de l’Etat major américain toujours prêt à dégainer. La dernière interview de Joe Biden dans le magazine Foreign Affairs – « Why America Must Lead Again » – et plus encore son article en Janvier 2018 – « How to stand up to the Kremlin. Defending democracy against its enemies » -, suscitent, à bien des égards, quelques inquiétudes.
Face à ce ton belliciste, une partie des jeunes, qui ont soutenu Bernie Sanders, trainent les pieds actuellement. Sur le site WSWS (World Socialiste Web Site), l’on apprend ainsi que l’ancien candidat s’efforce d’exhorter ces jeunes à se mobiliser pour la campagne de Joe Biden. La réponse de Joseph Kishore – candidat à la présidence des États-Unis et Secrétaire national du SEP (Parti de l’égalité socialiste) joue à fond la carte du pacifisme en rappelant le « track-record militariste » de Biden :
En tant que membre puis président de la commission sénatoriale sur les affaires étrangères, Biden a été l’un des principaux promoteurs du bombardement américain de la Yougoslavie (1999) sous Clinton, et des invasions américaines de l’Afghanistan (2001) et de l’Irak (2003) sous Bush. Il a voté pour le Patriot Act et l’expansion de l’espionnage intérieur illégal après les attaques terroristes du 11 septembre 2001, se vantant que la loi s’inspirait d’un projet de loi qu’il avait rédigé en 1995.
Biden a également voté pour l’abrogation de la loi Glass-Steagall en 1999, une étape importante dans la déréglementation des banques, augmentant considérablement la capacité des institutions financières géantes à se livrer à la spéculation et au pillage. En 2005, Biden a mené une campagne agressive pour la révision des lois sur la faillite des consommateurs, rendant beaucoup plus difficile pour les familles de la classe ouvrière d’échapper au fardeau de la dette.
En tant que vice-président sous Obama, Biden a supervisé le sauvetage des banques en 2008-2009 ainsi que les guerres en Libye, en Syrie et au Yémen. Cela s’est ajouté à l’occupation continue de l’Irak et de l’Afghanistan et à la vaste expansion des assassinats de drones comme instrument de la politique étrangère américaine.
Ce type de commentaires, plus la question des plaintes contre harcèlement sexuel, vont représenter pour le candidat démocrate une vraie course de Steeple-Chase, alors qu’il a du mal à nouer des contacts avec ses électeurs.
Trump, s’il est réélu, tirera-t-il les leçons du conflit pétrolier ? Joe Biden, s’il est élu, poursuivra-t-il la politique internationale d’Obama, en s’appuyant de nouveau sur certaines élites au cœur du gouvernement profond ?
la lecture de la crise pétrolière actuelle ne doit pas se limiter à de strictes considérations de marché. Certes, le contexte de récession mondiale, liée au confinement sanitaire, avec un déséquilibre important entre une offre pléthorique et une demande atone constitue la cause centrale de la chute des prix. Mais les processus de décision derrière cette situation sont bien plus complexes qu’on ne peut le penser.
Lionel Tourtier Tweet
Dans le secret de Poutine
Poutine, lui aussi, évolue dans un contexte interne au Kremlin qui n’a rien de l’ambiance d’un jardin d’enfants.
Hormis le Président du Kremlin, deux autres personnalités ont été et restent au cœur de la crise pétrolière : Dmitriev et Setchine dont nous avons déjà parlé à l’occasion du Venezuela. Les deux sont des proches de Poutine. L’un, Setchine, fait partie du groupe des « Siloviki ». L’autre fait partie du courant libéral. Barbara Vernon, dans un article publié en 2005, « Les élites en uniforme », explique l’origine et surtout la réalité politique que ce terme de « Siloviki » recouvre.
Lors de sa prise de pouvoir, Poutine était entouré par un cercle assez restreint. Mais en tant qu’ancien membre du KGB, il faisait partie de ce que l’on nomme les « structures de force » (silovye strouktoury) : « Cela désigne les membres fort nombreux – environ 2,5 millions d’hommes, selon les estimations – des ministères, agences et services (soit environ une vingtaine), dont les fonctions concernent les activités de défense, sécurité, police, renseignement, contrôle, douane, fisc, justice. » L’existence des Siloviki est connue, et fait l’objet d’articles de presse, tout comme d’ailleurs le complexe militaro-industriel (CMI). Les « structures de force » forment d’une certaine manière la colonne vertébrale de la Fédération.
Les chroniqueurs occidentaux, bercés par un idéal démocratique pure et dur, ont bien du mal à comprendre pourquoi la Russie a toujours été dirigée par un pouvoir fort. Les « bobos » adorent visiter Saint-Pétersbourg mais feignent d’ignorer la personnalité de Pierre le Grand : un dictateur impitoyable qui ne ménageait ni le sang, ni la sueur de ses sujets, mais qui conduisit de façon volontariste l’européanisation du pays au début du XVIIIe siècle.
Poutine, natif de la même ville que Pierre, s’inscrit dans sa lignée. Il a également une ambition volontariste de modernisation, mais surtout de restitution de la souveraineté et de la puissance de la Russie sur l’échiquier international. C’est un premier fil directeur.
En Russie, le fonctionnement « démocratique » repose sur une forte autorité. Ce qui se traduit dans la presse occidentale, notamment mainstream, par le terme « démocrature » : un mot péjoratif dans la vision des choses des journalistes, chouchoutés par les attentions de l’Atlantic Council alors qu’ils ne sont pas toujours au fait des réalités et surtout de l’histoire.
Une grande majorité de russes réclament un pouvoir fort au sommet de l’Etat, gage de stabilité et d’ordre. Il faut en comprendre les raisons profondes.
La période Eltsine a été très mal vécue, parce qu’elle montrait un visage faible face à l’Occident, une influence étrangère sur plusieurs plans (y compris pour la 2ème élection d’Eltsine), notamment la politique internationale, et tout compte fait, un pouvoir vacillant, et pas forcément à cause d’un excès de vodka. Les plus experts se souviennent de la manœuvre de George Bush (père), ancien membre de la CIA faut-il le rappeler, qui avait incité à la baisse du prix du pétrole pour déstabiliser l’économie russe. C’est curieux comme l’histoire se répète. Il y a aussi dans la mémoire plus ou moins collective, les liaisons dangereuses de certains américains avec les oligarques, (on parle des Clinton mais rien n’est vraiment démontré), pour faire main basse sur des pans entiers industriels. Avec la complicité des banques occidentales, les sorties de capitaux ont été considérables dans les années 90 : 120 milliards de dollars par an quittaient le pays chaque année dans un contexte où 50 % de la population frôlait le seuil de pauvreté !
C’est pourquoi, par exemple, la personnalité de Staline n’est pas autant critiquée qu’on pourrait le penser, du moins dans sa fonction de chef militaire durant la « grande guerre patriotique ». Pour le reste, les familles russes savent pertinent à quelles atrocités Staline s’est donné.
Beaucoup de commentateurs anglo-saxons et européens appliquent une grille d’analyse de la Russie reposant sur leur propre système de valeurs, revendiquant la défense des droits de l’homme, la liberté, la théorie des genres, etc. Or, comme le soulignait Hélène Carrère d’Encausse dans une interview au Figaro : « Il ne faut pas juger le pouvoir autoritaire de Poutine à l’aune de nos seuls critères ».
Le système de valeur russe met davantage en avant la famille et la patrie, et de plus en plus la religion orthodoxe comme un marqueur de l’identité russe. Pour autant, la modernisation des institutions après la chute de l’URSS a beaucoup emprunté aux exemples étrangers en matière de droit constitutionnel. Par exemple, la rédaction de la constitution russe a fait l’objet d’une assistance de juristes français en 1993. D’ailleurs, le préambule de la Constitution russe n’a pas à rougir par rapport au texte français : on y parle libertés et droits de l’hommes, autodétermination, souveraineté, etc.
« Nous, peuple multinational de la fédération de Russie, uni par un destin commun sur notre terre, affirmant les droits et libertés de l’homme, la paix civile et la concorde, conservant l’unité de l’État historiquement constituée, nous fondant sur les principes universellement reconnus d’égalité en droit et d’autodétermination des peuples, vénérant la mémoire des ancêtres qui nous ont transmis l’amour et le respect de la Patrie, la foi dans le bien et la justice, faisant renaître l’État souverain de la Russie et rendant intangible son fondement démocratique, visant à assurer le bien-être et la prospérité de la Russie, mus par la responsabilité pour notre Patrie devant les générations présentes et futures, nous reconnaissant comme une part de la communauté mondiale, adoptons la Constitution de la Fédération de Russie. »
« Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004. En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’outre-mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique. »
Mais ce n’est pas tant le texte des institutions, ni le rôle de la Cour constitutionnel qui priment : c’est l’utilisation effective des institutions qui comptent.
On peut critiquer la « main de fer », mais elle a ses justifications. L’autorité de l’Etat est une donnée historique : celle d’un impératif. La Russie s’étend de la Mer Baltique au Pacifique sur 17 millions de kilomètres carrés. C’est une société multiculturelle, composée de plus de 180 ethnies, qui sont autant de forces centrifuges : Géorgiens, Tatars, Mongols, Ukrainiens, Mongols, Kalmouks, Bouriates, Nenets, Cosaques, etc. Autant de sources de revendications et donc de tensions, plus le fait religieux : la Russie, majoritairement orthodoxe, compte 12 millions de musulmans. Dans 15 ans, environ 30 % de la population russe sera musulmane. Les paradoxes de la société russe ne manquent pas.
L’aigle russe a deux têtes : l’une regarde l’Ouest (l’Europe) et l’autre, l’Est (l’Asie) ; les russes majoritaires d’un côté, et les peuples minoritaires de la Fédération, de l’autre. Un pouvoir fort permet donc d’éviter un risque de désagrégation du pays. La Russie a fait le choix d’être Eurasiatique.
D’où les Siloviki… On pourrait les considérer comme une forme de « gouvernement profond », ainsi qu’il en existerait un aux Etats-Unis (Deep State) ou en France puisque le Président Macron s’en était plaint devant la presse en février 2019 : il avait publiquement indiqué que l’« Etat profond » freinait la mise en œuvre de ses réformes. Lors d’une réunion du club Valdaï à Sotchi, Pascal Boniface de l’lris demanda à Poutine quel était son avis sur le constat d’ « Etat profond » mentionné par le Président français. Poutine répondit de la façon suivante : « Fais venir dans l’administration tes partisans et adhérents et tout fonctionnera comme une équipe unie et donnera un haut niveau de résultat ». Or, Macron a complètement raté son « spoil system », sans compter sa politique d’attrape tout, avec son ni-ni : diversité ne veut pas dire compétences et efficacité.
Poutine aime quant à lui s’entourer de gens dont il a l’habitude et qu’il a observés au quotidien assez longtemps pour leur faire confiance. Il est très transparent sur la façon avec laquelle il considère l’exercice du pouvoir.
« Je suis convaincu que notre pays, avec son vaste territoire, sa structure nationale et territoriale complexe et une grande variété de traditions culturelles et historiques, ne peut pas se développer normalement et, je dirais plus, exister simplement de manière stable sous la forme d’une république parlementaire. La Russie doit rester une république présidentielle forte. » (Vladimir Poutine, le 15 janvier 2020 à Moscou).
Poutine s’est donc entouré d’une équipe de fidèles, et qui est à la manœuvre, en particulier dans les stratégies géopolitiques. Il en a été ainsi pour la guerre des prix avec l’Arabie saoudite.
Commençons tout d’abord par l’artisan du rapprochement avec ce pays : Kirill Dmitriev. C’est le dirigeant du Russian Direct Investment Fund (RDIF), un fonds souverain créé par le gouvernement Russe dont l’encours est estimé à 10 milliards de dollars.
Dmitriev, né à Kiev, donc en Ukraine, est une grosse pointure élevée à la mode occidentale. Il est titulaire d’un BAC en économie ave distinction de l’Université de Stanford, et d’un MBA avec distinction (Baker Scholar) de la Harvard Business School. Il a travaillé en tant que banquier d’investissement chez Goldman Sachs à New York et comme consultant chez McKinsey à Los Angeles, Moscou et Prague, avant de retourner en Russie en 2000. Plus capitaliste, tu meurs…
Il a un C.V. long comme le bras, plus de nombreuses distinctions. En Russie, il est décoré de l’Ordre d’Alexandre Nevsky et de l’Ordre d’honneur. En France, il porte le titre de Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur. Et, pour ce qui nous intéresse ici, il a reçu la plus haute distinction du Royaume d’Arabie saoudite : l’Ordre du mérite de deuxième classe du Roi Abdulaziz, en reconnaissance de sa contribution au renforcement de la coopération entre le Fédération de Russie et Arabie saoudite.
Relatons maintenant les circonstances des liens noués entre la Russie, via Dmitriev et l’Arabie saoudite en la personne du Prince héritier. Disons-le tout de suite : c’est digne d’un film d’espionnage, du moins au démarrage de l’histoire : pétrole, argent, pouvoir. Seul l’amour est absent…
Selon les sites Middle Est Eye et The Interest, le premier contact de Dmitriev avec MBS remonterait en février 2017. Mais il faut relater d’abord quelques évènements antérieurs le concernant.
Nous nous transportons donc à une réunion aux Seychelles, le 11 janvier 2017. Les iles Seychelles forment une nation d’archipels tropicaux dans l’océan Indien. C’est un paradis exotique, où des dirigeants du monde arabe ont des villas luxueuses, ou mieux, des palais des milles et une nuit. Des hommes d’affaires russes, des oligarques, viennent également passer du bon temps, pour le loisir ou le business, souvent pour les deux à la fois. Certains sont aussi propriétaires. On a même prévu des panneaux écrits en cyrillique pour la pêche en mer. Donc des visites faciles, tout ceci sans visa d’entrée, sans contrôle douanier, en toute discrétion. Mais pas pour n’importe quel touriste évidemment. Si vous êtes un salarié français qui veut venir fêter son départ en retraite, la procédure sera différente (comme tenu de la situation de nos retraites, c’est une idée totalement fictive, bien évidemment).
Les autorités des Seychelles sont très contentes de faire fonctionner leur économie de la sorte. Les petits ou grands « arrangements entre amis » sont lucratifs. Lorsque l’on a des dirigeants des Emirats, d’Abou Dabi, des hommes d’affaires libanais ou chinois, on fait des sourires et on ferme les yeux. On reçoit au passage quelques centaines de millions de dollars pour les œuvres sociales du coin. On comprend donc que tenir une réunion aux Seychelles, c’est s’assurer d’une bonne discrétion et d’une tranquillité dans les phases de négociation parfois difficiles. Le tout dans un cadre de conte de fées. C’est d’ailleurs pourquoi l’on peut rencontrer des « missi dominici » officieux, dont la mission confidentielle va être de « débroussailler le terrain », sans engager le gouvernement qu’ils « représentent ». La discussion du 11 janvier qui s’est d’ailleurs poursuivie le 12 janvier était de cette nature-là.
Une réunion était donc organisée par le Prince héritier d’Abou Dabi, Mohammed ben Zayed (MBZ), souverain dans les faits des Émirats Arabes Unis. Il est reconnu comme un dirigeant arabe de premier plan. Il y avait à ses côtés George Nader, un homme d’affaires libano-américain, rompu depuis une dizaine d’année aux relations « diplomatiques » : c’est l’est l’un des conseillers externes de MBZ. Sa principale faiblesse ? Il est pédophile. Ça lui jouera des tours avec les autorités américaines.
Nous trouvons ensuite un américain, Erik Prince, un personnage un peu sulfureux dont la vie pourrait donner lieu à une série télévisée sur Netflix : au moins 3 saisons… Il est l’ancien patron de Blackwater, une société privée de sécurité, en fait de mercenaires, qui a sévit en Irak dans le cadre de gros contrats signés avec l’Administration de Georges W. Bush. Blackwater avait défrayé la chronique en 2007 pour des comportements peu « humanistes » sur 17 civils Irakiens, tous décédés. Du coup, 2 ans après, Prince avait vendu son entreprise pour 200 millions de dollars et en avait créé deux autres à Abu Dabi, pour le même type d’activité, ainsi qu’une troisième à Hong Kong, sous le nom de Frontier Services Group. En 2011, il avait signé un contrat de 529 millions de dollars pour construire une armée secrète de 800 mercenaires au nom des Émirats Arabes Unis. On chuchotait à l’époque une possible invasion du Qatar. Erik Prince, c’est aussi le frère de Betsy DeVos, Secrétaire à l’Education (ministre) dans l’Administration Trump. C’est aussi un gros donateur pour le financement de la campagne du Président et un ami de Steve Bannon, l’éminence grise de Trump.
Enfin, se trouvait sur place notre émissaire officieux de Poutine, Kirill Dmitriev. Du moins, on présume, car selon les dires des participants, il était là et pas là … Plus précisément, il était de passage aux Seychelles avec son épouse, Natalia Popova. Alors, pourquoi pas prendre l’apéro chez MBZ ?
Bref, c’est une réunion d’affaire, où l’on aurait pu parler d’investissements au Moyen Orient, de renforcement de la sécurité sur un site sensible, des terroristes de Daesh, etc. Mais ce n’est pas l’interprétation du Procureur Robert Mueller qui enquête sur l’ingérence russe dans l’élection de Trump. À la suite de l’envoi d’une lettre anonyme adressée au Washington Post, cette réunion secrète n’en était finalement pas une, puisque les autorités américaines, FBI en tête, surveillaient certains des participants. Elle aurait été organisée par Jared Kushner, le gendre de Trump, en coordination avec MBZ. L’objectif de la « messe basse », selon Mueller, aurait été d’établir, avant l’investiture de Trump, un « circuit court » avec la Russie, dans l’objectif de discuter de la situation iranienne pour dénoncer l’accord sur le nucléaire.
Comme cette rencontre avait eu lieu durant la phase de transition, c’est-à-dire avant l’investiture de Trump le 20 janvier, elle posait un problème de collusion. Car les discussions avec des représentants étrangers passaient outre l’Administration Obama encore aux commandes. Mais surtout, comme il s’agirait d’une suite de discussions engagées depuis au moins décembre, voire août 2016, elle tendrait à conforter l’idée d’une ingérence russe, voire d’un financement occulte. Tout ça parce que Dmitriev était présent ou plutôt aurait été présent en janvier. Tout ça parce qu’il aurait adressé un message le soir de l’élection de Trump en novembre, en indiquant : « Poutine a gagné ». Compte tenu de l’hystérie paranoïaque qui a succédé à l’élection de Trump, la moindre boîte d’allumettes de marque russe aurait pu foutre le feu au Capitol.
En résumé, le FBI et le Procureur font l’hypothèse que la Russie a financé la campagne de Trump, en échange d’arrangements sur l’Iran, le tout étant mené par le patron d’un fonds d’investissement russe. Il faut comprendre également que le fonds dirigé par Dmitriev soulevait la possibilité que les sanctions américaines à l’encontre de la Russie auraient pu être violées si un accord commercial avait été conclu lors de cette réunion sur les Iles.
Interrogé, Erik Prince, au cœur des investigations du FBI, se réfugia dans la dénégation. Il fut également auditionné par le Congrès. Soucieux des deniers du contribuable américain, il s’interrogea en pleine séance « sur l’intérêt de la soi-disant communauté du renseignement, sous-financée, de jouer avec la surveillance des citoyens américains alors qu’elle devrait chasser les terroristes ? » Erik a le sens de l’humour… En fait, pas vraiment, c’est un gros bras, un ex- « Navy Seals ».
Cependant, l’analyse des faits, plus ou moins connus et vérifiés, montre que ce dont il s’agit n’est pas le financement occulte de la campagne de Trump qui n’a jamais été démontré sérieusement.
Pour le comprendre, il faut remettre en perspective la question iranienne. Elle est centrale. La Russie est un allié fidèle de l’Iran, mais les Iraniens constituent encore à ce jour, par ses manœuvres de déstabilisation, un sérieux problème pour beaucoup de pays arabes pétroliers. Nous avons vu que c’est même une sorte de prurit pour Trump. Ça n’arrête pas de le gratter, d’ailleurs bien avant son élection. Avec son ingérence en Lybie, on pourrait considérer que la Turquie, elle aussi plus ou moins « alliée » de la Russie, emprunte le même chemin. Mais restons sur l’Iran.
Fin 2015, selon Middle East Eye, George Nader avait organisé un sommet entre des dirigeants arabes sur un yacht en mer Rouge. Y assistaient le Prince héritier Saoudien MBS, le Prince héritier d’Abu Dabi, MBZ, le Prince héritier de Bahreïn, Salman ben Hamad, Abdel Fattah Al Sisi, Président de l’Egypte, et le Roi Abdallah 2 de Jordanie.
L’idée de George Nader présentée aux dirigeants rassemblés était de mettre en place un groupe régional, composé de ces six pays, qui viendrait supplanter à la fois le Conseil de coopération du Golfe (CCG) et la Ligue arabe, jugée moribonde. D’une certaine façon, la réunion du 11 janvier 2017 aux Seychelles s’inscrit dans cette recherche de constituer un front cohérent pour orienter la politique des pays arables, en contrant notamment les velléités de l’Iran dans la Région, mais aussi de la Turquie.
Comme la politique menée serait pro-américaine et même pro-israélienne, George Nader se proposait d’engager une action de lobbying à Washington pour en faciliter la mise en œuvre. Mais l’histoire ne dit pas ce qu’il advint de ce projet, et comment l’Administration d’Obama le percevait. Malgré tout, cela démontre qu’il y avait une certaine vision stratégique qui se dégageait parmi les pays arabes concernant l’évolution de la région.
Tout ceci supposait néanmoins que Moscou prenne de la distance avec Téhéran. MBZ avait rencontré deux fois Poutine en 2016, et lui avait conseillé de nouer une relation plus étroite avec les Émirats et l’Arabie saoudite. Depuis son intervention en Syrie en 2015, le Kremlin cherche à étendre son influence au Moyen-Orient, en profitant des circonstances pour approfondir ses relations. L’opportunité était d’autant plus grande en 2015 que la politique suivie par les Etats-Unis sous Obama, tout comme celle de l’Europe d’ailleurs, ne brillait pas par sa clarté.
C’est donc dans ce contexte qu’il faut resituer le rôle de Dmitriev, et du Fonds Russian Direct Investment Fund. Dmitriev rencontra personnellement MBS, semble-t-il, en février 2017 selon le site Middle East Eye, au moment où le jeune Prince saoudien n’est pas encore désigné héritier de la couronne. Il le sera en juin 2017. Mais lors de cette rencontre, MBS commençait déjà à s’inquiéter de la chute des cours du pétrole qui impactait négativement le budget du Royaume.
La relance des relations avec l’Arabie saoudite remonte à juillet 2015, où de premiers accords et contrats sont signés, à la suite du Forum économique de Saint Pétersbourg, après une rencontre entre Mohammad bin Salman Al Saud, le prince d’Arabie saoudite de l’époque, et Vladimir Poutine. Pour la Russie, c’est une opportunité de sortir de l’encerclement des pays occidentaux qui cherchent à l’isoler sur la scène internationale en raison de son rôle dans le conflit Ukrainien.
En novembre 2016, la Russie s’était jointe à l’OPEP pour répliquer à la concurrence américaine du pétrole de schiste. Le champ des discussions, sous la conduite du Ministre russe de l’Energie, Alexander Novak, était essentiellement axé sur le pétrole. Fin janvier 2017, Le Monde rapporte que les ministres saoudien et russe de l’énergie avaient déclaré qu’ils partageaient l’objectif d’une coopération de longue durée. « Historiquement, l’OPEP était assez influente pour contrôler seule le marché. Mais aujourd’hui, nous avons le sentiment qu’elle ne peut plus le faire seule », avait admis le Saoudien Khaled Al-Faleh. « Nous considérons que la coopération entre nos pays est une coopération de long terme, avait répondu Alexander Novak. Les deux plus gros exportateurs de pétrole ne peuvent pas s’ignorer et peuvent travailler ensemble pour stabiliser le marché. »
Ce que réussit à faire Dmitriev sur cette base de l’OPEP+, c’est d’élargir le champ des relations axées essentiellement sur le pétrole vers une plus grande prises en compte des questions politiques du Moyen Orient. La réelle ambition de Poutine. La Syrie était à la fois un sujet de tension avec les pays arabes, mais aussi l’occasion de trouver des moyens de dépasser ce conflit qui a bouleversé la donne : pour les Etats-Unis, Israël, l’Irak, etc. Il ne faut pas en oublier l’origine, du moins une des hypothèses de son déclenchement : le refus par la Syrie, sous la pression russe, du projet des pétromonarchies, avec en tête le Qatar, de créer un gazoduc partant des Emirats et de l’Arabie Saoudite, en passant par le territoire syrien, pour ensuite atteindre la Turquie dans le but d’alimenter l’Europe en gaz. A l’inverse, Damas accepta celui de l’Iran jusqu’en Syrie qui contournerait ensuite le territoire turc afin d’aller vers le marché européen. Ce gazoduc contrait celui de pétromonarchies, dont l’Arabie saoudite. Il était également rejeté par la Turquie. Vint ensuite la guerre où l’on retrouve tous ces acteurs. Cette explication fait encore aujourd’hui l’objet de nombreux débats.
Poutine est un pragmatique. Concernant l’Arabie saoudite, il y avait deux domaines où les relations pouvaient avancer : les investissements et la vente de matériel militaire. Dans ce cadre, le rapprochement entre les deux pays se déroula progressivement jusqu’au point d’orgue constitué par la rencontre, à Ryad, de Poutine et de MBS en octobre 2019.
Il y eut d’abord la visite du Roi Salmane à Moscou en octobre 2017, avec notamment la signature de plusieurs contrats, notamment la mise en place de deux fonds communs d’investissement dans le domaine énergétique et celui de hautes technologies, pour un milliard de dollars chacun. Dmitriev est à la manœuvre. Mais également, un signal encore plus politique : la possibilité pour Ryad d’acheter des systèmes de défense antiaérienne russes S-400. Poutine déclara à l’attention du Roi : « Cette visite va donner une nouvelle impulsion puissante au développement des relations bilatérales »
Puis fut organisée la visite de Poutine à Ryad, quelques semaines après l’attaque des raffineries. Une étape clef dans les relations entre les deux pays. A cette occasion, Dmitriev avait déclaré : « Trop souvent par le passé, nous avons été des côtés opposés de la barricade. Aujourd’hui, plus nous aurons de projets communs, plus la confiance se renforcera ».
Quelques semaines auparavant, le Fond RDIF avait ouvert un Bureau à Ryad. Un communiqué du Fond précisait que « plus de 25 projets communs pour un investissement total de 2,5 milliards de dollars ont été financés à ce jour dans les secteurs de l’infrastructure, de l’industrie ou de l’intelligence artificielle ». Des projets étaient également développés avec Aramco. De son côté, le Fonds saoudien (PIF) indiquait entrer avec RDIF à hauteur de 30 % dans le capital de Novomet, fabricant russe de pompes qui commençait à fournir l’Arabie saoudite. Dans le communiqué, Dmitriev soulignait que « L’ouverture de ce bureau permettra de réaliser une percée dans un grand nombre de domaines de coopération bilatérale ». Tout ceci s’emboitait bien dans la volonté de MBS de diversifier les activités du Royaume et de son plan « Vision 2030 » lancé en 2016.
Lorsqu’en mars dernier, Vladimir Poutine céda à la pression de Setchine pour mettre un terme à l’accord avec l’OPEP+, déclenchant la colère de MBS, certaines sources russes mentionnèrent que Dmitriev avait été très contrarié de voir tous ses efforts réduits à néant. Mais l’homme, nous l’avons vu, a de la ressource. Lorsque la guerre des prix prit une tournure catastrophique où plus personne ne contrôlait plus rien, il est revenu à la charge auprès de Poutine. Avec d’autres libéraux, il demanda un changement de cap. Un mois de guerre des prix avait mis l’économie russe sous pression et affaiblit le rouble, bien au-delà du scénario que Poutine avait prévu. N’oublions pas que Dmitriev est un ancien de Goldman Sachs et qu’il maîtrise tous les arcanes des marchés financiers, qu’il connaît parfaitement la psychologie des investisseurs et leurs comportements. Or, la Russie ne pouvait et ne peut se mettre à dos toutes les économies mondiales.
Dmitriev reprit donc la main et c’est lui qui mena les discussions avec MBS pour trouver un accord. On le retrouva ainsi le 8 avril lorsqu’il déclara : « Nous sommes très proches d’un nouvel accord pétrolier avec Riyad ». Il se réalisa quatre jours plus tard, le 12 avril, même si, comme nous le savons, il ne répondit pas aux attentes du marché.
Quelques jours plus tard, un communiqué Reuters du fonds souverain russe, repris par la chaîne saoudienne Al-Arabiya, indiqua qu’il continuerait d’investir dans le programme de développement Vision 2030 de l’Arabie saoudite. Sans doute une des contreparties souhaitées par MBS dans le cadre de la négociation de l’accord du 12 avril.
Profitant de cette nouvelle dynamique, Dmitriev fit feu de tout bois. Déjà le 5 avril, anticipant le 75ème anniversaire de la réunion des troupes américaines et russes sur l’Elbe en 1945, il avait publié en anglais un long plaidoyer sur le site de la chaine financière CNBC (Consumer News and Business Channel). Un message destiné à la communauté financière américaine et plus largement aux citoyens des Etats-Unis. Ce texte mérite d’être lu en entier. Dmitriev appelait au rétablissement des relations bilatérales russo-américaines. en concentrant les efforts sur 3 domaines : la lutte conjointe contre la pandémie de coronavirus, la réduction de l’impact de la récession économique mondiale et le développement d’une plate-forme pour une future coopération dans la lutte contre le terrorisme, la prolifération nucléaire et le changement climatique. Sergueï Lavrov, le ministre des affaires étrangères russes n’aurait pas fait mieux.
« Malgré de nombreuses différences, la Russie et les États-Unis ont beaucoup en commun. Nous aimons nos familles et voulons qu’elles soient en bonne santé. Nous savons travailler en équipe face à l’adversité et sommes prêts à faire des sacrifices pour nos valeurs et nos communautés. Ces dernières années, trop d’attention a été accordée à nos différences et trop peu aux possibilités de travailler ensemble sur des questions mondiales. En fait, nous avons permis à la culture de la peur d’émerger avec les chefs d’entreprise et même les scientifiques, ce qui les a effrayés de parler de la coopération américano-russe. »
La déclaration commune entre Trump et Poutine le 25 avril reprit le même thème :
L ‘« Esprit de l’Elbe» est un exemple de la manière dont nos pays peuvent mettre de côté les différences, instaurer la confiance et coopérer dans la poursuite d’une cause plus grande. Alors que nous travaillons aujourd’hui pour relever les défis les plus importants du 21e siècle, nous rendons hommage à la valeur et au courage de tous ceux qui ont combattu ensemble pour vaincre le fascisme. Leur exploit héroïque ne sera jamais oublié.
Plusieurs commentateurs aux Etats-Unis rejetèrent ce message, reprochant à Trump notamment de court-circuiter les circuits diplomatiques habituels et de conduire sa propre politique envers la Russie.
De la parole aux gestes, Dmitriev lança le 30 avril une initiative par l’intermédiaire de son Fonds d’investissement direct russe (RDIF) : le lancement de projets de lutte contre la maladie des coronavirus en collaboration avec d’autres fonds souverains étrangers et des institutions d’investissement. Plus de 20 investisseurs, représentant plus de 8 billions de dollars d’actifs sous gestion, sont ainsi associés à cette démarche : Brésil, Chine, France, Inde, Italie, Japon, États-Unis République de Corée, Singapour, Thaïlande et plusieurs pays arabes (Émirats Arabes Unis, Koweït, Oman) dont l’Arabie saoudite, signe que les ponts ne sont pas coupés avec le Royaume. Comme l’écrit le journal russe de gauche Nezavissimaïa Gazeta, Poutine n’est pas homme à céder sous la pression. Mais, encore une fois, c’est un pragmatique.
Ce que révèle aussi ce déroulement en Russie, c’est qu’il y a bien deux courants qui s’opposent autour du Président : les « Siloviki », les partisans des lignes dures, et les « Siviliki » (d’après « civils » en russe). Les « Siloviki » forment un petit groupe d’hommes de l’intelligentsia libérale, acquis au projet de modernisation du pays. Dmitriev en fait partie. Ces hommes s’étaient regroupés auprès Medvedev lorsque ce dernier était Président de la Fédération et Poutine son Premier ministre. Mais Medvedev n’avait ni le charisme ni l’autorité naturelle, par rapport à son Premier ministre, pour conduite une politique plus libérale.
Dmitriev est donc une personnalité à suivre. Analyser les partenariats et les investissements du Fonds RDIF permet de comprendre les priorités diplomatiques de Moscou. De façon évidente, elles se situent aujourd’hui en Asie et au Moyen-Orient.
Ce faisant, il ne faut pas ignorer non plus la démarche suivie par Setchine, le patron de Rosneft qui a influencé suffisamment Poutine pour prendre deux décisions : partir en guerre contre le pétrole de schiste tout en quittant l’OPEP+ pour avoir les mains livres. L’accord de 2016, comme nous l’avons indiqué, avait en fait servi les intérêts pétroliers des Etats-Unis, en favorisant ses exportations et donc l’augmentation de ses parts de marché, notamment au détriment des entreprises russes.
Igor Setchine n’est pas un diplomate. Issu des forces de sécurité comme Poutine, donc un « Siloviki », il ne craint personne, si ce n’est son « maître ». C’est un fils d’ouvrier qui a suivi des cours de droit à l’université. Il apprend des langues étrangères : français, espagnol, portugais, et japonais. Ce sont ces compétences qui le font recruter par le KGB, avec une première mission au Mozambique puis en Angola. Après cette étape, il changea d’orientation et passa un doctorat d’économie. Il rencontra Poutine lors d’un voyage à l’étranger et les deux hommes s’apprécièrent immédiatement.
Lorsque Poutine rejoignit la mairie de Saint-Pétersbourg, au début des années 1990, Setchine le suivit en devenant son secrétaire particulier. Depuis, par sa loyauté et sa force de travail, il est devenu l’un des plus proches collaborateurs du Président. Cette relation lui donna un tel poids que personne ne se mit en travers de ses ambitions ou de ses projets. Que ce soit Medvedev ou Khodorkovski ou d’autres oligarques, tous ceux qui se sont opposés à Setchine ont subi sa colère pour ne pas dire sa vengeance. Lorsque Poutine, en ce début d’année, a renouvelé toute son équipe par des quadras, provoquant le départ de la vieille garde, Setchine, lui, a été maintenu.
C’est un vrai manager, à l’occidental. Rosneft dispose d’un conseil d’administration avec des personnalités de premier plan, comme le PDG de BP. Depuis 2017, c’est l’ex-chancelier allemand, Gerhard Schröder, qui préside le conseil. L’entreprise est cotée à la Bourse de Londres.
Le regard de Setchine ne se limite pas au pétrole ou au gaz. Depuis plusieurs années, il portait en lui un fort ressentiment concernant les sanctions occidentales qui pesaient sur la Russie depuis son annexion de la Crimée. Ruiner l’industrie pétrolière américaine serait donc une façon de répliquer à ces mesures, notamment celles qui frappent son entreprise au Venezuela. Contraindre les Etats-Unis à négocier pour supprimer certaines sanctions est donc l’une des explications de la manœuvre proposée par le président de Rosnef. Comme il estimait que l’Arabie saoudite ne jouait pas le jeu, il considérait qu’il fallait rompre l’accord de 2016.
Il avait déjà présenté ces arguments en 2019, mais Poutine avait répondu par la négative, étant en pleine négociation avec MBS comme nous l’avons vu. En outre, cette alliance avait été décisive pour permettre à la Russie de traverser la crise engendrée par la baisse brutale des prix du pétrole de 2015. Elle avait aussi apporté à la Russie des gains importants de politique étrangère. Ce n’est que lorsque Setchine démontra que les exportations américaines s’orientaient désormais vers la Chine, au risque de compromettre gravement les investissements importants réalisés en Sibérie, que Poutine commença à changer d’opinion.
Quand l’Arabie saoudite proposa en février 2020 une réduction de la production de 500.000 barils jour pour la quote-part de la Russie, Setchine remonta au créneau. Selon lui l’accord était suicidaire et il fallait réellement se désengager de l’OPEP+.
Le 1er mars, avant un déplacement à Pskov, Vladimir Poutine tint une réunion à l’aéroport de Vnoukovo-2 avec le gouvernement et tous les acteurs du secteur. L’ordre du jour était de discuter de l’incidence du coronavirus sur les marchés et de décider de la suite à donner aux propositions de l’Arabie saoudite. Tous les participants souhaitèrent le statut quo des conventions actuelles et le maintien dans l’OPEP+, à l’exception de Setchine. C’est le site russe The Bell qui dresse un compte-rendu assez précis des échanges. Setchine expliqua sa position qui portait sur les exportations américaines : « Maintenant, nous allons leur montrer ! Au prix actuel où ils investissent activement pour leur pétrole de schiste, vendre leur production à un prix inférieur à 40 dollars leur sera défavorable et Rosneft peut se permettre une telle baisse ». Certes, mais les effets collatéraux sur les producteurs alliés de la Russie pourraient leur être très préjudiciables. « Cela touchera durement les budgets des nations dépendant du pétrole, de l’Angola au Kazakhstan, et pourrait aussi redistribuer les cartes politiques, en réduisant l’influence de pays comme l’Arabie Saoudite », explique un analyste qui ajoute : « Et le combat contre le changement climatique pourrait subir un revers ». Un autre expert rappela qu’un certain nombre de contrats d’exportation à long terme pour la fourniture de gaz étaient « liés au pétrole » : en d’autres termes, il fallait s’attendre que les prix du gaz baissent après les prix du pétrole… Or, comme on le sait, la Russie est un très gros exportateur de gaz.
Allianz Research publia la simulation suivante : chaque baisse de 10 dollars du prix du baril coûte à la Russie un demi-point de PIB. Dans Novaïa Gazeta, Marcel Salikhov résuma la situation par un prédiction pessimiste : « A long terme, dévaluation, inflation, baisse du rouble et, finalement, un recul de l’économie ». Le tout, dans une conjoncture déjà stagnante, avec une croissance limitée à 1,3 % en 2019, loin des 4 % promis par Vladimir Poutine.
L’on connait la suite : Poutine fut obligé de revenir à la table de négociation. Dmitriev reprit la main et l’on ne sait pas comment les relations entre Setchine et Poutine évoluèrent. La presse d’obédience libérale a commencé ces derniers jours à mettre en cause personnellement le patron de Rosnef.
Ainsi, comme le relate le magazine Mariane, sous le titre « Le temps difficile de la responsabilité », Konstantin Sonin, professeur d’économie à l’Université de Chicago, ainsi qu’à l’Ecole supérieure d’économie de Moscou, avait signé un éditorial le 13 avril pour le prestigieux quotidien économique Vedomosti, l’équivalent russe du Financial Times. Le texte en question comparait l’image qu’avait retenu l’opinion publique du rôle d’Egor Gaidar dans la crise des années 1990, à celle qui risquait d’être attribuée à Igor Setchine, dans l’effondrement actuel du prix du pétrole, lourd de conséquences pour l’économie russe. Cet édito fut censuré par le nouveau directeur de la rédaction du journal, sous influence du Kremlin… Manifestement, Setchine reste encore protégé.
Une autre information peut donner une indication. En début d’année, Poutine avait annoncé une réforme de la Constitution. Un référendum était prévu en avril mais compte tenu de l’épidémie, il fut reporté. Or, quelques jours après la réunion à Vnoukovo-2, le petit groupe de fidèles qui avait prit en charge ce dossier proposa un amendement, autorisant le Président à remettre à zéro le compteur de ses mandats, ce qui lui permet de se succéder à lui-même en 2024. Les observateurs décodèrent cette manœuvre : ce sont les « Siloviki » qui en procédant ainsi veulent continuer à protéger leurs intérêts économiques et à s’assurer leur sécurité politique !
Problème de marché ou tectonique géopolitique ?
Comme nous venons de le voir, la lecture de la crise pétrolière actuelle ne doit pas se limiter à de strictes considérations de marché. Certes, le contexte de récession mondiale, liée au confinement sanitaire, avec un déséquilibre important entre une offre pléthorique et une demande atone constitue la cause centrale de la chute des prix. Mais les processus de décision derrière cette situation sont bien plus complexes qu’on ne peut le penser. Par conséquent, toute réflexion sur l’évolution de la situation doit prendre en considération les données géopolitiques du pétrole ainsi que la psychologie des acteurs, au premier rang desquels figurent les grands dirigeants de la planète. Dans un seconde partie, nous aborderons la situation sous l’angle des établissements financiers. Car, les banques sont très engagées dans le financement du pétrole. En cumulant l’impact de la récession et les créances impayées, doit-on s’attendre à une crise systémique du système bancaire ?